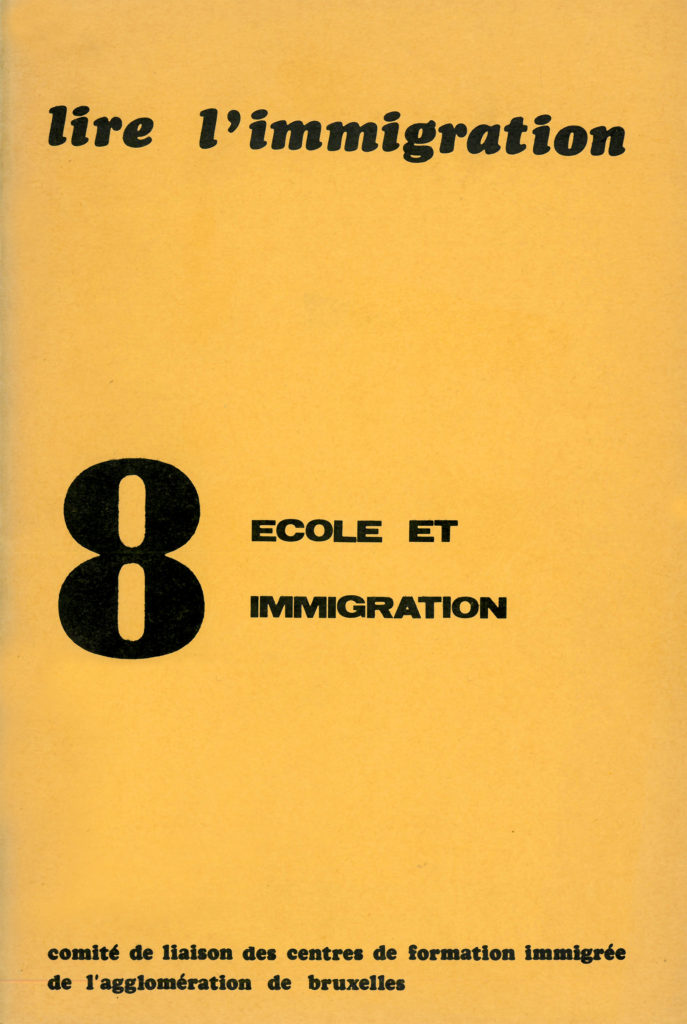Marie-Thérèse Coenen (historienne, CARHOP asbl)
La revue Dynamiques n°4 abordait des expériences d’éducation populaire de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle à travers l’apparition des Extensions universitaires et du mouvement émergeant des Universités populaires. Nous pouvons en effet parler de « mouvement upéiste » vu le nombre important d’initiatives qui ont fleuri à cette époque.
Ce mouvement qui se prolonge dans l’Entre-deux-guerres se caractérise par une double volonté. D’un côté, des intellectuels généralement situés à gauche de l’échiquier politique, mais pas seulement, s’investissent dans la transmission du savoir au peuple, si possible à la classe ouvrière. De l’autre, le mouvement ouvrier qui exprime ses besoins de former une élite militante, capable de comprendre et d’agir sur les mutations politiques et économiques à l’œuvre dans ce début de 20e siècle. Vu l’enjeu de la démocratisation politique et sa volonté de transformer les rapports de force sur le terrain économique, le mouvement ouvrier prend les rênes de l’éducation politique et sociale de ses affiliés et affiliées. Ce sera la Centrale d’éducation ouvrière (CEO, créée en 1911) du côté socialiste tandis que la Ligue nationale des travailleurs chrétiens (LNTC, fondée en 1921 − l’ancêtre du MOC) se dote d’une Centrale d’éducation populaire en 1930 prolongeant, pour les adultes, les écoles de délégués établies au sein des organisations de jeunesse de la JOC (Jeunesse ouvrière chrétienne) et de la JOCF. Pour la formation de leurs cadres, les organisations socialistes et chrétiennes investissent dans des écoles comme l’École ouvrière supérieure (d’obédience socialiste – fondée en 1921), l’École centrale supérieure pour ouvriers chrétiens (créée en 1922) et l’École sociale catholique féminine de Bruxelles (1920).[1] Le mouvement ouvrier garde ainsi la main sur la formation de ses cadres.
Après la Seconde Guerre mondiale, la démocratie politique est quasi aboutie en Belgique. S’y joindront encore comme électeurs et électrices, les jeunes de 18 à 21 ans, dans les années 1970. Le vote des étrangers résidant en Belgique depuis plus de 5 années sera acquis, par étapes, entre 1999 et 2004. La démocratie économique connaît aussi des avancées : désormais, les organisations représentantes des travailleurs et travailleuses acquièrent un droit de regard sur les décisions socio-économiques. Avec la signature du Pacte social en 1944 et les lois organiques qui en découlent, la vie sociale est désormais rythmée par les élections sociales à partir de 1950 et la mise en place des organes de la concertation sociale, en entreprise, au niveau professionnel, et à partir de 1960, de l’accord interprofessionnel. Il faut former les délégués et déléguées à ces nouvelles responsabilités. Nous assistons aussi à un regain d’intérêt pour la formation des militant.e.s et des travailleurs et des travailleuses adultes. La scolarisation des générations des années 1920-1930 et l’allongement de l’obligation scolaire à 18 ans, le développement de l’enseignement technique et professionnel de plein exercice ou de l’enseignement de promotion sociale produisent leurs effets sur les jeunes générations.
Parallèlement, de nouveaux besoins s’expriment auprès de groupes “laissés pour compte” dans la période des Trente Glorieuses. La montée des contestations autour des années 1968-1970 et l’émergence de nouveaux mouvements sociaux amènent aussi une critique de l’éducation et de la production des savoirs : l’école distille la culture de l’élite et reproduit les inégalités sociales et culturelles. Comment briser ce cercle non vertueux ? La réflexion porte aussi sur la connaissance comme moyen d’émancipation, mais pas seulement. La formation est nécessaire pour maîtriser les rouages d’une société et permettre le changement politique, économique et social.
Quelles sont ces initiatives ? À quels enjeux répondent-elles ? Comment se sont-elles structurées ? À quels publics s’adressent-elles et avec quels résultats ?
Ce numéro de Dynamiques met le projecteur sur des initiatives qui émergent dans l’après-guerre. Elles répondent à des besoins exprimés, à des attentes, à des publics variés, etc. Elles ont un commun dénominateur : la formation est un outil d’éducation permanente. Elles développent de nouvelles approches, testent des pratiques pédagogiques et marquent leurs différences. Ainsi, par exemple, ATD Quart Monde organise ses universités populaires.
L’expérience lancée en Angleterre de l’Open University percole en Belgique francophone, où le mouvement ouvrier se met à rêver d’une telle université[2]. Cette utopie s’inscrit dans une critique de l’université traditionnelle et dans une volonté de démocratisation de cette institution ce qui suppose de multiples ouvertures : à des étudiants et étudiantes issu.e.s des classes populaires, à des questionnements qui intéressent les travailleurs, à des méthodes pédagogiques innovantes qui rompent avec la simple transmission et à une émancipation collective qui dépasse la réussite individuelle… Les chantiers sont multiples. L’étude de faisabilité d’une université ouverte restera cependant sans suite, faute d’une volonté politique. Dans la foulée de cet échec, la Formation pour l’Université Ouverte de Charleroi (FUNOC) sera lancée comme formation alternative branchée sur le développement régional à Charleroi. Le monde universitaire ne reste pourtant pas totalement sans réaction face à ce foisonnement d’initiatives critiques quant à son rôle d’institution de reproduction de la domination. Après les Facultés Notre-Dame de la Paix à Namur, qui se sont engagées aux côtés du CIEP (Centre d’information et d’éducation populaire fondé par le MOC en 1961) à reconnaître et valider le graduat en sciences du travail délivré par l’Institut supérieur de culture ouvrière (ISCO, créé en 1964), l’Université catholique de Louvain (UCL) signe un partenariat avec le MOC (Mouvement ouvrier chrétien) qui permet, en 1974, le lancement d’une expérience innovante, la Faculté ouverte de politique économique et sociale (FOPES). Du côté de l’Université libre de Bruxelles (ULB), des enseignants et chercheurs démarrent le projet d’une licence alternative, à horaire décalé, interdisciplinaire, accessible à toutes et tous par la valorisation de l’expérience. Cette équipe s’investit aussi dans l’Université syndicale, lancée par la Régionale FGTB de Bruxelles-Hal-Vilvorde, et teste des méthodes d’apprentissage basées sur la non-directivité. Certaines sont encore actives aujourd’hui : la FUNOC[3] et la FOPES[4] ont fêté leur 40e anniversaire. Le mouvement Lire et Écrire, né dans le berceau de l’Université syndicale, s’est implanté au début des années 1980 en Fédération Wallonie-Bruxelles. Il constitue un rouage essentiel dans la lutte contre l’illettrisme et pour l’insertion sociale des personnes pour lesquelles l’école n’a pas pu ou pas su transmettre cet apprentissage élémentaire, savoir lire, écrire, compter.
Le Centre d’action sociale italien-Université ouvrière, connu sous le nom de CASI-UO, s’adresse, dès 1971, aux jeunes Italiens de la deuxième génération résidant à Anderlecht, et favorise diverses formes d’expression (le théâtre, la chanson). Son Université ouvrière devient un modèle pour les jeunes Espagnols et s’ouvrira à la jeune génération marocaine. Il développe également d’autres initiatives.
Le mouvement féministe des années 1970 aborde, sans tabou et avec beaucoup de créativité, les sujets qui fâchent ou interpellent les hommes et les femmes. La revue Les Cahiers du GRIF, lancée en 1972, conteste radicalement la société qu’elle qualifie de patriarcale et capitaliste. Mais une revue ne suffit pas à épuiser ce sujet et les militantes du GRIF (Groupe de recherche et d’information féministes) relèvent alors le défi de lancer un laboratoire de recherche : GRIF–Université des femmes, qui devient en 1981, l’Université des Femmes asbl. Il s’agit de combler le désert de la recherche scientifique dans les questions qui intéressent les femmes et l’absence de tout enseignement de haut niveau abordant les problématiques mises à nu par le mouvement féministe.

Plus proche de nous, se développe un nouveau réseau d’universités populaires, s’inspirant directement du mouvement français, relancé à Caen par le philosophe Michel Onfray, en 2003. Ces universités sont multiples : elles se créent un jour, ouvrent un site, lancent un bulletin d’information, organisent l’une et l’autre manifestation… Cette réalité est mouvante. L’Université populaire de Mons, par exemple, lancée en 2005, ne semble plus active. D’autres, par contre, rejoignent le mouvement et occupent la toile qui devient un formidable outil de mise en réseau[5].
Nous développerons l’exemple de l’Université populaire de Bruxelles, née en 2009, mais dont les racines plongent dans les projets portés par le mouvement syndical dans les années 1970 et dans le bouillonnement provoqué par le tissu associatif et alternatif des années 1980. Son projet est social et culturel : répondre aux nouveaux besoins des travailleurs et des travailleuses, des jeunes ou moins jeunes, issu.e.s ou non de l’immigration ou du monde populaire. Elle s’inscrit dans cette lignée d’initiatives qui veulent rendre la culture accessible et la formation possible pour ceux et celles qui veulent prendre leur vie en main et comprendre les petits et grands problèmes de leur temps. Contrairement à l’initiative montoise, dont on ne retrouve plus de traces, l’Université populaire de Bruxelles fait toujours partie du paysage intellectuel bruxellois et est en réseau avec le mouvement upéiste français avec lequel elle collabore, ce qui n’est pas nécessairement le cas pour d’autres UP belges.
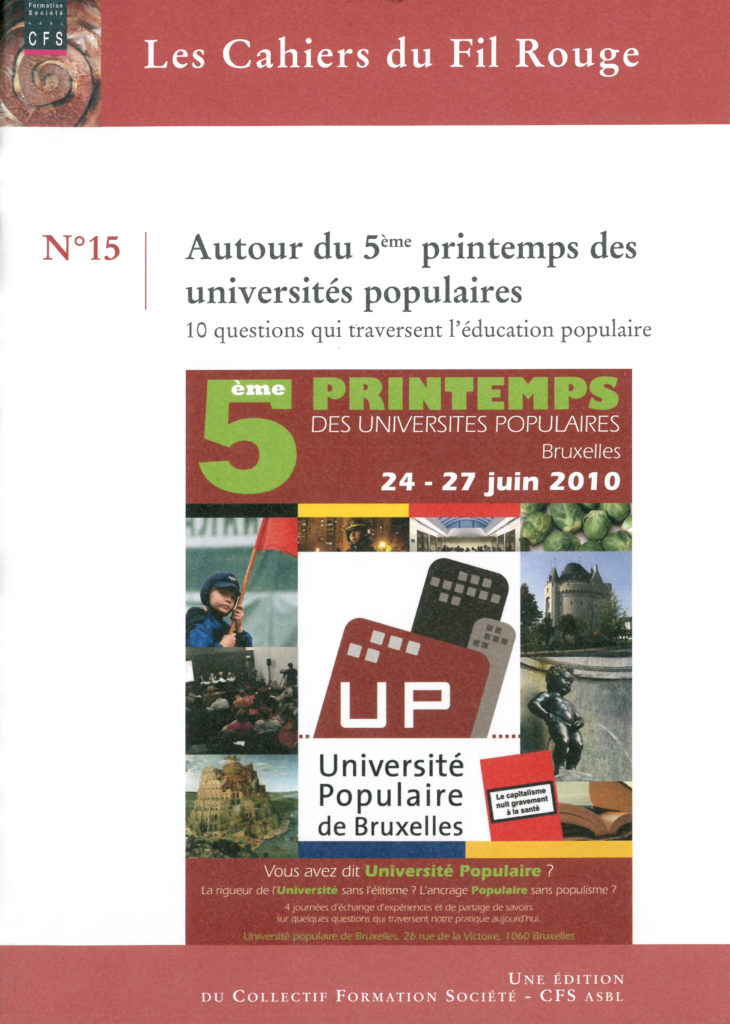
Ces initiatives ont en commun de s’appeler « universités »[6]. Qu’elles soient ouvertes, populaires, ouvrières, syndicales, qu’elles s’adressent plus spécifiquement au public du Quart Monde, aux femmes ou aux migrants italiens, espagnols, aux primo arrivants ou de la deuxième génération, ces « universités » répondent à chaque fois à une interpellation, à un besoin. Chaque fois, il s’agit de permettre l’accès au savoir, de favoriser les échanges et la connaissance en lien avec des questions spécifiques. Elles sont aussi une manière de donner à des groupes minorisés ou exclus du pouvoir, la parole et la capacité d’agir. Cette veine est loin d’être tarie. Si certaines se sont mises en veilleuses, d’autres se maintiennent dynamiques. De nouvelles émergent comme cette Université des migrants, lancée en 2016 par le MRAX. La démarche vise à favoriser l’intégration des nouveaux migrants et à renforcer leur maîtrise de la société dans laquelle ils sont amenés à vivre, à partager les modes de vie et à augmenter, par la connaissance et par leur compréhension des enjeux, leur pouvoir d’action. Elles constituent une version positive du parcours d’intégration quelque peu forcé que le monde politique souhaitait rendre obligatoire pour tout nouvel arrivant[7].
Les « universités populaires » se renouvellent. Elles ont de beaux jours devant elles pour répondre à ce défi : le savoir comme clé du changement, à la fois de manière individuelle pour connaître ses droits et les faire respecter et à la fois collectivement pour œuvrer à une société plus juste et plus égalitaire, pour renforcer la cohésion sociale ou pour être acteur et actrice de changement, tout simplement.
Notes
[7] http://www.mrax.be/wp/luniversite-populaire-des-migrants/
POUR CITER CET ARTICLE
Référence électronique