Jacques Moriau
(sociologue, assistant chargé d’exercices, chercheur contractuel,
ULB, Institut de sociologie, METICES)
Avec la professionnalisation du travail social au début des années 1970 émergent toute une série de préoccupations quant à ses objectifs, ses effets réels, son sens. Au détour d’un entretien, à l’occasion d’une manifestation, dans l’une ou l’autre prise de parole publique se font entendre de la part des intervenants critiques et interrogations à propos du métier, de ses missions et de ses finalités. Rares sont cependant les sources qui rassemblent de façon concise et explicite les réflexions portées par les professionnels sur leurs pratiques.
En France, deux publications vont permettre de poser ces débats en des termes qui seront repris pour discuter également de la situation belge. Il s’agit de deux numéros de la revue Esprit, datés de 1972 et 1998, entièrement consacrés aux questions de la fonction et du sens du travail social. Regroupant enquête, témoignages de travailleurs sociaux et analyses de travailleurs intellectuels, ils tentent de répondre à cette même question à vingt-cinq ans d’intervalle et à deux moments significatifs de l’évolution des politiques sociales et des transformations de l’État social-démocrate. Ils constituent ainsi deux coups de sonde dans l’expérience et le ressenti des travailleurs sociaux et permettent de documenter les modifications des questionnements et des positionnements de ceux-ci.
Ces recueils de textes sont d’autant plus intéressants qu’ils débordent la forme d’une simple compilation de comptes-rendus de pratiques pour ouvrir vers des questions qu’il nous semble indispensable d’aborder quand on veut penser les buts de l’intervention sociale : de quels projets les professionnels se sentent-ils porteurs ? Quels types de rapports entretiennent-ils avec l’État ou ses représentants ? Comment envisagent-ils leur relation à l’usager ou au bénéficiaire de leur action ?
À ces sources, nous avons jugé utile d’en ajouter une autre, plus récente et sans doute de moindre retentissement : le Manifeste du travail social paru en 2016. Bien que plus militant et destiné en priorité aux travailleurs sociaux, ce document apporte un éclairage sur les positions d’une frange de professionnels à l’heure de l’État social actif et marque la naissance d’une troisième période dans cette ébauche d’une histoire de l’expérience vécue du travail social par les professionnels.
Des sources hétéroclites et situées à des époques différentes donc, mais qui permettent de mettre en évidence trois façons de poser la même question et trois façons d’y répondre dans trois contextes socio-politiques différenciés.
Pourquoi le travail social ?
Pourquoi le travail social ? : le titre du numéro spécial de la revue Esprit[1], datée du printemps 1972 est explicite. Dans la foulée des mouvements contestataires de mai 1968, la question se veut radicale. Il s’agit moins de s’interroger sur le sens de l’intervention sociale professionnelle que de remettre en cause son existence même. L’introduction expose les motifs de l’exercice en ces termes : « interroger dans toute son extension et (…) mettre ainsi en question ce qui, malgré les querelles intrinsèques à la profession, semble aller de soi et qui est pourtant inouï : la production organisée de la socialité »[2]. Au long des textes, la critique porte en fait sur les effets souterrains du travail social. Derrière le projet annoncé de venir en aide aux franges les plus fragilisées de la population, il servirait en réalité à apaiser les conflits et à empêcher la transformation effective de la société.
Cette condamnation d’une activité de contrôle déguisée en offre de soutien, qui va devenir un lieu commun de l’analyse du travail social, ne naît pas par hasard. Les travailleurs sociaux qui ont répondu à l’enquête[3] d’Esprit ou qui y publient des témoignages font partie d’une nouvelle génération d’intervenants. En rupture avec la figure de la dame patronnesse ou du bénévole, ils revendiquent fortement qu’on reconnaisse le travail social comme un métier basé sur des techniques et des compétences qui le différencient d’un simple engagement humanitaire. En tant que nouveaux professionnels du social, ils endossent pleinement la mission de « travailler la société » et de tenter de la transformer pour plus d’égalité.
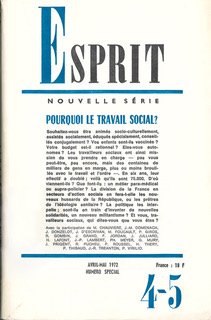
Mais cette position se heurte frontalement à deux constats : les références techniciennes qu’ils brandissent comme une forme de légitimation de leur action les éloignent d’autant de la population qu’ils entendent servir et, plus grave, les interventions qu’ils combattent moins l’exclusion qu’elles n’aident les rapports sociaux inégalitaires à se maintenir.
Le malaise qu’expriment ces nouveaux professionnels provient tout entier de ce paradoxe : plus on soutient les populations marginalisées, plus on tempère la volonté de changement et plus on permet à la société de reproduire les inégalités. Le travail social ne sert pas à transformer la société mais à éviter qu’elle ne se transforme !
À une époque de remise en cause profonde du fonctionnement social, l’enjeu est donc clair : il faut non seulement faire reconnaître que le travail social rencontre aussi les besoins anthropologiques, ceux qui relèvent du soin, de la conquête ou du respect des droits, mais surtout faire apparaître l’importance politique du travail social pour l’invention d’une nouvelle société. Car « si le productivisme reste notre loi commune, il continuera de défaire la société tout en faisant la politique, et le travail social ne sera jamais que son infirmerie, sa garderie, plus ou moins luxueuses, ornées de sourires et de fleurs – un travail social sans société. »[4]
Le travail social a ainsi à trouver de nouvelles façons d’agir qui permettent d’initier « le processus de restitution aux gens de l’expression de leurs propres problèmes »[5], comme par exemple l’outil de l’enquête militante chère au travail communautaire. Contre l’individualisation et la normalisation, il doit favoriser les alliances avec la population dont on lui a donné la charge et s’impliquer dans la dénonciation des pratiques anesthésiantes auxquelles il est contraint, entrer en collaboration avec les luttes des populations exclues et participer « à la lutte idéologique contre toutes les formes de ségrégation »[6].
À quoi sert le travail social ?
Vingt-cinq ans après ces prises de position, certains des auteurs du numéro de 1972, aidés d’une nouvelle génération d’intellectuels[7], reprennent le travail d’analyse là où ils l’avaient laissé. Le propos s’est bien assagi depuis les soubresauts des années 1970. Dans un contexte nouveau, fait de crise économique latente et du début de la « racisation » des problèmes sociaux, le travailleur social a perdu son image de héros écartelé entre le mandat reçu de l’État et son désir d’œuvrer à l’émancipation des exclus. « Le travailleur social n’est plus dénoncé pour sa fonction supposée de gardien de l’ordre social mais suspecté par son public lui-même de ne pouvoir enrayer les conséquences d’une désorganisation sociale dont il s’estime la victime. »[8] Le travailleur social n’est plus au mieux l’allié, au pire l’amortisseur, entre l’usager et les institutions, il devient celui qui contrôle la stricte application des conditions d’accès et gère au plus près des limites (économiques, pénales, sociales) ceux qui sont rejetés par le système. « Par une étrange ironie de l’histoire, n’est-ce pas aujourd’hui seulement que les travailleurs sociaux font effectivement du contrôle social et fournissent un encadrement inutile pour leur public ?»[9], se demandent Donzelot et Roman.
En fait d’ironie de l’histoire, on pourrait aussi s’interroger sur ce qui s’est passé pendant ce quart de siècle pour que le commentaire porté sur le travail social, ses relations avec les pouvoirs publics et les usagers se soient autant transformés ? Est-ce le travail social seul qui a évolué ou tout autant la façon dont l’État est parvenu à gérer à la fois les personnes, de plus en plus nombreuses, à la marge du système, les professionnels chargés de s’en occuper et les spécialistes du commentaire ? On serait prêt à parier que l’écart mesuré entre ces deux numéros ne doit pas seulement à la transformation du travail social ou à la vision qu’en ont les usagers mais aussi, et peut-être en part aussi importante, à la transformation de la vision du monde de ceux qui ont la charge de les analyser.
Une façon intéressante de s’en rendre compte est de revenir aux résultats de l’enquête menée en 1998 auprès des professionnels[10]. Un premier élément qui permet de juger de ces transformations est l’apparition au cœur des années 1990 des nouveaux métiers de la ville et de l’insertion dédiés à la « médiation entre les habitants des zones urbaines défavorisées et les institutions d’intégration : école, police, justice, logement social, instances de formation et entreprises »[11]. En actant la fin du « romantisme social », Donzelot et Roman notent que « le problème de ces nouveaux professionnels n’est plus de dénoncer la société mais de la produire, c’est-à-dire d’obtenir des jeunes l’acceptation des normes nécessaires à la transmission des connaissances, à l’exercice d’une tâche, au respect des autres, et de faire passer dans la police, chez les élus et dans les entreprises le message d’une nécessaire renégociation de leurs normes, d’une meilleure explicitation de leurs objectifs. Plutôt que la défense des victimes du système, c’est la restauration du modèle d’intégration qui importe aux protagonistes des nouveaux métiers sociaux. »[12]
Le concept d’action sociale s’est donc radicalement transformé : non plus ramener dans la norme mais soutenir les projets individuels d’insertion, que ce soit à l’école, dans le quartier, en formation, à l’emploi. C’est la thématique de la fracture sociale entre ceux qui « en sont » et ceux qui n’en sont pas ou plus, dont il faut éviter l’agrandissement. Puisqu’il devient patent que l’économie n’est plus le principal ingrédient de la cohésion sociale, il est demandé au travail social de pallier à cette disparition. Le travail social a maintenant pour tâche de produire la société, « non plus en soumettant les individus mais en les sollicitant, en mobilisant leurs affects, leurs aspirations, leurs désirs, en misant sur eux, en leur demandant de faire exister la société par leur désir de prouver leur utilité lorsque celle-ci ne va plus de soi et qu’on ne sait plus quelle forme lui donner »[13].
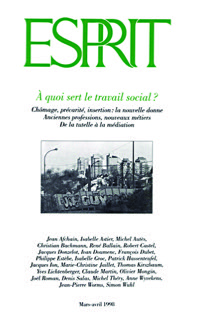
Les réponses au questionnaire mettent en évidence un second élément. La professionnalisation des métiers du social est achevée, les travailleurs « militants » ont disparu et la relation d’allégeance du secteur à l’État est fortement cadenassée. Bureaucratisation et contrôle accru du politique dessinent un nouveau contexte. Dès lors, les interrogations critiques portent moins sur les raisons que sur l’efficacité de l’intervention.
Le travail social apparaît comme une dernière chance de faire tenir un modèle socio-économique que l’on sent de plus en plus clairement en perte d’équilibre. Alors que la conception du « social » dont on hérite dans les années 1970 repose principalement sur l’idée d’une meilleure redistribution des bénéfices de la production en échange du respect des normes de vie capitaliste, les politiques sociales menées dans les années 1990 visent avant tout à garder intégrées à la société des personnes qui n’ont plus qu’un lien ténu avec cette société productive. Le concept de citoyenneté (le fameux « vivre ensemble ») prime sur celui de solidarité (la protection sociale).
Dans le même temps où les repères des missions confiées au travail social se brouillent, les frontières entre professionnels et bénéficiaires s’estompent. Un exemple canonique est le secteur de l’aide familiale dans lequel cohabitent l’aide aux personnes en perte d’autonomie et un travail d’insertion mené en direction des personnes peu qualifiées par le biais de la formation à ces métiers. L’action sociale se diffuse de plus en plus largement dans toutes les sphères de la vie en société et se voit attribuer un objectif de cohésion qui double, voire supplante, celui de la réhabilitation.
Défendre le travail social
Tout récemment, en Fédération Wallonie-Bruxelles, un groupe de travailleurs sociaux[14] a voulu poser un nouveau jalon dans cette histoire du travail social en tentant de redéfinir les fondements de leur travail. Le Manifeste du travail social est né en 2016 d’un processus collectif au sein de quinze secteurs de l’action sociale pour réaffirmer et défendre « les principes incontournables du travail social et (…) dénoncer la banalisation du non-respect de ceux-ci »[15]. Bien que cet appel se réfère exclusivement à la situation belge, il est le reflet d’évolutions présentes dans nombre de pays européens[16] et peut valoir comme point de repère dans une histoire générale des politiques publiques. Ce texte, comme ses équivalents français[17], pointe une série de problèmes et affirme des positions que l’on retrouve actuellement dans tout l’espace d’intervention du travail social francophone[18].
Le manifeste insiste d’abord sur l’inclusion de tous, le droit à l’autodétermination, le respect du secret professionnel comme fondement de la pratique, la recherche de la justice, de l’égalité et de l’équité par les politiques sociales et s’oppose à un travail social centré sur le contrôle, la garantie de l’ordre public et moral et la désignation des méritants. Au centre des revendications, se trouvent la reconnaissance de l’usager comme sujet, ultime décideur dans le cadre de l’intervention, et la nécessaire prise en compte du contexte aussi bien pour expliquer les causes de la situation vécue par l’usager que les possibilités qui lui sont ouvertes, l’autonomie et le développement du pouvoir d’agir de l’usager devant être les objectifs de la relation d’aide dont le fil rouge est la recherche de justice sociale. Dans ce cadre, la confidentialité est un repère de premier ordre et la base de tout travail en réseau.

De façon plus radicale encore, le manifeste proclame que « le travail social comporte une dimension critique et subversive qui passe par un nécessaire travail de transformation des structures et des politiques »[19]. En s’opposant frontalement aux effets des politiques néo-libérales et à la propagation des principes du nouveau management public dans la relation entre les professionnels et les usagers, ce manifeste, signé par près de 900 travailleurs à titre individuel et plus de 100 services ou organisations, marque peut-être le début d’un nouveau cycle de politisation de l’intervention, du moins dans une frange significative du secteur. À l’époque de l’État social actif, le discours critique porte cependant moins sur le travail social lui-même, vu comme dévoué auxiliaire de l’État dans son rôle répressif, que sur la façon dont ce dernier s’est allié avec « les marchés » contre l’usager. Dans ce paysage nouveau, le travailleur social devient alors un résistant qui œuvre en faveur du respect des principes de l’État de droit et de la justice sociale par la pratique même de son métier.
Notes
[19] Comité de vigilance en travail social, Manifeste du travail social, 2016, Bruxelles, p. 9.
POUR CITER CET ARTICLE
Référence électronique
