Marie-Thérèse Coenen (historienne, CARHOP asbl)
«L’université populaire de Bruxelles émerge, en février 2009, de la volonté de quelques acteurs issus des milieux associatif, syndical et universitaire, dont la collaboration en matière d’éducation et de formation d’adultes peu qualifiés dure depuis plus de 30 ans. Ce projet se veut un lieu des possibles et d’interactions entre les travailleurs du secteur associatif, entre les habitants du quartier et les associations, entre tous ceux qui partagent l’idée qu’il est nécessaire d’agir et de réfléchir contre le déterminisme social et éducatif qui entrave l’égalité des chances et des conditions »[1]. Nous rencontrons à Saint-Gilles, dans les locaux du Centre Formation Société (CFS), Alain Leduc et Matéo Alaluf[2], deux promoteurs de cette initiative.
L’université populaire du 21e siècle s’inscrit dans un contexte où la démocratisation des études et le développement de l’éducation permanente sont devenus une réalité tangible. Se pose alors la question de l’intérêt d’un tel projet si on met de côté celui d’assister à des conférences intéressantes et d’acquérir ou entretenir un certain savoir. Plutôt que de démocratisation, Matéo Alaluf préfère parler de « démographisation » des études. « Hier », souligne-t-il, « les études s’adressaient à une élite. Aujourd’hui, le public s’est élargi. Quand j’étais étudiant, il y avait la jeunesse travailleuse et la jeunesse étudiante. La scolarité obligatoire allait jusqu’à 14 ans, mais déjà à 16 ans et surtout à 18 ans, la plupart quittaient l’enseignement. À la fin du secondaire, beaucoup n’étaient déjà plus là. Aujourd’hui, avec l’obligation jusqu’à 18 ans, la jeunesse est scolarisée et il n’y a plus cette distinction. Mais la scolarisation des uns n’est pas celle des autres. Elle est très inégale. Ce n’est pas parce que les jeunes sont à l’école qu’il y a une démocratisation des études. Il y a un passage à l’école et ce n’est pas pour cela que les inégalités scolaires sont moindres que les inégalités sociales qu’il y avait avant cette « démographisation ». Les études des uns ne sont pas celles des autres. »
L’Université populaire de Bruxelles s’ancre à la fois dans le temps court, le renouveau des universités populaires en France à partir de 2003, et dans le temps long, puisque ses racines plongent dans les initiatives de démocratisation de l’enseignement et de la formation qui mobilisent les gauches dans les années 1960 et suivantes. Nous aborderons donc dans une première partie, les expériences et les options fondamentales en matière de formation d’adultes qui ont amené les partenaires de l’Université populaire de Bruxelles à lancer cette nouvelle initiative socioculturelle, dont la genèse et les objectifs seront traités dans un deuxième temps.
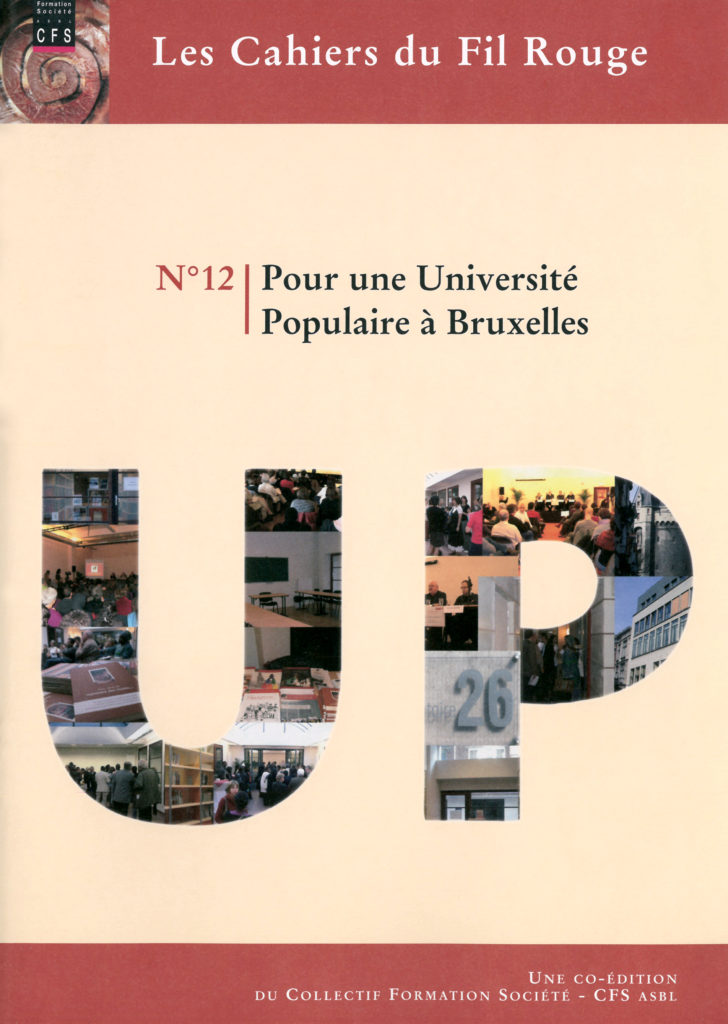
Pour Matéo Alaluf, les racines de l’université populaire du 21e siècle remontent aux années 1960, autour d’une certaine idée de la démocratie culturelle et de l’ouverture de l’université aux classes populaires. Il est alors assistant à l’Université libre de Bruxelles et président de la CGSP-ULB. Ensuite il deviendra enseignant et responsable de l’Institut des sciences du travail à l’ULB. « Fin des années 1960, nous avions la volonté d’ouvrir l’université aux classes populaires. Elle était fermée aux classes populaires comme aux classes d’âges. Nous voulions transformer l’université et discutions d’un projet de licence comme cela se faisait à la FOPES (UCL). Nous connaissions Émile Creutz ainsi que l’expérience de l’Open university en Angleterre. René De Schutter, secrétaire de la Régionale de la FGTB de Bruxelles[3], devient membre en 1971 du Conseil d’administration de l’ULB et nous soutient. Dans notre projet, le programme ne devait plus suivre une approche « académique » par champs disciplinaires, mais un regroupement sur des matières avec une approche interdisciplinaire. Pour donner cours, il ne fallait ni être docteur ni avoir un titre académique. On voulait le changement ».
En plus d’un programme interdisciplinaire et des enseignants « non académiques », il est nécessaire, pour avoir une véritable ouverture, donner accès à des candidats-étudiants peu diplômés, mais ayant une expérience.
Début 1970, l’ULB souhaite s’implanter en Wallonie. L’occasion d’ouvrir un programme universitaire à destination des adultes débouchant sur un diplôme est saisie. À Nivelles, qui voit la première expérience, l’orientation proposée est la licence en sciences du travail à horaire décalé avec comme finalité la « Gestion de la formation et de la transition professionnelle ». L’expérience est menée avec le Centre socialiste d’éducation permanente (CESEP). À Charleroi, c’est une licence en sciences du travail à horaire décalé qui est proposée avec l’orientation « Développement social ».[4] Le public visé est celui des animateurs-formateurs. L’accès par des passerelles et sur dossier – par la valorisation de l’expérience – doit permettre à un public de non-universitaires d’accéder à la formation qui se déroule à horaire décalé et en décentralisation.[5] Matéo Alaluf précise : « à Nivelles, nous avons fait la première expérience inter-facultaire avec des découpages de programmes qui ne se voulaient pas disciplinaires. Mais très vite, la structure académique a repris le dessus dans les procédures de nominations et ensuite dans les contenus. Le poids institutionnel était tel qu’ils ont eu raison de ce que nous pensions et voulions ».
Sur le plan pédagogique, les travaux de Bertrand Schwartz[6] sont une source d’inspiration, mais c’est surtout le CUCES (Centre universitaire de coopération économique et sociale) à Nancy et sa vision de l’éducation des adultes qui les intéressent. Le CUCES partait des savoirs et des compétences des personnes. Ainsi, un cours « coupe couture » pouvait devenir le point de départ pour construire un nouveau savoir. C’est aussi la découverte de la non-directivité : « nous avons tenté », poursuit Matéo Alaluf, « de l’appliquer dans nos pratiques professionnelles et militantes. D’une part, l’idée que le savoir était chez les gens a été très importante dans la formation syndicale où le formateur, l’animateur n’était là que pour développer les idées qui étaient exprimées autour de la table. D’autre part, nous souhaitions implémenter ces méthodes même dans l’Université. Même si l’Université peut capter les innovations et a une certaine capacité d’absorption des idées, nous avons rencontré quelques difficultés pour faire accepter ces méthodes d’apprentissage».
1970 : L’université syndicale à la FGTB-Bruxelles-Hal-Vilvorde-Liedekerke
Pour Alain Leduc, l’intérêt pour la formation d’adultes remonte à sa participation à l’Université syndicale mise en place par la FGTB de Bruxelles, à l’initiative de René De Schutter, au début des années 1970. Camille Deguelle[7] en était le président. Cette formation de haut niveau, l’Université syndicale, comme l’avaient appelée les délégués, avait pour objectif de valoriser la promotion collective, mais non individuelle, l’évaluation collective, le refus d’une sanction par diplôme, et enfin une approche critique de la connaissance contre la simple transmission d’un savoir théorique ou technico-pratique.[8] « Comme militant », dit-il, « j’ai participé à l’Université syndicale. On voulait apporter aux délégués autre chose que des formations techniques, une certaine compréhension du monde économique et syndical : comprendre l’économie, la sociologie, comprendre le monde, mais dans la mesure où il y avait la volonté d’intégrer les militants migrants à la FGTB non seulement comme affiliés, mais aussi comme délégués syndicaux, nous nous sommes rendus compte qu’il y avait des problèmes de lecture et d’écriture. C’est comme cela que sont nés les cours d’alphabétisation pour les immigrés, pour les Espagnols en 1969 et les Marocains en 1971 ». [9] Les références théoriques mobilisées sont Pierre Bourdieu (1930-2002) avec « l’héritage et la reproduction »[10] et Paulo Freire (1921-1997) avec ses écrits sur l’éducation populaire[11]. « C’était important pour nous. Dans le groupe d’alphabétisation, il y avait beaucoup de chrétiens de gauche qui étaient branchés sur la théologie de la libération. Nous formions une équipe très militante et riche [de ses composantes]. Cette expérience d’université syndicale est, pour moi, un embryon d’université ouverte. Il s’agissait de travailler la question du savoir avec les gens en commençant par le niveau le plus bas, c’est-à-dire apprendre à lire, à écrire, à compter. » Le lien avec la FGTB de Bruxelles subsiste dans l’université populaire contemporaine puisque la FGTB reste une composante fondatrice de l’Université populaire à Bruxelles.
1982 : DÉFIS asbl[12]
Une nouvelle étape commence au début des années 1980, avec la conception et la mise en œuvre du projet de DÉFIS. Partant de l’expérience de la FUNOC[13] à Charleroi, le projet se dessine à partir d’un dispositif d’université ouverte qui permet à chacun de démarrer un parcours de formation à partir du niveau où il est et de progresser jusqu’au niveau où il veut arriver. Soutenu par le secrétaire général de la Communauté française, Pierre Van Bergen, et par les deux organisations syndicales, il se concrétise par la signature de conventions avec la FUNOC à Charleroi, Canal Emploi à Liège, RTA [Réalisation-Téléformation-Animation] à Namur et DÉFIS à Bruxelles. Ce qui est commun aux 4 organisations − c’est une caractéristique de ce projet − c’est le lien avec les organisations ouvrières et les universités, en tout cas avec des personnalités universitaires. À DÉFIS, ce lien est fait avec Éric Bockstael (UCL-FOPA) et Matéo Alaluf (ULB), qui sont coprésidents de l’asbl. À DÉFIS, les associations sont membres de l’assemblée générale, ce qui permet d’articuler le projet aux initiatives existant sur le terrain (collectif Alpha, CIEP-MOC, Le Grain asbl, etc.).[14] Dès 1983, DÉFIS lance une campagne de sensibilisation à l’alphabétisation avec le soutien de la RTBF. Le secteur de l’alphabétisation s’autonomise avec la mise en place du mouvement Lire & écrire. Le volet « exclusion scolaire », porté par des associations, se prolongera avec la mise en œuvre des Zones d’éducation prioritaire (ZEP) dans les quartiers populaires, à la fin des années 1980. Canal Emploi et RTA mobilisent la vidéo comme outil d’éducation permanente. À Bruxelles, DÉFIS collabore avec le vidéobus de Bruxelles (CVB). « On a fait », se souvient Alain Leduc, « une vingtaine de films sur l’alphabétisation et plusieurs films en lien avec les thématiques que nous portions ».
1985 : Le Collectif formation société (CFS)
Un autre partenaire, berceau de l’Université populaire de Bruxelles, est le Collectif formation société (CFS). Constituée en asbl en 1986, l’association répond aux demandes de personnes engagées dans l’action associative ou syndicale en vue d’acquérir la formation suffisante pour comprendre la société dans laquelle elles vivent. « Le CFS a la volonté de lutter contre le déterminisme social et pour le droit à l’éducation pour tous. »[15] À ce titre, l’association développe des accompagnements et des formations pour permettre aux « apprenants » de s’engager dans la reprise d’étude ou dans l’acquisition d’un diplôme ou encore dans le désir d’aller vers des formations qualifiantes. « Au point de départ », précise Alain Leduc, « ce sont quelques dizaines de travailleurs qui souhaitaient reprendre des études tout en étant au travail. Le nom, Collectif formation société, a été choisi par les participants. Qu’est-ce qu’on veut ? Nous sommes un collectif parce qu’on est ensemble. Quel est notre objet ? La formation. Qu’est-ce qu’on cherche ? Nous voulons être dans la société et la transformer. Ces trois mots n’ont pas en soi une grande portée, mais avaient du sens pour eux ». Il faut se rappeler le contexte. Un projet d’université ouverte se discute à Charleroi. Des filières de formation comme la FOPES (Faculté ouverte de politique économique et sociale) se mettent en place pour le monde ouvrier, ce qui est rare. Le Collectif formation société (CFS) sera une réponse du monde socialiste. Il s’agit de lutter contre les déterminismes sociologiques et de proposer à des adultes l’accès aux études et aux certifications existantes. La FGTB soutient le projet en accordant le congé éducation aux « étudiants ». « C’est l’objectif de notre travail », précise Alain Leduc, « Nous partons des publics les plus en difficulté, même analphabètes, et nous les préparons aux filières d’accès aux études, de tous niveaux. »
Une université populaire : Pour qui ? Pourquoi ? Pour faire quoi ?
En 2008, Alain Leduc s’intéresse aux universités populaires telles que lancées en 2002, à Caen, par Michel Onfray, mais les critères retenus sont pour lui minimalistes : la gratuité, pas de diplomation et une structure pédagogique de deux heures : une heure pour l’exposé, une heure de débat. Le quatrième axe l’intéresse : les universités populaires ont vocation à essaimer ce qui ouvre une porte à d’autres initiatives. « La plupart des universités populaires, nées dans ce sillage », précise-t-il, « ont été en rupture totale avec Onfray. Elles se situent entre un pôle tout à fait critique à pas du tout critique ».
Le réseau des Universités populaires
Depuis 2004, les UP françaises organisent le Printemps des Universités populaires. Alain Leduc participe à celle qui se déroule à Saint-Brieuc, en Bretagne, du 19 au 21 juin 2008. Le thème de la rencontre porte sur le lien entre le rapport au savoir et le rapport au pouvoir. Le pouvoir, c’est notamment le pouvoir politique des élus et le pouvoir intellectuel des universitaires.[16] Il s’agit entre autres de questionner la subordination aux subventions et aux locaux et l’indépendance des UP. Il rencontre des personnes impliquées dans des milieux politiques très différents : anarchistes, communistes, écologistes, etc. « Tous discutaient avec un respect mutuel et un plaisir de partager ce qu’ils faisaient les uns et les autres et cela pendant 3 jours. J’étais très stimulé. »
Le 4e Printemps des Universités populaires se déroule à Bobigny du 26 au 28 juin 2009 avec, comme sujet de débat, la coopération avec le tissu associatif et l’éducation permanente. Deux tendances se profilent : « ceux qui avancent une conception des UP pour « démocratiser le savoir », le rendre accessible comme base de la citoyenneté consciente et critique (conception républicaine de l’idéologie des Lumières du 18e siècle) avec des accents libertaires… et ceux qui défendent une conception plus sociologique, orientée prioritairement vers les classes populaires, culturellement défavorisées, le peuple au sens de Marx, plus dans la tradition historique des UP du mouvement ouvrier et c’est », souligne Michel Tozzi, « le cas de l’UP de Bruxelles ».[17] Alain Leduc intervient avec l’idée de la certification et du diplôme. Le sujet divisait, se souvient-il : « j’ai été contré pendant les 3 jours avec des arguments assez stéréotypés : « L’université est pourrie ; c’est la bourgeoisie et le capitalisme qui veulent les diplômes ; le diplôme ne traduit pas ce que l’on sait ». »
Jean Louis Le Grand, professeur en sciences de l’éducation à l’Université Paris 8, intervient le dimanche et présente son projet d’université populaire, prévu pour septembre 2009. Il propose d’adosser l’Université populaire à l’Université scientifique de Paris 8. La formation de 2 ans aboutit à un diplôme de licence en sciences de l’éducation (niveau bac+2). Ensuite, une passerelle existera pour entamer une licence+3 dans l’établissement. Il n’y a pas de condition de diplôme à l’entrée (valorisation des acquis de l’expérience). Il n’y a pas non plus de cours. Un cursus où il n’y a pas cours ! Les personnes qui s’inscrivent sont des apprentis chercheurs.[18] Les séances se tiennent tous les samedis, car les « formateurs » sont quasiment tous des bénévoles et l’Université n’affecte que très peu d’heures à l’expérience. La première année, ils travaillent leur histoire de vie en faisant émerger les questions qui leur tiennent à cœur et les approfondissent. Dans un deuxième temps, ils prennent une question de recherche qu’ils développent et se donnent une architecture du savoir nécessaire pour la traiter.
Alain Leduc est plus qu’intéressé : « je trouvais cela remarquable. J’ai été deux à trois fois par an à Paris pour voir comment ils faisaient et j’assistais aux travaux de fin de session. C’était passionnant ». Michel Tozzi, dans son compte-rendu du Printemps des UP, souligne l’innovation : « jusqu’à maintenant », écrit-il, « les UP se sont développées hors universités classiques. Une fois de plus, Paris 8 (ex-Vincennes) innove pour ses 40 ans en créant une UP « pour l’éducation populaire du 21e siècle », interne à l’Université, fortement adossée à un partenariat associatif et s’adressant à des non-bacheliers décrocheurs et de nouveaux retraités motivés. Ceux-ci seront considérés comme des chercheurs-animateurs (avec des méthodologies de recherche), détermineront eux-mêmes leur programme et choisiront leurs intervenants, le tout débouchant sur un diplôme d’université (DU). Or la plupart des UP représentées sont non qualifiantes, fondées sur le bénévolat des intervenants et la gratuité des auditeurs-participants, ce qui a été interrogé par l’UP de Bruxelles, pour laquelle tout public populaire a besoin de diplômes pour se professionnaliser et pas seulement de bénévoles ou de militants. »[19] Après 4 ans (2008-2012), l’Université de Paris 8 met fin à l’expérience. Pour garder une trace, Alain Leduc propose d’en publier le bilan[20]. Il démontre ainsi que former, même à la lecture et l’écriture, s’inscrit dans une démarche d’éducation permanente.
Au CFS, la méthode d’apprentis chercheurs est désormais mise en œuvre. En début de cycle, les personnes se mettent en réflexion sur leur vie, sur leur trajectoire et leurs motivations à la reprise d’étude. Ils découvrent ce qui est essentiel pour eux. Ensuite, ils travaillent cette question et se préparent à mener leur projet pour atteindre leurs objectifs. Ils démarrent une formation en sachant pourquoi ils le font et quelles sont leurs questions de manière à articuler leurs attentes aux réponses puisées dans les contenus de la formation. Pour Alain Leduc, la démarche idéale est la suivante : « des personnes de milieu populaire se mettent dans une posture de recherche. On les accompagne. Ensuite, ils échangent entre eux à partir de leurs expériences de vie qu’ils confrontent au savoir scientifique et universitaire. Petit à petit, s’élabore, à partir de ce qu’ils savent, un savoir. C’était le principe de l’Université syndicale. On commençait avec ce que les délégués apportaient de leurs expériences de travail, sur l’entreprise et du système. Ensuite, on articulait la formation à leurs connaissances. C’est aussi la démarche de Paulo Freire, qui part des savoirs des gens. »
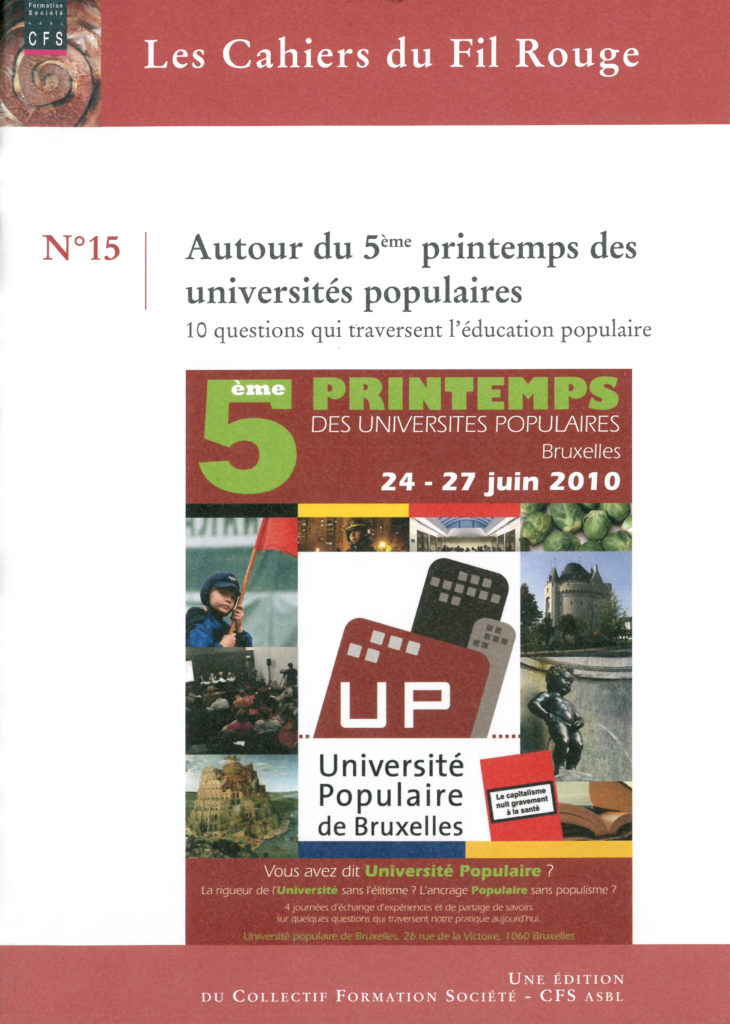
Les 24 au 27 juin 2010, l’Université populaire de Bruxelles accueille le 5e Printemps français des Universités populaires[21]. Une des thématiques porte sur la certification des apprentissages comme enjeu pour les universités populaires. Le programme concocté par l’UP de Bruxelles prévoit la visite d’une école de promotion sociale et la remise des diplômes. Il s’agit d’introduire à l’atelier 2 qui portera sur la certification. Alain Leduc est convaincu que c’est une forme d’élitisme : « ce sont les diplômés qui trouvent que le diplôme à l’UP est inutile. À un moment donné, les arguments ne passent plus. Il faut vivre l’émotion ressentie par les apprenants, lors de la remise de leur premier diplôme avant de prendre position, pour ou contre ». Le vendredi matin, l’atelier « Certifier les apprentissages-mêmes critiques ! d’adultes en milieu populaire, n’est-ce pas un combat pour les UP ? » est animé par Alain Leduc et Thierry Walravens. Dans la synthèse publiée dans Les Cahiers du fil rouge, Corinne Terwagne met en avant la valeur symbolique forte d’un diplôme puisqu’il s’agit de la reconnaissance officielle et externe des apprentissages effectués ainsi que du parcours établi. La certification constitue donc une reconnaissance sociale qui produit en outre des effets de droit, notamment des accès à certaines catégories d’emploi : « en ce sens, la certification représente une forme de passage initiatique où le diplôme témoigne aux yeux de tous des savoirs accomplis »[22]. Fidèle rapporteur des Printemps, Michel Tozzi souligne, dans ses conclusions, cette tension non résolue autour de la diplomation, quant à savoir si c’est une finalité à poursuivre au sein des différentes UP.[23] « Les universités alternatives françaises, à la suite de Caen, ont par ailleurs choisi la rupture avec l’université classique qui délivre des diplômes, comme le font d’autres UP plus anciennes qui travaillent sur l’éducation permanente […] L’UP de Bruxelles a insisté sur cette importance de la certification pour des publics défavorisés, reconnaissance sociale et symbolique de compétences acquises (ce sont les diplômés qui trouvent le diplôme à l’UP inutile !). Il y a là tension au niveau des finalités poursuivies. »[24] Il reconnaît en 2011 l’apport de l’UP de Bruxelles au débat avec des questions qu’elles ne s’étaient pas posées : l’importance de la certification pour un public plus populaire, pour les sans diplôme, la place des intellectuels par rapport aux classes populaires dans les UP, le rôle des nouvelles technologies en utilisant les médias citoyens (conférence filmée ou plateforme collaborative…).[25]
2009 : l’Université populaire de Bruxelles est sur les rails[26]
Entre-temps, l’Université populaire de Bruxelles est lancée en 2009. Elle s’appuie sur plus de 30 ans d’expérience associative avec un public multiculturel, sur la dynamique lancée par le mouvement des Universités populaires en France et plus particulièrement sur l’expérience de Paris 8 Saint-Denis. Pendant une année, un groupe se réunit et ébauche son propre projet d’université populaire. Les partenaires sont des compagnons de route qui partagent depuis longtemps les mêmes principes et valeurs en matière d’éducation populaire et d’émancipation culturelle. Ce sont des syndicalistes de la FGTB de Bruxelles, des personnalités issues du milieu universitaire (ULB) et des Hautes écoles sociales (anciennement EOS) et le CFS comme association d’éducation permanente.
L’Université populaire de Bruxelles commence ses activités. Elle s’est donné une structure avec une assemblée générale, un conseil d’administration et un bureau chargé d’établir le programme. Le financement vient en partie de la FGTB, pour environ 5 000 €. Le budget, bon an mal an, tourne autour de 10 000 €. Les locaux, 26 rue de la Victoire à Saint-Gilles sont ceux du CFS et d’autres associations[27].
Le programme de l’Université populaire est varié. Les grandes conférences sont un produit d’appel pour atteindre un large public, mais une conférence comme celle de Robert Castel, par exemple, a alimenté la réflexion sur le précariat pendant deux ans. Chaque conférence « universitaire » est l’occasion d’approfondir le thème en groupe et se prolonge sur le terrain de l’éducation permanente. Il y a des ateliers de pensées collectives qui se réunissent trois à quatre fois par an comme le cours de philosophie animé par Isabelle Stengers. Un groupe du Collectif Alpha a analysé des approches pédagogiques. Il y a la présentation de films avec une analyse sociale, des conférences gesticulées, du théâtre…
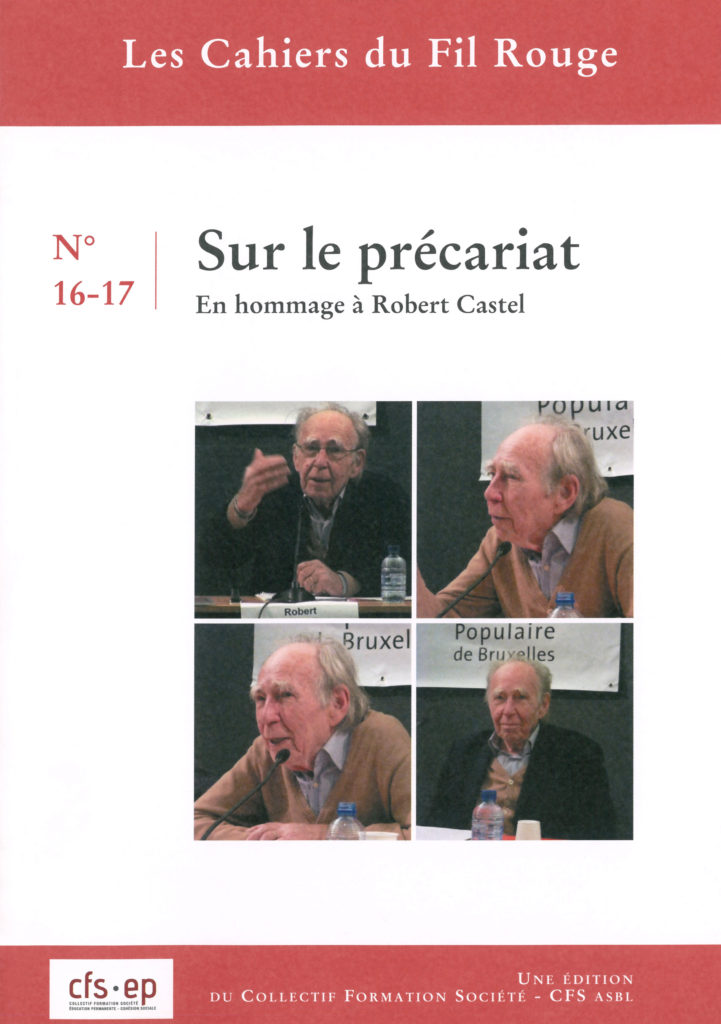
La préparation à la reprise d’études reste une activité importante. Elle accompagne la valorisation des acquis de l’expérience (VAE) car elle permet à certains et certaines d’alléger leur programme d’études. La préparation du CEB rencontre du succès.
L’Université populaire est aussi un lieu de recherche. Alain Leduc insiste : « Nous avons développé depuis quelques années une réflexion sur la dimension « populaire » de nos programmes. Nous démarrons pour la troisième année la réflexion sur le « comment la recherche peut être utile ». Même si ce n’est pas une fonction essentielle de l’Université populaire, elle a sa place. Nous mettons l’accent sur la reprise d’étude et sur la recherche, mais restons attentifs à ne pas dévoyer une démarche d’éducation populaire ».
L’Université populaire est un lieu ouvert à des organisations et à des thématiques diverses et les demandes sont nombreuses pour organiser une animation. Le lieu s’y prête, mais c’est aussi une valorisation du projet de l’Université populaire. Alain Leduc exemplifie cette posture avec une journée d’information sur la problématique des transgenres. Avec ce sujet difficile, les organisateurs sont heureux de pouvoir disposer de l’infrastructure. « Si quelqu’un vient avec un projet », conclut Matéo Alaluf, « il peut aisément le réaliser même si cela n’attire que quelques personnes. L’essentiel, c’est l’activité et la volonté de faire quelque chose ».
Le public est très divers. Il y a des différences d’âge, de sexe, d’origine et d’origine sociale et de formation. C’est un public de proximité, attaché au lieu et qui exprime une certaine fidélité si pas un sentiment d’appartenance. Les participants viennent aussi chercher un regard, une analyse critique. Ils ne veulent pas être enfermés dans un discours, fût-il syndical, ni être sous l’emprise des universitaires. L’UP doit être ce lieu où le débat est possible, où des positions contradictoires peuvent s’exprimer. Sur une saison, les approches sont très différentes les unes des autres et le public a la garantie de ne pas être emprisonné dans une idéologie. Les grandes conférences sont filmées et disponibles sur le site de l’UP et … sont très regardées. Elles sont la trace de l’évènement, mais permettent aussi leur utilisation future par les groupes de travail. « C’est la chose la plus simple que nous pouvions faire avec nos moyens », reconnaît Alain Leduc[28].
Une université populaire s’inscrit-elle dans un projet de changement social ?
Pour Alain Leduc, le savoir n’implique pas naturellement le changement social. « Les gens ne sont pas plus généreux, plus solidaires parce qu’ils sont formés. » À l’inverse, les savoirs sont indispensables pour comprendre la société. Les personnes ont des savoirs implicites. La force de transformation sociale émerge quand on travaille ces savoirs et qu’on les confronte aux savoirs disciplinaires. « Cette force », souligne Alain Leduc, « est essentielle car elle recèle une capacité de mobilisation et de changement social ». lorsqu’une personne définit son projet et le maîtrise, elle devient capable de changement qui peut aboutir à l’action sociale. « Cette démarche, qui passe par la formation, est extraordinaire. C’est un très bel engagement. C’est une force. C’est cela aussi la démocratisation de la culture. »
L’Université populaire de Bruxelles est le fruit d’un engagement militant de syndicalistes, de responsables d’association ou d’enseignants universitaires ou non, qui plonge ses racines dans les expériences de formations syndicales avec des pédagogies participatives et non directives. Ce qui peut donner la petite ouverture aux études universitaires à des personnes non diplômées. Viennent se greffer sur cette base militante un projet d’éducation permanente en alphabétisation et la préparation à la reprise d’étude pour ceux et celles dont les parcours de vie les en avaient privés. « L’Université populaire », écrit Philippe Van Muylder de la FGTB, « est indissociable du mouvement social bruxellois et s’inscrit dans les options fondamentales du syndicalisme contemporain : notre organisation doit mobiliser ses moyens d’éducation permanente et de formation des travailleurs. Il faut développer l’esprit d’analyse et de critique et donner aux travailleurs les moyens de comprendre – et d’agir sur – les évolutions de la société »[29]. Pour lui, l’Université populaire est aussi l’outil de formation et d’information nécessaire aux militants qui leur permet de croiser les regards avec d’autres acteurs de changement, pour échafauder de nouvelles alliances. D’autres, motivés par la volonté légitime de promotion sociale, souhaitent reprendre des études. L’Université populaire de Bruxelles ouvre à ces nouveaux possibles.
Notes
[29] « 11 priorités pour une ville ouverte et solidaire, résolution du Congrès statutaire du 15 mai 2006 de l’Interrégionale de Bruxelles de la FGTB », Les Cahiers du fil rouge, n°12, novembre 2009, p. 23.
POUR CITER CET ARTICLE
Référence électronique
