Claudine Liénard (militante féministe et écologiste, ex-coordinatrice de projets à l’Université des femmes)
Évoquer l’histoire de l’Université des femmes constitue un exercice périlleux. Les archives restent à exploiter. Les souvenirs des fondatrices se colorent de leurs ressentis, différents et particuliers. Chaque anecdote, chaque récit constituent autant de fils à nouer, à tisser pour former un tableau à la manière féministe : apparemment sans ordre ni beaucoup de cohérence mais qui finit par offrir un décor où chacune peut se situer et agir. Fort heureusement, l’association a posé ses propres repères historiques, à l’occasion de ses trente ans soulignés le 24 mai 2012 par un colloque dont les interventions ont été publiées. Historienne et cofondatrice, Hedwige Peemans-Poullet y a évoqué la nécessité, à la fin des années 1970, de nourrir le mouvement féministe qui se déployait, d’une pensée construite à partir de recherches et d’études de niveau scientifique. Le monde universitaire belge n’offrant ni terreau favorable ni opportunités, c’est au sein du monde associatif militant que des femmes constituent un point d’appui à des colloques, des débats, des publications. L’association prendra le nom crânement assumé d’Université des femmes[1].
En Belgique particulièrement, le mouvement féministe fonctionne avec des structures temporaires et recomposées au gré de l’actualité des combats à mener (plate-forme « Créances alimentaires » ou « Contre la répudiation », dénonciation des publicités sexistes, refus de la prostitution et des inégalités salariales, etc.), avec des associations nombreuses et diverses (de l’ONG à l’association de fait, de la structure émanant des services publics au groupuscule activiste). Il parvient aussi à pérenniser son action via des organisations plus solides comme le Comité de liaison des femmes où syndicalistes, enseignantes et associatives élaborent leurs positions communes ou via l’institutionnalisation de la démarche dans des organes d’avis officiels tels que le Conseil fédéral de l’égalité des chances[2]. Globalement, il a su construire et garder des modes de fonctionnement sans « vedette », sans trop de hiérarchie, souples et le plus souvent accueillants aux femmes en difficulté, sans ou étudiantes. Malgré la pression politique, administrative voire économique et les mises au pas pour fonctionner dans la légalité, il s’est inscrit vaille que vaille dans le paysage institutionnel belge communautarisé, régionalisé, etc., tout en maintenant une solidarité, des temps et des lieux de convergence, en partageant des outils, des expériences, des savoirs et des savoir-faire. Sans doute, l’analyse politique constante du contexte de domination masculine qui prévaut encore largement dans les institutions belges et, plus largement, dans son organisation sociale, permet de dépasser les incitations à la concurrence associative et de maintenir le sentiment d’une nécessaire cohésion et d’une solidarité féministes.
Cela n’explique pas tout. Il y a aussi, actifs, pensés et sans cesse (re)construits, la volonté et le goût des femmes pour « un mouvement social et politique qui concerne la moitié de l’humanité, mais qui n’a ni fondateur ou fondatrice, ni doctrine référentielle, ni orthodoxie, ni représentantes autorisées, ni parti, ni membres authentifiés par quelque carte, ni stratégies prédéterminées, ni territoire, ni représentation consensuelle, et qui, dans cette « indécidabilité » constitutive, ne cesse de déterminer des décisions, imposant aujourd’hui son angle d’approche et son questionnement à travers le monde »[3]. Ce goût de la multiplicité féconde des sources et des expressions qui a marqué les débuts du féminisme, reste présent dans les collectifs et actions qui dynamisent actuellement ce mouvement. À celui-ci d’offrir aux femmes qui font face ensemble, aujourd’hui, aux défis des inégalités, des références nombreuses et diversifiées. Car aucune personnalité emblématique, fût-ce Françoise Collin citée ici, ne suffit à polariser seule un mouvement dont la diversité constitue à la fois l’âme et le carburant.
Entre élaboration de la pensée et analyses féministes
Dans ce mouvement, l’Université des femmes garde une réputation et une pratique d’élaboration de la pensée et des analyses féministes qu’elle entretient grâce à des cycles de formation, à ses publications et à sa Bibliothèque Léonie La Fontaine[4]. Son champ associatif se situe entre les mondes académiques, administratifs, politiques et militants. Acquise aux enjeux de l’éducation permanente à destination des adultes, elle atteint les publics populaires en formant celles et ceux qui sont en première ligne de l’éducation, la formation et l’animation. Son activité de base – un cycle de conférences-débats thématiques ouvert à tous et toutes – continue à les mettre en contact avec les chercheur.se.s et praticien.ne.s de terrain qui proposent des travaux élaborés avec les outils du féminisme : analyse de genre, attention aux stéréotypes, valorisation des apports des femmes. Ce n’est pas un hasard si l’offre formative se calibre sur les séminaires universitaires. À ses débuts, cela se limite à des thèmes annuels déclinés dans des conférences organisées le jeudi soir dans les locaux de l’école Parallax, place Quételet à Saint-Josse-ten-Noode, et donnant parfois lieu à publication dans la revue de l’association, Chronique féministe. Hedwige Peemans-Poullet l’organise ensuite dans un format plus long, déployé en une douzaine de séances où chercheur.se.s et praticien.ne.s approfondissent un sujet avec une approche de genre. Cette « formation longue » thématique échouera à obtenir une reconnaissance académique, mais finira néanmoins par bénéficier d’une solide réputation. Des dossiers bibliographiques et les articles enrichissent chaque séance grâce à l’apport de l’équipe de la bibliothèque réunie autour de Sabine Ballez, bibliothécaire-documentaliste, et les interventions sont largement diffusées par leur publication dans une collection éditoriale de l’association, les Pensées féministes.
Il s’agit donc de montrer que les recherches féministes doivent entrer dans les cursus académiques à l’instar des Women’s studies qui prennent forme aux USA et dont l’Université des femmes se revendique : « Issues du mouvement des femmes des années 70, les Women’s studies avaient pour objectif de prolonger la critique de la place faite aux femmes dans la société par la critique des discours légitimant leur exclusion. Dans un contexte général de développement des études sur les minorités, les féministes universitaires ont obtenu, à une large échelle, avec l’appui des étudiantes, la création d’enseignements sur les femmes et de Women’s studies interdisciplinaires »[5]. Le développement de séminaires de formation, de colloques internationaux, de cycles de conférences répétés et diversifiés année après année n’aura pas été vain. De même que l’étude de faisabilité développée en 2011 par l’association féministe et bicommunautaire Sophia. Il aura fallu plus de quarante ans pour que les féministes obtiennent finalement l’ouverture – pour l’année académique 2017-2018 – d’un master en études de genre interuniversitaire en Belgique.
Un contexte propice à la naissance de l’Université des femmes
Comment l’Université des femmes en est-elle arrivée à sa position actuelle dans le champ sociopolitique belge voire étranger et quels évènements ont formé le terreau de ses débuts ? En 1970-71, Françoise Collin, philosophe et écrivaine passionnée par les écrivaines, ouvre sa grande maison bruxelloise à des réunions de femmes soucieuses d’échanger sur leurs conditions de vie et, à partir de ce matériau, de construire une « prise de conscience » collective. Leur démarche s’inscrit dans le contexte de l’époque. En France, le bouillonnement social et culturel suscité par les révoltes étudiantes de « mai 68 » n’est pas retombé et fait tache d’huile. Des femmes se lèvent pour réclamer leur « libération » et développer les luttes pour la maîtrise de leur fécondité. Le Mouvement de libération des femmes, le célèbre MLF, se constitue. Quelques courageuses vont en chœur fleurir la femme du soldat inconnu sous l’Arc de triomphe à Paris. Des manifestations, des grèves du travail ménager forcent les médias et les politiques à prendre les demandes des femmes en considération. En Belgique, les ouvrières de la Fabrique nationale de Herstal vivent les changements durement obtenus par leur longue grève de 1966[6] qui a montré à tous le profond désir des femmes d’être des travailleuses, des citoyennes à part entière, et ouvert le combat européen pour l’égalité de salaire, combat soutenu tout au long de sa carrière par l’avocate Eliane Vogel-Polsky[7].

Le planning familial se bat pour sortir l’interruption volontaire de grossesse de la clandestinité. La première campagne en faveur du vote pour des femmes se déploie en 1970 dans tout le pays à l’occasion de l’élection des conseils communaux. Sur le modèle des Hollandaises, le mouvement des Dolle Mina’s s’affiche et s’active en Flandre, pourfendant la domination masculine de manière ludique et spectaculaire.[8] Sur l’incitation d’une de ces activistes flamandes, Chantal De Smet, l’hennuyère Jeanne Vercheval les imite bientôt en Wallonie avec le groupe des Marie Mineur[9]. Elle participe aux réunions bruxelloises chez Françoise Collin, faisant lien entre les échanges théoriques et les aspirations des femmes actives dans les usines et les ateliers.
Les actions collectives s’enracinent le plus souvent dans un sentiment partagé d’injustice sociale. « En Flandre, le mouvement des femmes s’est rapidement articulé en un espace de coopération entre les femmes progressistes de différents milieux politiques, sociaux et culturels, soutenant la logique de réforme et l’institutionnalisation du féminisme »[10], mais du côté francophone et en tout cas, dans le groupe qui se constitue à Bruxelles, les choses sont différentes. Françoise Collin n’a pu valoriser son doctorat en philosophie, son mari titulaire de la même formation ayant été préféré par l’université qui s’interdit de nommer un couple. Hedwige Peemans-Poullet a dû obtenir son doctorat d’histoire à Paris faute notamment de pouvoir imposer dans ses travaux à l’Université catholique de Louvain la référence à la sociologie de Karl Marx et la reconnaissance de ses apports. « Mai 68 » a poussé jusqu’en Belgique sa contestation des savoirs académiques et les liens entre universités et mouvement féministe sont pratiquement inexistants.[11] L’accès aux institutions reste frustrant pour les féministes francophones qui déploient dès lors leurs efforts à partir de la société civile.
Issue des réunions chez Françoise Collin, une prise de conscience s’élabore au sein des femmes qui y participent. Hedwige raconte : « Ensemble, nous découvrons là que les expériences que nous pensions personnelles ou individuelles étaient en fait collectives et largement partagées par les autres participantes »[12]. Elles s’initient aussi aux actions et aux écrits de groupes féministes dont le Petit Livre Rouge des Femmes auquel collaborent, autour de Marie Denis, des membres du Groupe d’Action pour la Libération des Femmes, du Front de Libération des Femmes, des Dolle Mina’s et des Marie Mineur de Jeanne Vercheval-Vervoort.
Le GRIF
Bientôt, un « Groupe de recherche et d’information féministes », le GRIF, se constitue et, très vite, lance la publication des Cahiers du GRIF. L’exemple de l’écrivaine et philosophe, Simone de Beauvoir, que plusieurs participantes iront écouter le 11 novembre 1972[13] à Bruxelles pousse à l’écriture. « Le premier numéro des Cahiers du GRIF sera fin prêt pour la seconde journée des femmes, le 11 novembre 1973. Sont parties de cette aventure Françoise Collin, Hedwige Peemans-Poullet, Jacqueline Aubenas, Eliane Bouquey, Marie-Thérèse Cuvelliez, Marthe Van de Meulebroeck. D’autres viendront renforcer ce noyau de base ou participeront à des groupes de travail axés sur des numéros thématiques. »[14] Hedwige Peemans-Poullet cite également dans un entretien sa visite à la bibliothèque fondée à Paris dès 1932 par la journaliste Marguerite Durant qui lui donnera son nom. Elle en reviendra impressionnée « que des quantités d’aspects de l’histoire du féminisme n’apparaissent pas ni dans les livres ni dans la presse ordinaire et qu’on ne les retrouve donc que dans les publications féministes »[15] et convaincue de la nécessité d’écrire, de publier, de rassembler et de diffuser les écrits féministes. Ne réunissant que des femmes pour échapper à la « médiation masculine » omniprésente, travaillant à partir de témoignages, d’analyses et de vécus croisés et partagés, les féministes du GRIF veulent communiquer aux autres femmes ce qu’elles vivent et formalisent avec leurs mots, leurs images.
La publication des Cahiers du GRIF cesse de commun accord en 1978. Une partie du groupe de base poursuit la démarche d’expression collective de vécus de femmes dans l’aventure du magazine féministe Voyelles, une revue d’information plus générale qui paraîtra de 1979 à 1982. Durant la même période, une autre partie, GRIF-Université des femmes, creuse la piste de la réflexion plus approfondie et organise un colloque international intitulé « Enfants des femmes ou enfants de l’homme ? », des conférences, des groupes de discussion, des séminaires de recherche, et diffuse un Bulletin GRIF-Université des femmes rassemblant les actualités sur le mouvement des femmes. En 1982, cette deuxième partie se déchire. Avec le recul, outre les personnalités en cause, les options diffèrent aussi entre un féminisme socioculturel et un autre plus socioéconomique. La publication poursuivra donc son aventure éditoriale avec Françoise Collin jusqu’en 1996 tandis que l’association « L’Université des femmes » d’Hedwige Peemans-Poullet, Geneviève Simon, Françoise Hecq et Martine Lahaye fait publier ses statuts d’association sans but lucratif en 1982.
Sans les réduire à cette option, des activités de l’association s’inscrivent dans les décrets de l’Éducation permanente pour adultes dont la dernière mouture de 2003 permet à la Fédération Wallonie-Bruxelles de soutenir le séminaire de formation longue, des ateliers, des conférences, la revue et l’édition des actes des colloques, des résultats de recherches, dans le cadre d’une reconnaissance obtenue en 2007, étendue en 2012, confirmée en 2017. De nombreux sujets ont ainsi été documentés par des chercheur.se.s et praticien.ne.s avec une approche féministe et mis en discussion avec les participant.e.s. Citons le travail, la santé, l’éducation, les droits, les loisirs, l’avortement, la pornographie, les sciences, le développement durable, la gestation pour autrui, le féminisme des pays de l’Est, des pays nordiques, etc., comme l’illustrent les archives de l’Université des femmes consultables au Centre d’archives et de recherches pour l’histoire des femmes (CARHIF-AVG) à Bruxelles ou, pour les actions plus récentes, sur le site www.universitedesfemmes.be
Des méthodes et des publics
Travailler dans le cadre de conventions établies selon le décret communautaire relatif à l’Éducation permanente implique l’obligation pour une association d’intégrer dans ses publics des personnes issues du « milieu populaire ». Ce concept fait débat dans le secteur associatif concerné où chaque association défend sa conception du « public populaire ». Pour les Équipes populaires, par exemple, « il correspond à des personnes en précarité, pauvreté, d’éducation niveau moyenne inférieure au maximum. On devrait parler aujourd’hui de gens en désaffiliation sociale. Les Équipes populaires se sentent plus concernées par la définition du « peuple souffrant ». La question des dominations est donc essentielle car il s’agit de gens qui subissent des dominations et sont exclus, non-écoutés, … voire non-mobiles »[16]. L’Université des femmes, quant à elle, tient compte également de la situation de sujétion des publics populaires et considère que toutes les femmes, subissant la domination masculine d’une société patriarcale, doivent avoir accès à ses activités et travaux. Elle utilise ainsi une large panoplie de canaux d’information, formels et informels, pour les atteindre ; pratique des conditions matérielles et financières les plus démocratiques possible ; travaille avec des associations et institutions partenaires et s’est établie dans la capitale, dans une maison[17] hébergeant d’autres associations ciblées sur les questions « genre » et « situation des femmes » et située dans un quartier à la fois populaire, culturel et facilement accessible à pied, à vélo, en voiture ou en transports en commun.
Le Prix de l’Université des femmes, qui est attribué chaque année à des travaux de fin d’études concernant les femmes et intégrant les outils féministes d’analyse, a construit au cours de ses vingt ans d’existence un réseau précieux de lauréates actives dans différents milieux et institutions. Les méthodologies pratiquées à l’Université des femmes s’inspirent à la fois des acquis féministes (partage des tâches, intégration de pratiques créatives/artistiques, analyse des rapports sociaux de sexe) et de l’éducation permanente (réflexivité, réappropriation-construction collective de savoirs). L’association protège également l’espace de résistance et d’autonomie qu’elle ouvre aux femmes : certaines activités sont non-mixtes, les instances de gestion et l’équipe de travail restent essentiellement féminines.
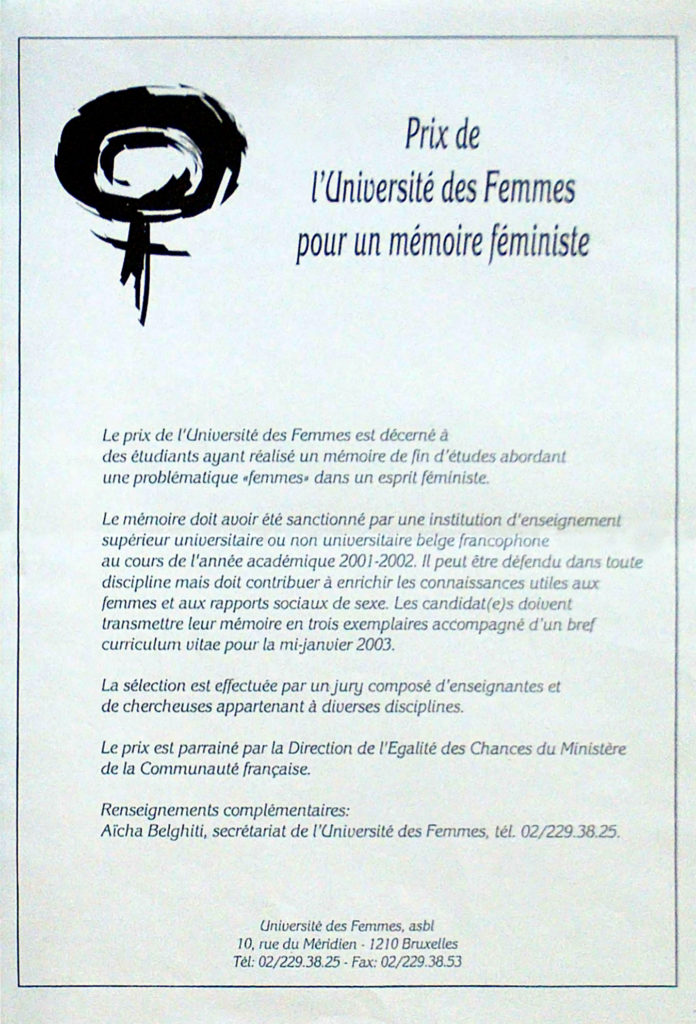
Le nom que s’est donnée l’association a été choisi parce que ses fondatrices, féministes des années 1970, souhaitaient s’inscrire dans la démocratisation de la transmission et de la constitution des connaissances, portée par les progressistes et les mouvements sociaux de l’époque. Plus fondamentalement, il s’agissait aussi – à l’instar des féministes anglo-saxonnes – d’ouvrir un lieu de critique d’un savoir construit dans le cadre d’une domination patriarcale : « Notre projet d’Université des femmes s’est attelé à la déconstruction d’un savoir dominant qui est à la fois bourgeois et patriarcal et continue à fournir une légitimité à d’injustifiables rapports sociaux de classe et de sexe »[18]. Souvent jugée présomptueuse voire prétentieuse, l’Université des femmes a questionné à plusieurs reprises la pertinence de sa dénomination et choisi de la maintenir. L’abandonner serait un peu oublier son histoire. D’autre part, les études régulièrement renouvelées sur la présence, le rôle et l’importance des femmes dans le monde académique indiquent que, si l’égalité entre femmes et hommes est pratiquement acquise dans la loi, elle reste encore largement à construire sur le terrain. L’association continue donc à permettre aux femmes de défricher ensemble, avec leurs outils, leurs vécus et leurs perceptions, les facettes multiples d’une société qui peine toujours à les reconnaître comme des êtres humains et des citoyennes à part entière. Son public – très souvent mixte – se rajeunit et se renouvelle, attiré par des thèmes plus actuels. En même temps, ses éditions et sa bibliothèque, le travail de ses historiennes et de ses formatrices, l’apport de ses groupes de discussion, lui permettent de construire et de développer une base de savoirs et d’expériences féministes qui reste précieuse et incontournable tant que l’enseignement, y compris les universités, les médias, les familles, ne l’intègreront pas formellement et systématiquement dans la transmission aux jeunes générations.
Notes
[18] Peemans-Poullet H., « Trente ans déjà ! Une Université pour toutes les femmes… », Chronique féministe, n°111, 30 ans de féminisme. En route vers l’avenir, Bruxelles, Université des femmes, janvier/juin 2013.
POUR CITER CET ARTICLE
Référence électronique
