François Welter (historien au CARHOP asbl)
La crise sanitaire et, dans une moindre mesure, le confinement sont vécus comme une expérience commune. L’intensité de leurs effets divergent en revanche selon les milieux sociaux et les secteurs d’activité économique. Pour les historien.ne.s de l’histoire sociale, cette période exceptionnelle est marquée par le questionnement, les doutes sur leur légitimité à déjà s’introduire dans le temps de l’analyse. Disposent-ils d’un recul suffisant, alors que nous sommes seulement aux prémices d’une crise ? Leur bagage méthodologique est-il suffisant ou doit-il se nourrir d’autres disciplines et expériences en sciences humaines ? Doivent-ils se tenir en retrait, avec le risque de laisser s’évaporer des traces précieuses d’expressions de craintes, de difficultés réelles, de mobilisations ? Au contraire, sont-ils des acteurs essentiels pour comprendre les phénomènes en cours, les interroger et, en cela, construire une base de réflexion nécessaire à la formulation de revendications, de projets d’émancipation ? Cette contribution a pour objet d’expliquer en quoi les crises socioéconomiques sont des moments névralgiques au cours desquels la discipline historique se pose avec d’autant plus d’acuité, par ses dynamiques internes et son propos, comme un outil d’analyse et un support à l’action collective.
L’histoire ouvrière et populaire par ses acteurs et actrices (la fin des années 1970)
Dans les années 1970-1980, après une décennie de plein emploi, la Belgique baigne dans une crise socioéconomique majeure. Aux effets dévastateurs du choc pétrolier de 1973, succèdent les restructurations d’une industrie vieillissante et les fermetures d’usines. La Wallonie, particulièrement, est touchée de plein fouet par la déliquescence de son économie, occasionnant de facto une crise sociale profonde. Des familles entières d’ouvrier.e.s sombrent dans la précarité. Le taux de chômage et de demandeurs d’emploi, l’inflation et le déficit public augmentent sensiblement. La concertation sociale, quant à elle, est mal en point : aux offensives patronales réclamant la nécessité de rétablir les conditions d’une compétitivité des entreprises, les syndicats opposent une attitude défensive, tâchant de protéger le niveau des rémunérations et des prestations sociales. En guise de réponses, les gouvernements successifs mènent depuis 1976 des politiques de redressement dont le contenu ne satisfait ni le patronat, ni les organisations syndicales[1].
Au sein du Mouvement ouvrier chrétien (MOC), les Équipes populaires entrent dans une réflexion sur la crise économique dès 1976. Initiative innovante, elles entendent inscrire l’histoire ouvrière et industrielle « comme colonne vertébrale de la revendication sociale ». L’un de ses permanents, Guy Gossuin, entre en relation avec plusieurs historiens, dont certains sont déjà impliqués dans les formations organisées par le Centre d’Information et d’éducation Populaire (Institut supérieur de culture ouvrière – ISCO) et dont la conception de l’histoire s’articule autour de plusieurs fils rouges, à savoir : la nécessité de penser le passé politiquement et historiquement le présent, de construire une histoire qui s’émancipe de la culture et de l’idéologie dominante pour se consacrer aux dominés, de la concevoir à la fois comme une démarche collective et d’émancipation de ses sujets.
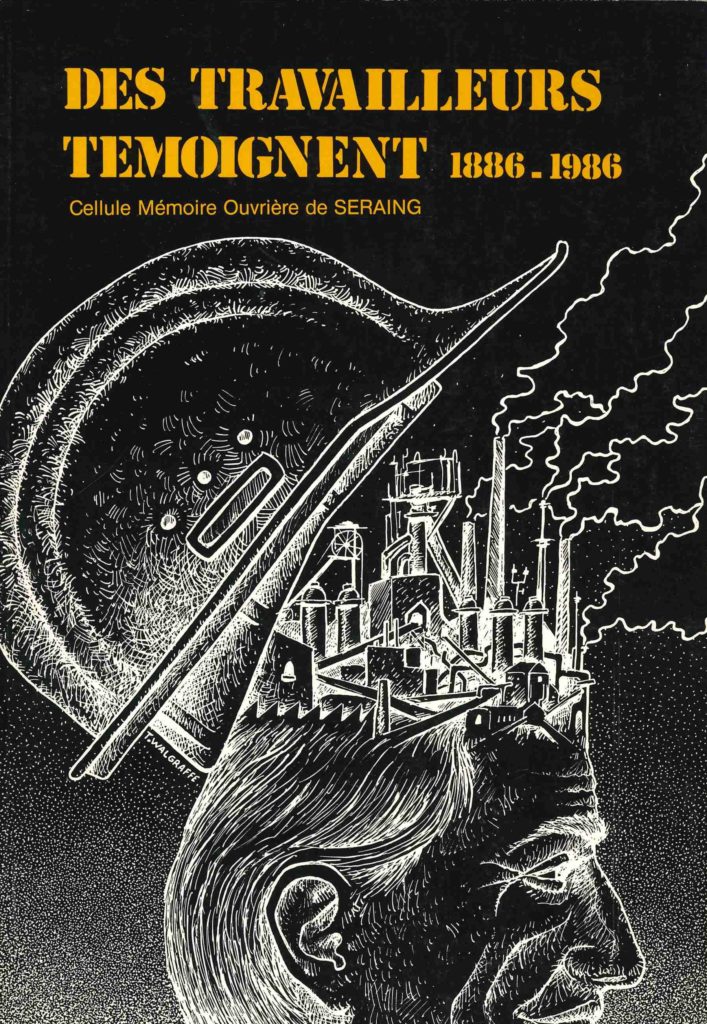
Des discussions et de ces rencontres nait l’idée de présenter une exposition consacrée à « l’Histoire ouvrière » à la rencontre nationale des Équipes populaires, en octobre 1977. Celle-ci s’articule selon la triple approche de la condition ouvrière, de l’action ouvrière et de la revendication ouvrière. En d’autres termes, une nouvelle déclinaison du « Voir-Juger-Agir », une méthode si chère à la Jeunesse ouvrière chrétienne (JOC). Dans le même temps, l’historien du mouvement ouvrier, Hubert Dewez[2], intervient à propos de ce que dit l’histoire sur la crise en cours. L’exposition devient itinérante et rencontre un certain succès à Bruxelles et en Wallonie. Dans la foulée, les Équipes populaires et les historiens multiplient les initiatives : expositions régionales, enquête sur la vie ouvrière, etc. Surtout, ils constituent une cellule « Mémoire ouvrière », qui, par la suite, trouvera différents ancrages régionaux : Jumet, Brabant wallon, Seraing[3].
Page de couverture : Cellule mémoire ouvrière de Seraing, Des travailleurs témoignent. 1886-1986, s.l., CARHOP, 1986.
Avec les cellules « Mémoire ouvrière », c’est toute la démarche historique qui est repensée et s’ancre dans le travail en éducation permanente, comme l’explique Monique Van Dieren, permanente communautaire aux Équipes populaires :
[4]. La parole ouvrière et populaire, en ce qu’elle a de plus vivant, par ses témoins et ses acteurs directs, devient centrale[5]. Protagonistes et historien.ne.s donnent corps à une histoire jusqu’alors peu exprimée et/ou entendue. Les cellules « Mémoire ouvrière » contribuent à construire un récit collectif de ce qu’est le monde ouvrier, dans ses conditions de travail et ses revendications, sans toutefois exclure la parole personnelle. Elles construisent en cela des ponts entre un monde d’hier où de grandes luttes ont été menées par les travailleurs et travailleuses qui témoignent et les jeunes générations des années 1970-1980 qui connaissent les emplois précaires, le chômage et le détricotage de la sécurité sociale[6]. Ainsi, en s’appropriant leur histoire et en retraçant une chronologie – l’outil de base en histoire – les militant.e.s et (anciens) travailleur.euse.s créent une grille d’analyse de la crise alors en cours. Les exemples de filiation entre les phénomènes et luttes antérieurs et la situation des années 1980 ne manquent pas. En 1986, l’ouvrage que publie la cellule « Mémoire ouvrière » de Seraing est à cet égard éclairant. Il structure les témoignages de travailleurs autour de questions sociales que sont le travail sous ses différents aspects, les relations dans le milieu du travail, la vie quotidienne et l’immigration, pour, au final, leur conférer un prolongement contemporain. Symptomatique de cette méthode d’approche, la cellule « Mémoire ouvrière » de Seraing fait le constat en 1986 que « si aujourd’hui, on parle de société de consommation, société de loisirs, d’échec de la scolarité, d’échec de la concertation sociale, de société à deux vitesses, etc., ce n’est souvent que l’amplification d’éléments mis en place dans l’entre-deux-guerres »[7]. De ce point de vue, le processus d’éducation permanente alors en œuvre parait évident. Les cellules « Mémoire ouvrière » sont d’ailleurs reconnues par le décret de 1976[8], sous son chapitre II, jusqu’à leur extinction en 1988[9].

Un autre élément qui mérite d’être pointé est évidemment le rôle qu’occupent les permanent.e.s des Équipes populaires au sein des cellules « Mémoire ouvrière ». À côté des travailleurs, des travailleuses, des militant.e.s et des historien.ne.s de ce qui deviendra le Centre d’animation et de recherche en histoire ouvrière et populaire (CARHOP)[10], ils déploient des techniques d’animation autour de la récolte des témoignages et deviennent par-là des coproducteurs d’histoire, au même titre que les autres parties prenantes des cellules :
[11]. Sous cet aspect, la démarche historique, en tant que science humaine, s’ouvre à des personnes qui l’enrichissent par les apports d’autres sciences humaines et sociales, en ce compris par des pratiques empiriques nées des expériences d’animation[12]. En cela, elle sort un peu plus des canons académiques et s’articule autour d’un biais peu utilisé au sein des universités, la participation/l’animation.
L’apport historique à l’agir. Le cas de la campagne sur la réduction du temps de travail
À la fin des années 1980, la crise socioéconomique reste prégnante. Agir sur le temps et l’organisation du travail apparait comme une des pistes pour en sortir. En 1982, le ministre de l’Emploi et du Travail, Michel Hansenne (Parti social-chrétien – PSC), entend stimuler les entreprises à diminuer le temps de travail, avec embauche compensatoire, et à recourir à la flexibilité. Les effets escomptés restent toutefois mineurs[13]. Du côté des Équipes populaires, la conviction existe qu’il faut changer de paradigme et travailler sur les exclusions, celle du travail étant la source principale des autres. Les prospections qu’elles mènent à ce sujet depuis 1984 les conduisent à porter la réduction du temps de travail comme revendication majeure et à en faire une campagne à part entière. À leurs yeux, « face au chômage toujours massif et aux exclusions toujours nombreuses, face au spectre de la société duale, le mouvement a opté pour l’élaboration d’un projet de société où il sera possible de travailler moins pour travailler tous, de travailler moins pour vivre mieux »[14].
L’approche du mouvement d’éducation permanente est pluridisciplinaire. Celui-ci mène en parallèle une vaste enquête auprès de la population wallonne et bruxelloise sur le temps libre et le travail (octobre 1989), un colloque sur la question (mai 1990), participe aux chantiers de la Centrale nationale des employés (CNE) à ce propos et prépare un livre thématique[15]. Des permanent.e.s, des sociologues, des syndicalistes, des philosophes sont impliqués à divers degrés dans ces démarches. Les historien.ne.s ne sont pas en reste en inscrivant la lutte pour la réduction du temps de travail dans une historicité. En 1989, la publication des Équipes populaires, intitulée « Le temps de travail dans l’histoire », interroge l’hypothèse de départ du mouvement d’éducation permanente, « Travailler moins pour travailler tous. Travailler moins pour vivre mieux ». Par le biais de l’analyse historique, l’enjeu est de tirer un premier enseignement de la sacralisation du travail, comme valeur fondamentale de la société née de l’ère industrielle et, consécutivement, de la réaction de la classe ouvrière à l’exploitation dont elle est victime. Le dossier analyse ainsi les moyens que les travailleur.euse.s déploient pour revendiquer une meilleure qualité de vie et, en miroir, la réaction patronale[16]. Le dossier est le résultat de recherches menées par l’historienne Marie-Thérèse Coenen. L’apport de l’histoire ne réside cette fois non dans la démarche collective et la co-construction d’une expérience collective, mais surtout dans sa finalité sociétale. Elle constitue le terreau d’une réflexion, d’un processus d’éducation permanente que mènent les Équipes populaires et qui leur permettra de proposer des solutions concrètes et techniques destinées à reconstituer un rapport de forces face aux slogans économiques, financiers et politiques d’obédience libérale. En d’autres termes, l’histoire comme outil d’analyse constitue les deux premières composantes de la célèbre triade « voir-juger-agir ». Il n’est d’ailleurs pas illogique que le mouvement donne un prolongement à ce dossier par une nouvelle publication qui se penchera sur les pistes d’émancipation collective[17].
La crise de 2020 et le confinement : le retour à une démarche collective
Deux nécessités : le recours à l’histoire sociale et la récolte des traces
À partir de la mi-mars 2020, la crise aigüe de la Covid-19 met au premier plan la nécessité de mobiliser l’histoire sociale. Pour reprendre les termes d’une carte blanche rédigée par un collectif d’historien.ne.s et de sociologues dès le 14 avril 2020, il s’agit de « mettre en lumière les expériences contrastées et multiples de la pandémie selon les lieux, les genres et les âges et ainsi [d’]écrire une histoire ordinaire de l’extraordinaire »[18]. Cependant, le confinement contrarie le travail des historien.ne.s du CARHOP. Les animations auprès des publics, la récolte de leurs témoignages et la mise en perspective historique de ceux-ci étant suspendues pour une durée indéterminée, les ressorts de leur travail d’éducation permanente sont affaiblis. La récolte de traces de la crise en cours est également suspendue à une méthodologie à définir. Moins de quinze jours, en réalité. Car, un réseau d’archivistes, dont des travailleur.euse.s du CARHOP, se mobilise rapidement. Composé de personne issues d’horizons différents, celui-ci entend ne pas laisser se diluer la mémoire d’une période aussi particulière que potentiellement éphémère : le confinement. Il ne faut pas un mois avant que la plateforme « Archives de Quarantaine Archief » (AQA) ne voit le jour[19]. Celle-ci est l’incitant qui permettra au CARHOP de déployer de nouvelles stratégies de prospections et d’inscrire la crise en cours dans une historicité. Dans la foulée de la mise en ligne de la plateforme, le CARHOP publie des appels à témoignages parmi ses réseaux.

L’historien.ne comme témoin et acteur de changement
La réalité du confinement complexifie grandement la récolte de témoignages des acteurs et actrices de terrain. Car, elle a pour principal effet que les associations et les mouvements sociaux sont accaparés, plus encore qu’en période « normale », par le travail avec leur public. Maintenir le lien et, a fortiori, poursuivre leur mission d’éducation permanente relèvent du défi dans un contexte d’isolement des publics précarisés. Certes, les travailleur.euse.s du social, les animateurs et animatrices et les permanent.e.s ont-ils vite conscience que les gens ont besoin de partager leurs inquiétudes et leurs réalités par rapport à leur situation personnelle présente et future ; mais, de là à déployer des stratégies à moyen et long terme pour pérenniser les traces de leurs actions, le pas est immense à franchir. Que peuvent dès lors espérer les historien.ne.s ? Leur action se décline en deux temps. En période de confinement, ils utilisent les nouvelles technologies pour, d’une part, conscientiser les acteurs de l’éducation permanente de garder les traces de leurs actions et, d’autre part, récolter leur propre expérience. Au final, plusieurs entretiens sont ainsi enregistrés ; des post sont identifiés sur les réseaux sociaux et les blogs ; des communiqués de presse sont captés ; moins nombreuses mais aussi importantes, des publications sur support papier sont collectées. Comparés à la masse documentaire potentielle, ces coups de sonde restent minimes. Ils permettent néanmoins de se faire une première idée des préoccupations des travailleurs sociaux et des militant.e.s. Le résultat est plus qu’interpellant : il est question de préparer des colis alimentaires pour les personnes les plus précarisées, de perte de sens du travail de la part d’éducateurs et d’éducatrices, de travailleurs et de travailleuses de première ligne exerçant leurs tâches dans la peur d’être contaminé.e.s par le virus et contraintes de s’isoler de leur famille, de violences conjugales qui augmentent, etc. De ces éléments, les historien.ne.s peuvent en tirer quelques modestes fils rouges, des premiers constats. Surtout, ils sont happés par la nécessité de revoir leurs approches, de se dépêtrer des discours dominants, en vue de se plonger davantage dans le vécu des invisibles. Sont-ils suffisamment outillés pour autant ?
Libérer la parole des travailleurs et travailleuses comme premiers pas
Les historien.ne.s paraissent parfois démuni.e.s lorsqu’ils doivent construire une histoire de l’immédiat. Requérir d’autres outils, empruntés aux sciences sociales, est dès lors nécessaire. À cet égard, la socio-histoire, en tant que mode d’approche des faits et des phénomènes historiques, est une boîte à outils utile. En croisant les apports de la sociologie et de l’histoire, elle cherche à « mettre en lumière l’historicité du monde dans lequel nous vivons, pour mieux comprendre comment le passé pèse sur le présent » et à déconstruire les entités collectives, telles que l’État, les entreprises, les mouvements sociaux, etc., « pour retrouver les individus et les relations qu’ils entretiennent entre eux ». Elle met particulièrement l’accent sur les relations à distance, et sur les rapports de force sous ses trois composantes, à savoir la domination sociale, la solidarité sociale et les relations de pouvoir[20]. Les historien.ne.s s’adjoignent ainsi les compétences des sociologues pour construire un éclairage historique sur les phénomènes sociaux actuels. Particulièrement, en cette période de crise commune, même si, rappelons-le, elle est vécue différemment, une démarche qui est destinée à mettre en perspective des paroles collectives et plurielles s’avère nécessaire.
À nouveau, c’est sur l’interpellation d’acteurs et d’actrices de terrain que les historien.ne.s du CARHOP s’engagent dans la voie de la récolte de paroles collectives, à l’instar des cellules « Mémoire ouvrière » à la fin des années 1970 et de projets ultérieurs. En juin 2020, alors que le pays entre lentement dans le déconfinement, la CNE interpelle le CARHOP sur le besoin de libérer la parole de travailleurs et de travailleuses durement touchés par la crise sanitaire et le confinement. Dans les maisons de repos, le secteur du handicap, le milieu de la petite enfance, les organisations socioculturelles, chez les travailleur.euse.s sociaux, la gestion de la pandémie conduit à des situations d’abandon des patient.e.s et/ou des bénéficiaires, à des liens qui se distancient, à une forte pression sur le personnel, à s’interroger sur le sens du travail. L’idée de réaliser des interviews collectives intervient très tôt dans le processus de réflexion : permanent.e.s de la CNE, sociologues, conseiller.e.s à la Faculté ouverte de politique économique et sociale (FOPES), historien.ne.s, etc., ont l’intuition qu’il faut ouvrir des espaces de paroles collectives où seront exprimés le mal-être des travailleurs, leurs conditions de travail, leur relation à celui-ci, leurs interrogations sur son sens. Une méthodologie empruntée très partiellement à la méthode d’analyse en groupe (MAG) est déployée. Habituellement, celle-ci s’inscrit dans un processus long, y compris au niveau de la préparation ; elle s’avère donc impossible à mettre en œuvre dans toutes ses dimensions sur une temporalité courte. Car, il importe de libérer une parole des acteurs et actrices de terrain qui n’est pas encore empreinte des contingences extérieures, une parole sur le fait immédiat, proche. Témoins et scientifiques collaborent au processus de recherche, du moins à ses débuts. Les interviews de groupe sont organisées de telle manière que chacun.e s’exprime sur son expérience et, au terme de ce tour de table, un ou plusieurs cas sont décortiqués collectivement.
Les observations et conclusions qui ressortiront de ces interviews collectives sont encore difficiles à définir : le processus de récolte est encore en cours. Néanmoins, le croisement des approches de différentes disciplines des sciences humaines et le fait que les scientifiques se projettent déjà dans le champ de la récolte des traces et de leur analyse montrent que le temps du « juger », dans la triade jociste, est déjà présent. Certes, les clefs de compréhension qui sont maintenant construites seront-elles ajustées ou invalidées avec l’exploitation de nouvelles traces jusqu’ici inconnues ou qui ne sont pas encore produites. Néanmoins, par leur réactivité à la crise en cours, les sociologues, les historien.ne.s du social et les archivistes construisent, avec leurs publics, un matériau de réflexion qui peut servir de tremplin à l’action collective. En cela, même si c’est à un autre niveau, ils s’inscrivent dans une dynamique que portent aujourd’hui les mouvements sociaux, à l’instar du MOC qui ambitionne de mener une vaste enquête populaire sur la crise, dans la perspective d’une action collective politique
Conclusions
Face à la crise sanitaire et au confinement, face aux inégalités qui se creusent, il apparait que les historien.ne.s peuvent légitimement se positionner comme des acteurs et actrices de changement. Leur démarche est double. D’une part, ils ont ce rôle d’interpeller la société sur la nécessité de préserver la mémoire des évènements actuels, comme un matériau nécessaire à la réflexion et à l’action future. D’autre part, en cette période où se vivent des expériences humaines dramatiques, ils déploient des stratégies collectives qui permettent aux paroles de personnes en souffrance, de militant.e.s, d’acteurs et actrices de terrain de se libérer dans un espace commun. Par les connexions méthodologiques qu’ils tissent avec d’autres sciences humaines, par leur approche empirique auprès des sources, par l’attention qu’ils portent aux débats et aux luttes du moment, les historien.ne.s coconstruisent un éclairage scientifique, distancié, à partir de ces témoignages autour des phénomènes sociaux en cours.
Notes
[1] Mabille X., Histoire politique de la Belgique. Facteurs et acteurs de changement, Bruxelles, CRISP, 1986, p. 361-365.
[2] L’intérêt que porte Guy Gossuin à l’histoire ouvrière émane aussi des contacts qu’il a avec Hubert Dewez, alors responsable de la presse francophone et de la formation à la Confédération des syndicats chrétiens (CSC). Voir : CARHOP, fonds Carhop, dossier 40 ans du Carhop, interview de Monique Van Dieren et Jean-Michel Charlier par François Welter, 27 février 2019.
[3] Coenen M.-Th., Entre démarche historienne et éducation permanente. Hommage à Jean-Pierre Nandrin, Braine-le-Comte, 2015. URL : http://www.carhop.be/images/Nandrin_2015.pdf, p. 5-7, page consultée le 25 septembre 2020.
[4] CARHOP, fonds Carhop, dossier 40 ans du Carhop, Interview de Monique Van Dieren et Jean-Michel Charlier par François Welter, 27 février 2019.
[5] Cela étant, la récolte de témoignages se couple à la recherche de traces écrites, iconographiques et audiovisuelles. Ces prospections archivistiques connaissent d’ailleurs une ampleur grandissante jusqu’à constituer en 2020 un centre qui conserve plus de trois kilomètres linéaires d’archives et près de 35 000 publications. Sur l’intérêt précoce porté aux traces, voir : CARHOP, fonds Luc Roussel, boîte CARHOP – cellule – 1977-1983, dossier Cellule mémoire populaire. Équipes populaires de Bruxelles, 1977-1981.
[6] Coenen M.-Th., « Plaidoyer pour une mémoire collective », Wallonie en ligne.net, Institut Jules Destrée, octobre 1987. URL : http://www.wallonie-en-ligne.net/Wallonie-Futur-1_1987/WF1-92_Coenen-M-Th.htm, page consultée le 25 septembre 2020.
[7] Cellule mémoire ouvrière de Seraing, Des travailleurs témoignent. 1886-1986, Bruxelles, 1986, CARHOP, p. 18.
[8] CARHOP, fonds Carhop, dossier 40 ans du Carhop, interview de Monique Van Dieren et Jean-Michel Charlier par François Welter, 27 février 2019.
[9] En son chapitre II, article 10, §1, le décret du 8 avril 1976 stipule que « pour pouvoir être classée dans la catégorie des organisations de promotion socio-culturelle des travailleurs, l’organisation doit, outre les conditions prescrites pour la reconnaissance au titre d’organisation d’éducation permanente, s’adresser et s’adapter par priorité au public du milieu populaire en réalisant son action au départ de l’analyse avec ses membres de leurs conditions de vie et des facteurs déterminant plus particulièrement leur situation. Voir : Décret fixant les conditions de reconnaissance et d’octroi de subventions aux organisations d’éducation permanente des adultes en général et aux organisations de promotion socio-culturelle des travailleurs, 8 avril 1976. URL : https://www.gallilex.cfwb.be/document/pdf/00439_000.pdf, page consultée le 25 septembre 2020.
[10] Symptomatique du souci d’inscrire la démarche historique dans un processus d’éducation permanente, le CARHOP met en évidence, dans son intitulé, la dimension d’animation. Voir : CARHOP, fonds Carhop, dossier 40 ans du Carhop, interview de Monique Van Dieren et Jean-Michel Charlier par François Welter, 27 février 2019.
[11] CARHOP, fonds Carhop, dossier 40 ans du Carhop, Interview de Monique Van Dieren et Jean-Michel Charlier par François Welter, 27 février 2019.
[12] Ibid.
[13] Sur les effets de cette politique, voir notamment : Bredael B. e.a., Le temps de travail. Transformations du droit et des relations collectives du travail, Bruxelles, CRISP, 1997, p. 361-365.
[14] CARHOP, fonds Équipes populaires – Centre communautaire, n°1614, « Les Équipes populaires. C’est quoi », sd.
[15] Ce livre n’est finalement pas publié. Je remercie Jean-Michel Charlier de m’avoir confirmé cette information. Voir : « Le temps, enjeu capital pour construire l’avenir », Le Droit de l’employé, n° 5, mai 1990, p. 12-13 ; CARHOP, fonds Équipes populaires – Centre communautaire, n° 1613, Schéma du livre E.P., [1990].
[16] Coenen M.-Th., Le temps de travail dans l’histoire, Namur, Centre national des Équipes populaires, 1989 (Sous la loupe. Dossiers, n° 3), p. 2.
[17] Charlier J.-M., Réduction du temps de travail. Enthousiasmes et faux espoirs, Namur, Centre national des Équipes populaires, 1994 ( Sous la loupe. Dossiers , n° 11).
[18] Collectif d’historiens, archivistes et sociologues de plusieurs pays, « Pour une mémoire ordinaire de l’extraordinaire », Le Soir, 14 avril 2020. URL : https://plus.lesoir.be/296530/article/2020-04-24/pour-une-memoire-ordinaire-de-lextraordinaire?referer=%2Farchives%2Frecherche%3Fdatefilter%3Dlastyear%26sort%3Ddate%2520desc%26word%3Darchives%2520m%25C3%25A9moire, page consultée le 14 septembre 2020.
[19] Cette initiative est loin d’être une première. Après les attentats de Bruxelles en mars 2016, les archivistes de la Ville de Bruxelles se préoccupent déjà de la récolte de traces de ces moments fugaces : là en collectant les messages déposés sur le parvis de la Bourse et à la station de métro Maelbeek, là en photographiant les inscriptions à la craie et les bouquets de fleurs. Ces documents sont séchés, nettoyés, classés d’après leur date et lieu de collecte ; ils sont ensuite numérisés. En 2018, 4 000 photos et 2 500 messages numérisés sont mis en ligne. Voir : Archives de Bruxelles, Commémoration des attentats du 22 mars 2016. URL : https://archives.bruxelles.be/commemoration-des-attentats-du-22-mars-2016, page consultée le 13 septembre 2020.
[20] Noiriel G., Introduction à la socio-histoire, Paris, éditions La Découverte, 2006, p. 4-6 ( Repères. Histoire , 437).
POUR CITER CET ARTICLE
Référence électronique
Welter F., « Face à la crise, l’action collective par et pour l’histoire », Dynamiques. Histoire sociale en revue, n°12, septembre 2020, mis en ligne le 15 octobre 2020. URL : https://www.carhop.be/revuescarhop/
