Entretien avec Marie-Thérèse COENEN (historienne, CARHOP asbl),
30 octobre 2020
Du côté des usagères
Dans son analyse sur les effets des écoles de devoirs (EDD) comme actrices d’une politique d’égalité des chances et de luttes contre les inégalités[1], Georges Liénard exprimait le souhait que « des moyens de recherche soient mobilisés afin de conduire une recherche longitudinale (au moins 6 ans) sur un échantillon des enfants et des adolescents participants aux écoles de devoirs afin de comparer leur trajectoire avec celle des enfants et des adolescents de même milieu social, culturel, économique, qui ne fréquentent pas les écoles de devoirs. Cela permettrait de mieux apercevoir et de démontrer (autant que faire se peut) les effets multidimensionnels de l’action des écoles de devoirs ». Partir du témoignage des « consommatrices, clientes ou usagères » des écoles de devoirs comme celui de Döne Dagyaran nous permet de saisir les stratégies de réussite mobilisées par ces jeunes femmes pour qui les écoles de devoirs ne sont qu’un élément, mais aussi un apport essentiel dans leur trajectoire de formation.
Döne Dagyaran est avocate au barreau de Bruxelles. Elle est née le 10 décembre 1986 à Bruxelles. Très tôt, elle fréquente les écoles de devoirs. Après un parcours sans faute à l’école primaire et secondaire, elle entreprend des études de droit en 2005, à l’Université libre de Bruxelles. Diplômée en juin 2011, elle est inscrite au barreau depuis 2011. Elle s’engage en même temps dans l’action politique. Élue sur la liste PS (Parti socialiste) à Saint-Josse-Ten-Noode aux élections communales de 2012, elle est conseillère communale, conseillère CPAS (Centre public d’action sociale – comité senior et comité social général). Elle est mandataire à la société des habitations à bon marché (HBM SCRL) de Saint-Josse-Ten-Noode et à l’Intercommunale d’inhumation interculturelle. Elle ne se représente pas en 2018.
À côté de la vision de l’accompagnement d’une « bénévole » en école de devoirs, Brigitte Dayez-Despret[2], le témoignage de Döne Dagyaran éclaire l’autre versant de l’accompagnement et montre son impact sur ceux et celles qui les fréquentent, même des années après cette expérience. Son témoignage illustre parfaitement les effets multidimensionnels de l’action des écoles de devoirs, soulignés par Georges Liénard.
Un parcours en école de devoirs
Je vais me présenter d’abord et ensuite je t’explique comment je suis arrivée à l’école de devoirs et ce que cela m’a apporté. Je m’appelle Döne Dagyaran. J’ai 34 ans, je suis avocate au barreau de Bruxelles depuis 2011 et j’y exerce mon métier. Je suis maman de deux petites filles. J’aimerais vous retracer mon parcours d’étudiante, mon parcours d’enfant de parents venus comme travailleurs étrangers.
Mes parents sont arrivés en Belgique, dans les années 1980. Ils ne parlaient pas vraiment bien le français. Nous sommes, si vous voulez, les enfants d’une époque où chacun devait se débrouiller avec le pays d’accueil. Malgré le fait que nous sommes nés ici, il y avait toujours la barrière de la langue parce que la langue maternelle, la langue parlée à la maison, était le turc. Nos parents étaient incapables de suivre la scolarité des enfants qui sont en quelque sorte abandonnés à leur sort. Leur parcours scolaire dépend d’une part, de leur prise en charge par des éducateurs et des professeurs sur lesquels ils vont pouvoir compter, et, d’autre part, sur leur capacité à s’adapter et à faire les efforts pour être au même niveau que les autres élèves de leur classe, belges pour la plupart, qui bénéficient d’un soutien à la maison
- Quel est le parcours que tu as suivi pour arriver à l’école de devoirs ?
En fait, la première école de devoirs que j’ai fréquentée est l’Atelier du Soleil qui se situait à côté de l’école n° 9. J’avais 8 ans, et mon professeur de l’époque avait remarqué que je ne parlais pas correctement le français et que je ne le lisais pas correctement. À l’occasion de la rencontre avec les parents, il avait présenté ses observations à ma maman qui ne comprenait qu’à moitié ce que disait, mon professeur. Et moi, j’accompagnais ma maman, et je devais encore traduire ce que le professeur disait que je n’étais pas capable de lire et de parler correctement le français. Nous étions, d’une certaine façon, des petits enfants adultes, c’est-à-dire des enfants qui devaient traduire aux parents les problèmes personnels rencontrés, et, de l’autre, se débrouiller.
Le lieu où se situait l’Atelier du Soleil était d’une facilité cruciale pour moi. Les locaux de l’association se trouvaient juste à côté de l’école que je fréquentais. Le professeur nous a donc recommandés de nous rendre à cette école de devoirs. C’est ainsi que nous avons poussé la porte de l’Atelier du soleil et c’est là que j’ai appris, après les heures d’école, à parler et à écrire en français. Après l’école, je me rendais directement à cette école de devoirs pour faire mes devoirs, et ensuite faire une heure de lecture, des dictées, des exercices d’orthographe pour améliorer mon français. Très rapidement, j’ai amélioré ma maîtrise de la langue et pallié mes lacunes.
De là, je suis entrée en humanités secondaires à l’Athénée Adolphe Max, parce que j’avais un bon niveau. L’Athénée Adolphe Max était, à l’époque, une école élitiste qui sélectionnait ses élèves, mais vu mes points, le préfet a accepté de m’inscrire dans l’école. Là encore, j’ai senti la différence. Je comprenais qu’on n’était pas tout à fait au même niveau que les autres élèves, les Belges, qui fréquentaient cette école.
J’ai fait trois ans de latin de la première à la troisième année secondaire, latin-sciences, mais après, j’ai suivi les humanités scientifiques B.
À partir de l’entrée en humanités, je suis partie à la recherche des écoles de devoirs adaptées à l’enseignement secondaire. J’ai donc fréquenté les écoles de devoirs en primaire, et ensuite en secondaire. C’est une amie qui m’a parlé de Bouillon de cultureS à Schaerbeek et je me suis inscrite. J’en garde un souvenir très important. J’ai rencontré des personnes formidables, j’y ai trouvé un soutien. Vraiment ! Quand je vois tous ces ingénieurs, ces avocats d’origine étrangère qui occupent ces métiers, sans cette aide, est-ce qu’on serait arrivé là où l’on se trouve aujourd’hui ? Je ne crois pas. Ce sont des personnes passionnées, dévouées. Il n’y a aucune barrière de culture. J’ai vraiment été très touchée par les gens que j’y ai rencontrés. Comme je les remercie, quand j’y pense, cela ne sera jamais assez ! Si je n’avais pas rencontré ce soutien dans les associations, je ne serais pas là où je suis actuellement, je dois être honnête.
- Comment t’organisais-tu ?
À l’école primaire, c’était surtout pour l’orthographe et la lecture qui restaient un exercice difficile pour moi. En secondaire, il y avait les dissertations en français et j’avais des lacunes en mathématiques. Cela devenait de plus en plus compliqué, mais c’est surtout dans les dissertations en français que j’avais le plus de problèmes. Comment le dire ? Nous n’avions pas d’activité à l’extérieur de l’école pour pouvoir nous épanouir, nous améliorer. Ma vie était entre l’école et l’école de devoirs. C’était ma vie.
En fait, je fréquentais deux écoles de devoirs : l’une, Bouillon de cultureS et l’autre, à Saint-Josse, l’association La Voix des femmes. C’était surtout des filles qui fréquentaient les écoles de devoirs. On voyait très peu les garçons.
Comme professeure à La Voix des femmes, il y avait une personne qui s’appelait Olga Chianovitch. Elle avait travaillé dans la diplomatie. Elle voulait s’investir dans la formation des femmes. Olga donnait des cours d’anglais. J’ai également rencontré Monique Parker, qui était professeure de mathématiques à l’ULB. Elle donnait cours aux étudiants de médecine (Faculté de sciences, retraitée en 2000). Elle nous a aidés en mathématiques. À La Voix des femmes, j’ai été suivie par ces deux dames.
À Bouillon de cultureS, j’ai fréquenté un ingénieur, Dominique Dal, et j’étais suivie par Brigitte Dayez[3] pour le cours de français. Brigitte donnait des cours de littérature turque, et c’est grâce à elle que j’ai découvert mon pays. À part ma ville d’origine, Emirdağ, je ne connaissais pas la Turquie. C’est avec Brigitte que j’ai fait un voyage culturel en Turquie, à Istanbul. J’ai découvert mon pays avec son histoire et toutes ses facettes, et c’était formidable. Cela m’interpelle, car Brigitte, qui est belge, a appris le turc et est passionnée par l’histoire de la Turquie. C’est incroyable. Elle connaît mieux que moi, mon pays. Elle parle presque, comme moi, le turc. J’étais vraiment impressionnée par son parcours.

- Tu faisais du shopping de professeurs
Oui, en quelque sorte. Nous étions un petit groupe de cinq filles. Nous faisions un peu du shopping d’associations, comme tu le dis, mais cela dépendait aussi des affinités que nous pouvions avoir avec certaines personnes. Quand on ne s’entendait pas avec un professeur, alors on se tournait vers un autre.
- Et à l’université ?
À l’université, j’ai dû prendre mon envol. Au départ, je voulais devenir sociologue. Comme j’étais plutôt dans le social, que j’avais grandi dans le milieu associatif, ce milieu me plaisait, mais j’ai une amie arménienne qui m’a convaincue de l’accompagner pour faire le droit à l’ULB. Comme j’étais une « défenseuse » des droits des femmes, j’ai dit oui. Quelque part, le social et le droit se croisent. J’ai dit : « oui, pourquoi pas ? ». Cela me plaisait aussi de prendre la défense des personnes. Voilà pourquoi je me suis inscrite à la faculté de droit. Mais moi, je voulais aussi m’investir en politique. Je ne voulais pas uniquement exercer le métier d’avocate. Je voulais aller plus loin, mais cela n’a pas marché malheureusement. Je suis entrée en politique à l’âge de 25 ans. J’ai été sollicitée, mais on est trop idéaliste peut-être au début. Je débutais ma carrière d’avocate en même temps que je me lançais en politique. C’était tout en même temps. J’aurais dû sans doute lancer ma carrière d’avocate et ensuite faire de la politique. Pour le moment, la politique est un chapitre clôturé.
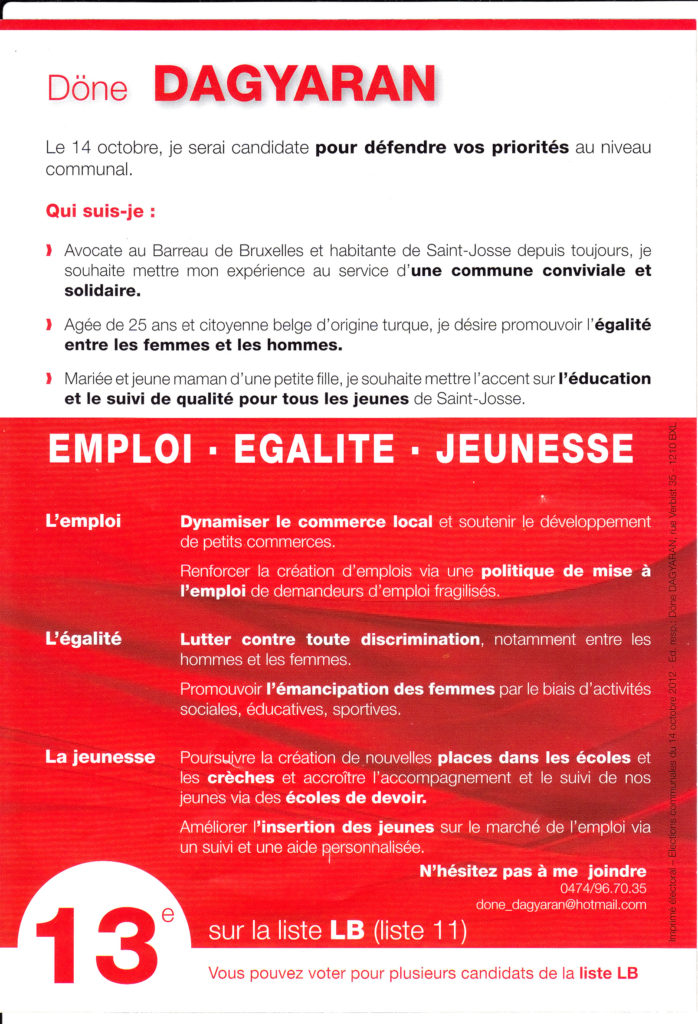
- Le soutien à l’université, cela existait-il ?
J’avais besoin d’aide, mais je n’ai trouvé personne en fait. J’ai cherché de l’aide, entre autres, par rapport au français. Cette difficulté ne m’a jamais lâchée. J’avais beaucoup de difficultés avec les termes juridiques quand le sens varie en fonction du contexte. Voilà, j’ai dû beaucoup investir pour étudier. Je n’avais presque plus de vie sociale.
Il y avait un système de tutorat. Un étudiant d’une année supérieure nous aidait à préparer les examens oraux, à préparer certaines matières. Il nous expliquait comment s’y prendre pour étudier et nous passait des résumés. Il restait notre référent, mais, à un moment, je devais étudier toute seule.
- Y a-t-il beaucoup de filles de ta génération qui, comme toi, ont fait des études ?
Personne. Dans ma génération, personne n’a fait des études. Parmi les copines avec lesquelles je jouais, personne n’a poursuivi des études. Je suis restée seule à faire ce parcours, mais cela t’isole aussi. Tu développes une certaine vision de la société et une connaissance du monde. D’un autre côté, tu es en décalage avec ton environnement, car tu n’es plus dans leur monde social. Tu n’as pas le temps d’aller boire un thé l’après-midi, parce que ton métier, ta famille prennent tout ton temps, mais aussi parce que tu as une approche intellectuelle qui ne correspond plus à ton milieu d’origine. Tu es en décalage. Tu es aussi en recherche d’identité…
- Ton parcours est exceptionnel, tu es courageuse et volontaire !
Je suis une intellectuelle, mais, pour moi, c’est une question de dévouement et d’engagement personnel. J’ai eu beaucoup de chance de tomber sur des personnes exceptionnelles comme Brigitte Dayez, comme Monique Parker. Ces personnes ont été, pour moi, un modèle que j’ai toujours voulu suivre.
Un soutien au sein de la famille, au sein de la communauté turque ?
- Dans ta famille, combien êtes-vous ?
J’ai une sœur et un frère ainsi qu’un demi-frère, fils du premier lit de ma mère. On a renoué les contacts après trente ans de séparation, c’est aussi une histoire. Ma sœur est, pour le moment, étudiante à la Vrije Universiteit Brussel (VUB). Elle est néerlandophone parce que nos parents, à un moment donné, ont habité la commune de Tervuren et elle a suivi l’enseignement néerlandophone. Aujourd’hui, elle poursuit son parcours à la VUB. Mon frère est francophone. Il n’a, par contre, pas fréquenté les écoles de devoirs. Il ne s’est pas investi autant que moi dans les études. Il a fait un passage par l’université, Solvay, mais cela n’a pas marché et il a passé les examens d’inspecteur de police et c’est ce qu’il fait maintenant.
- Trois enfants, trois réussites, soit dans un métier, soit dans les études : vos parents vous soutenaient-ils ?
En fait, mon père ne se souciait pas de notre éducation. Son monde était partagé entre sa famille et son milieu personnel. Il passait son temps dans les cafés turcs de la place à Saint-Josse. Ma mère travaillait comme aide-ménagère et fréquentait de ce fait des familles belges chez qui elle faisait le ménage. Ma mère appréciait les gens éduqués et donc elle encourageait les études.
- C’est remarquable. Avait-elle fait des études en Turquie ?
Non, mes parents sont issus d’un milieu rural. Ils viennent du village de Güveççi, dans l’entité d’Emirdağ. Leur niveau d’éducation, c’est l’école primaire, ce n’était pas très élevé. À Bruxelles, ma mère fréquentait une école de devoirs, les dimanches de 13 à 16 heures, située rue Potagère (Saint-Josse). Il y avait là une association qui donnait des cours de français. Elle fréquentait cette école, mais cela restait insuffisant pour maîtriser la langue. Cette génération aussi a été confrontée à ses propres problèmes. Elle devait d’abord compter que sur elle-même : travailler et s’intégrer. Nos parents avaient leurs propres charges. Il y avait aussi un choc culturel. Quand il y avait un retour au pays natal, ils étaient considérés comme différents. Ils avaient changé. Ce n’était plus pareil. Je pense qu’ils ont aussi perdu une part de leur identité.
Je constate par exemple que ma mère était aussi en décalage avec son milieu, parce qu’elle m’encourageait à faire des études. Les autres dames qu’elle fréquentait, lui disaient : « Qu’est-ce que tu vas faire demain quand ta fille sera diplômée, qu’elle trouvera quelqu’un que tu ne connaîtras pas ? ». Ces dames ont dit à ma mère : « Tu n’as pas su contenir ta fille ». Elles ne prenaient aucun risque avec leurs filles et les gardaient sous leurs ailes. Vous pouvez aussi influencer vos enfants en ne soutenant pas leurs études. Il faut « contenir » les filles qui ont envie de prendre leur envol. C’est à la fois psychologique et culturel.
Dans l’exercice de sa profession d’avocate…
J’habite maintenant en périphérie bruxelloise. J’ai un jardin. J’avais besoin de la nature. Je reçois mes clientes dans mon cabinet à Bruxelles, mais je dirige mes dossiers à partir de chez moi. J’ai de la place. Je suis au calme. Personne ne m’interpelle quand je suis dans la rue. À Saint-Josse, je devais faire tout le temps de l’assistance juridique. Les gens m’accostaient parce que j’étais avocate, mais aussi parce que j’étais entrée en politique. C’est une réalité. C’est le côté populaire de l’homme ou de la femme politique, mais cela m’a usée quelque part. Je devais faire chaque chose en son temps et j’ai tout fait en même temps.
- C’est une forme de reconnaissance, mais cela ne t’arrange pas tous les jours. Tu as l’avantage de la proximité et de la langue.
Oui, sans doute. Le milieu associatif reste primordial pour venir en soutien, pour les filles surtout. Je trouve que le combat n’est pas terminé pour les femmes. Quand j’observe mes clientes, je constate les obstacles auxquels elles doivent faire face : les filles doivent toujours étudier plus, se battre pour avoir les mêmes droits que les garçons. Malheureusement, dans les communautés turque et marocaine, nous avons toujours un modèle de femme – et cela commence par notre maman –, qui doit s’occuper de tout, et, en même temps, s’autonomiser financièrement, car le mari ne se préoccupe pas d’apporter un revenu dans le ménage. Il ne prend pas ses responsabilités. Prendre son envol, cela reste difficile. Cela reste très dur pour les femmes.
Je constate souvent dans ma vie professionnelle que les problématiques ne changent pas. Une cliente vient me voir, son époux ne participe aucunement aux besoins financiers du ménage, et elle hésite à entreprendre une action en divorce parce qu’elle n’a pas les moyens financiers, parce qu’elle n’a jamais travaillé en Belgique, parce qu’elle n’a pas le droit au chômage. Elle a quatre filles, dont l’aînée de 19 ans a commencé cette année l’université. Elle accompagne sa mère à mon cabinet. Je me suis revue quelque part dans cette fille. Il y a quinze ans d’écart entre elle et moi, et j’observe que les problèmes restent identiques. Nous sommes toujours les assistantes de nos mères. Nous devons les tirer. Nous devons être les médiatrices entre le père et la mère, mais, en même temps, nous devons sauver notre propre vie en étudiant. Si tu ne fais pas d’études, tu es quelque part condamnée à reproduire le modèle. Pour moi, c’était ma seule issue, c’était ma liberté, c’était ma force. Je ne vois pas ce que je serais devenue si je n’avais pas fait d’études, avec cette vision machiste de la société qui existe encore surtout dans nos communautés d’origine turque ou marocaine.
- Comme avocate, tu peux devenir aussi un modèle pour les jeunes filles qui accompagnent leur mère ?
Absolument. Je fais mes consultations en turc évidemment, car la maman ne comprend pas le français. Elle est accompagnée par sa fille, parce que c’est elle qui tire sa maman. C’est plus complexe que la seule barrière de la langue. C’est une barrière culturelle et financière. Quand je lui demande pourquoi elle n’a pas appris le français alors qu’elle est en Belgique depuis vingt ans. Sa réponse est la suivante : « Mon mari ne m’a pas permis de fréquenter une école de langues ou école de devoirs, parce que les femmes qui fréquentent ces écoles sont des “putes”, divorcent, sont des mauvaises femmes ! ». L’idée reste ancrée que les femmes éduquées, celles qui travaillent, sont des « putes ». Celles qui ont une autonomie financière sont des mauvaises femmes, ce sont des femmes qui affichent une certaine liberté sexuelle, etc. Cette vision existe encore aujourd’hui.
- Tu es avocate et les gens te consultent ?
En ce qui me concerne, on peut parler d’une réussite sociale, mais pas d’une réussite culturelle. C’est un échec sur le plan culturel. J’ai été rejetée par ma communauté quand j’ai décidé d’épouser un monsieur d’origine kurde. Ce que je veux dire, c’est que nous, les filles, sommes confrontées à des règles communautaires et culturelles qui changent très peu. Alors, la distance s’installe.
Un interprète me demandait l’autre jour pourquoi je faisais du droit des étrangers surtout, en pro deo et que je ne traitais pas des dossiers en affaires privées pour les membres de ma communauté. Il disait que je pouvais gagner beaucoup d’argent ! Je fais en effet du droit des étrangers, de la personne handicapée mentale, du droit de la jeunesse. Je fais beaucoup de pro deo. C’est peut-être un signe aussi, une volonté de rupture de ma part, je ne sais pas. En fait concrètement, nous sommes attachées à une section pour laquelle nous devons passer des examens de maîtrise du contenu et suivre régulièrement des formations. Je suis inscrite dans deux sections, le droit d’asile et le droit des personnes handicapées mentales. Quand nous avons nos formations, dix heures par an, je retrouve la communauté des avocats. C’est intéressant, mais là aussi, je constate une séparation entre les avocats belges et ceux qui sont d’une autre origine. Il y a comme une barrière culturelle. Les Belges ont leur clan, et les avocats « d’origine », les Africains, les Marocains, sont dans un autre groupe. Ce n’est pas systématique, mais c’est ce que j’observe. Les barrières culturelles sont difficiles à franchir.
- En guise de conclusion
La mission remplie par les écoles de devoirs et par les asbl, comme le soutien aux femmes, surtout aux femmes issues de nos communautés culturelles, n’est pas terminée. Il y a encore beaucoup de travail à faire, dans la sphère privée et dans leur environnement socioculturel. C’est un travail à la fois psychologique et culturel.
Notes
[1] Liénard G., « Les écoles de devoirs : actions et défis », dans Dynamiques. Histoire sociale en revue, n° 13 : Les écoles de devoirs : regard de l’histoire sur des mobilisations actuelles, décembre 2020, p. 8, mis en ligne le 18 décembre 2020. URL : https://www.carhop.be/revuescarhop/wp-content/uploads/2021/01/2021_RD_13_art1_GLienard_VD.pdf
[2] Voir « Les écoles de devoirs et les volontaires, regard de Brigitte Dayez-Despret », p. 2, dans Dynamiques. Histoire sociale en revue, n° 14 : Les écoles de devoirs (partie II) : Des expériences militantes, mars-juin 2021, mis en ligne le 1er juin 2021. URL : https://www.carhop.be/revuescarhop/index.php/2021/05/04/les-ecoles-de-devoirs-et-les-volontairesregard-de-brigitte-dayez-despret/.
[3] Voir « Les écoles de devoirs et les volontaires, regard de Brigitte Dayez-Despret », p. 2, dans Dynamiques. Histoire sociale en revue, n° 14 : Les écoles de devoirs (partie II) : Des expériences militantes, mars-juin 2021, mis en ligne le 1er juin 2021. URL : https://www.carhop.be/revuescarhop/index.php/2021/05/04/les-ecoles-de-devoirs-et-les-volontairesregard-de-brigitte-dayez-despret/.
POUR CITER CET ARTICLE
Référence électronique
COENEN M.-Th., « Du côté des « usagères » des écoles de devoirs. Un parcours singulier : Döne Dagyaran, avocate », Dynamiques. Histoire sociale en revue, n° 14 : Les écoles de devoirs (partie II) : Des expériences militantes, mars-juin 2021, mis en ligne le 1er juin 2021. URL : https://www.carhop.be/revuescarhop/


