Pierre Tilly
Historien, HELHa et UCL Mons
Contrairement à d’autres continents où les recherches sont plus abouties, la question du travail au sens large dans le monde colonial africain occupe encore aujourd’hui une place marginale dans l’historiographie. Elle a retenu pourtant l’attention des sociologues et des anthropologues au moment même de la colonisation et elle a suscité des débats parfois controversés sur l’exploitation de la main-d’œuvre, le travail forcé ou sur la productivité supposée inférieure de l’Africain par exemple. Ces controverses et discussions ont par ailleurs connu un prolongement durant la période postcoloniale.[1] Rappelons à ce sujet qu’à partir des années 1990, un renouveau dans la lutte contre les discriminations a conduit à s’interroger de plus en plus sur les liens possibles entre des situations de domination passées et actuelles. Le champ reste toutefois globalement en friche dans le domaine de l’histoire et notamment sur le contexte spécifique et les caractéristiques et singularités du monde du travail au Congo belge. Une interrogation majeure doit pouvoir soutenir de plus en plus cette réflexion et constituer un changement probant par rapport à la période coloniale justement. Comment faire parler et donner à entendre la parole des « sans-voix » qui constituent la majorité des personnes concernées par cette question du travail colonial ?
Pour éclairer cette question, notre contribution s’articule essentiellement autour de deux parties qui se veulent complémentaires. L’une est de nature plus méthodologique et pragmatiste, dans le sens où elle aborde cette histoire du travail dans une perspective « empirique », celle de l’histoire « telle qu’elle se fait »[2], plutôt qu’« épistémologique », ce qui reviendrait à privilégier les approches plus théoriques et philosophiques de l’histoire. L’autre partie se propose d’apporter quelques éclairages en prenant l’histoire « à rebours », en établissant des liens entre des réalités du monde du travail anciennes et toujours actuelles autour de permanences, de basculements, de ruptures qui sont essentielles pour comprendre les évolutions sur le temps long. La connaissance du contexte ne suffit pas en elle-même à apporter des réponses aux questions posées, mais elle nous rappelle l’importance d’éviter les anachronismes consistant à calquer les concepts situés historiquement sur des processus et des situations relevant d’autres temps et d’autres lieux. Il faut éviter d’établir des causalités historiques qui expliqueraient seulement des discriminations actuelles par l’analyse de l’ancien ordre colonial et mettre de côté les généralisations abusives qui minimisent les singularités et les différences entre les espaces et réalités considérés. Le thème du travail, comme d’autres d’ailleurs, bouscule le découpage en aires culturelles en invitant à des comparaisons et des analyses croisées d’une aire à l’autre. En ce sens, la multiplication et la confrontation de travaux portant sur des territoires et des espaces temporels différents ne peuvent qu’être encouragées.
Le travail a une histoire et il est le fruit de l’action de la société et des individus à travers le temps. Son contenu n’est pas identique selon les aires culturelles et les époques comme le montre le cas du Congo belge, à la fois singulier et illustratif de tendances plus générales. Il nous invite à nous pencher sur une histoire plus vaste liée au monde méditerranéo-asiatique et musulman et à celui de l’océan Indien, en l’absence des Européens, prenant résolument en compte la période précoloniale pour comprendre que l’on ne part pas de rien. Renouveler les analyses en situation coloniale des classes laborieuses et leurs capacités d’agir.
Une histoire du Congo belge au travail n’est pas aisée à appréhender dans sa totalité. Le jeu d’échelles est particulièrement difficile à articuler, que ce soit du local au global ou inversement. Les colonies ne se résument pas à de simples extensions marginales d’une histoire nationale ou à un prolongement du pouvoir et de la culture de la métropole. Les traits spécifiques de l’histoire de l’Afrique, définis par des facteurs locaux comme le poids de l’économie paysanne et informelle à forte intensité de main-d’œuvre, doivent nécessairement être pris en compte en raison de leur impact majeur sur les entreprises coloniales, les structures économiques et sociales coloniales. Et la capacité d’agir de manière autonome dans le chef des autorités locales comme des colonisés constitue une clé de compréhension supplémentaire et indispensable du système colonial comme l’ont démontré des travaux majeurs depuis deux ou trois décennies.[3] On peut l’illustrer au travers du maintien des pouvoirs coutumiers et leur participation à la mobilisation de la main-d’œuvre. Ce système que l’on retrouve notamment au Congo belge génère des rapports de force et des luttes d’influence qui sont complexes et qui montrent que l’autorité coloniale est loin d’être absolue et inébranlable.
Les formes de résistances des travailleurs et/ou les représentations du travail occupent une place de plus en plus importante dans les travaux actuels et permettent de révéler certaines stratégies d’autonomie d’une catégorie de travailleurs locaux et de les mettre en perspective avec les contraintes économiques et politiques exercées par le pouvoir colonial.[4] À l’alternative simpliste collaboration/résistance, des travaux récents ont substitué des analyses centrées sur la capacité d’initiative et d’action des dominés (agency en anglais), proposant ainsi une appréhension beaucoup plus fine des stratégies individuelles et collectives d’accommodement et de distanciation avec une domination brutale, mais matériellement et culturellement incapable de tout contrôler. Les Colonial Studies invitent donc à une recomposition de l’histoire coloniale en insistant sur la complexité de cette histoire partagée qui doit être écrite de plusieurs points de vue et à plusieurs voix.[5] À ce premier défi s’ajoute celui que constitue un objet historique presque expérimental à savoir l’étude des sociétés qui ont existé pendant quelques décennies et qui se sont ensuite défaites totalement ou partiellement.
Un élément essentiel est, en tout cas, à souligner si l’on veut s’inscrire dans une histoire du monde du travail digne de ce nom. Ce n’est pas seulement l’histoire des politiques, des décisions de l’administration coloniale, le rôle et l’influence des élites qu’il faut appréhender, mais aussi la vie de la population au travail, les réalités de terrain qui l’accompagnent et sa capacité d’affecter le cours de l’histoire.[6]
Cette démarche pose inévitablement la question des sources. Celles de l’histoire africaine d’avant la colonisation sont nombreuses et diverses, la relativité des données documentaires disponibles permettant une prise en compte systématique du point de vue des colonisés représente certes une réelle difficulté pour la période de la colonisation.[7] Remises en cause par les études postcoloniales au travers de perspectives « afrocentrées » qui déconstruisent « l’héritage biaisé de cette “bibliothèque coloniale”, où des concepts apparemment banals véhiculent inconsciemment des clichés séculaires » [8], ces sources n’interdisent pas pour autant de privilégier une histoire, ancrée dans les réalités de terrain, qui aborde, au côté de la doctrine et des normes, la philosophie de l’humain, les modes de gouvernement entre l’administration et les populations locales, et les pratiques de gestion liées au travail dans leur dimension quotidienne et presque banale.[9]
La question de la méthode est tout aussi fondamentale que celle des sources. Portée par de nouveaux courants de recherche qui prennent en compte un cadre global et la dimension normative, une approche postcoloniale accorde une place centrale aux modes de vie, de travail et de consommation loin de la société occidentale qui repose essentiellement sur l’idée du salariat comme pierre angulaire de l’organisation du travail et des relations qui y sont associées. Tout en prenant en compte un cadre général et normatif, un travail empirique sur les sociétés et les situations coloniales, sur le fonctionnement de cet écosystème dans leurs particularités apparaît essentiel. Il passe par une analyse pointue des formes de domination du colonialisme et des mesures visant à réformer ce système dans la réalité concrète. Les oppositions classiques entre travail libre et non libre, travail rémunéré et non rémunéré, formel et informel sont désormais clairement remises en cause et doivent être appréhendées de manière dynamique tant au niveau de l’exploitation des sources existantes que dans la problématisation et la phase d’analyse et d’interprétation des données historiques disponibles.
Les réalités du travail colonial à rebours
L’analyse historique par nature complexe et multiforme du travail en Afrique au sud du Sahara invite à prendre d’emblée plusieurs précautions. La première a trait au concept de travail dans cet espace qui, derrière une apparente singularité et uniformité, cache une multitude de réalités et de pratiques. Si l’on adopte un point de vue occidental, l’accent sera mis en général sur plusieurs dimensions distinctes du travail comme le fait de produire les biens nécessaires à la société. Et puis, il représente le moyen principal pour l’individu de subvenir à ses besoins vitaux grâce au salaire fourni. En Europe à tout le moins, le travail est devenu progressivement un principe dirigeant la vie de chacun.e avec l’industrialisation qui commence au 18e siècle. Les relations sociales sont progressivement réduites à la dimension laborieuse. Le travail en tant que concept ou notion juridique n’est entré dans les discours et les pratiques que depuis le milieu du 19e siècle.
En milieu colonial, la pratique précède et s’impose souvent face au droit et aux principes, ce qui s’explique notamment par l’hétérogénéité des situations, mais aussi par la volonté des acteurs de terrain. La manière de penser et de comprendre le travail en situation coloniale est d’une tout autre exigence vu la difficulté de l’appréhender dans le contexte de pays non industrialisés. Il faut donc se munir de l’outillage méthodologique adéquat en s’appuyant sur d’autres disciplines que l’histoire. Le monde du travail colonial exige en fait une approche nuancée loin de l’idée préconçue d’une prolétarisation progressive et linéaire de la main-d’œuvre de la colonie, conduisant à un mouvement et un combat social identiques à ce qui s’est passé en Europe. Plusieurs spécificités par rapport aux pays industrialisés ressortent, de manière évidente, comme l’absence d’un marché du travail du fait de la faible incitation salariale, le fait que le régime du travail est largement dominé par la question sociale ou encore la liberté du travail qui est globalement absente dans les faits même si elle est affirmée sur le plan des discours.

Quelques exemples vont permettre d’illustrer notre propos sur les spécificités du sujet qui nous occupe. Après les tâtonnements et l’arbitraire généralisé des premiers gouvernants sous l’État indépendant du Congo, la réglementation générale du travail est établie par la Belgique souveraine depuis 1908 sur le territoire congolais. L’action sociale des autorités politiques au Congo belge dans le domaine social et dans les relations de travail constitue un terrain particulièrement révélateur de la dialectique existant entre les régulations émanant de l’ordre colonial d’une part et les réalités de terrain d’autre part. La législation sociale dans la colonie belge commence timidement avec l’apparition des assurances sociales en 1942 au bénéfice des travailleurs blancs pour répondre aux contingences et aux nécessités de la guerre. Puis, à partir de 1945, la situation évolue clairement, liant désormais de manière étroite la croissance économique et le progrès social au bénéfice d’un certain nombre de travailleurs autochtones employés par les grandes entreprises. Réalisée parfois en concertation avec les employeurs et les lobbys coloniaux, cette activité réglementaire instaure une claire distinction entre Européens et Congolais, laquelle conduit à de nombreuses discriminations au détriment de ces derniers. Les travailleurs des colonies et des empires demeurent soumis à des statuts et à des modes d’exploitation différents de ceux des pays industrialisés. Dans le cas plus précis de la législation du travail, elle ne peut se comprendre sans référence à la spécificité du rapport au travail dans la société concernée. Elle n’est clairement pas identique à celle de la métropole même si la pression de certains acteurs comme les syndicats de Blancs poussent en ce sens. L’adaptation aux réalités locales, aux usages et coutumes est permanente. Elle concerne moins le cadre normatif qui est élaboré surtout par les autorités coloniales sans implication directe des principaux concernés que les pratiques de terrain, ce qui pose la question de l’influence des pouvoirs locaux et de son évolution.
Un autre exemple est le faible rendement de la main-d’œuvre africaine, qui est souvent avancé comme argument par l’autorité coloniale et les employeurs contre une augmentation des salaires. Il correspond à une image stéréotypée du travailleur africain profondément ancrée dans l’histoire coloniale. Dès l’entrée dans une phase d’industrialisation, ce sujet retient particulièrement l’attention des chefs d’entreprise et des scientifiques. L’adaptation du travailleur africain au travail industriel devient l’objet d’un vaste débat qui mélange des points de vue parfois fort opposés. Migration, faible productivité, inefficacité, manque de motivation, indifférence aux incitations, travail limité au strict nécessaire, instabilité dans l’emploi, tels sont certains des signes d’inadaptation au travail industriel que les premiers auteurs relèvent chez le travailleur africain.[10] D’autres facteurs, comme les constantes pannes de machines, la fréquence des changements d’emploi, la modicité de la rémunération et l’irrégularité de son versement ou encore les mauvaises conditions de travail, sont rarement évoqués, en revanche, à l’époque de la colonisation.
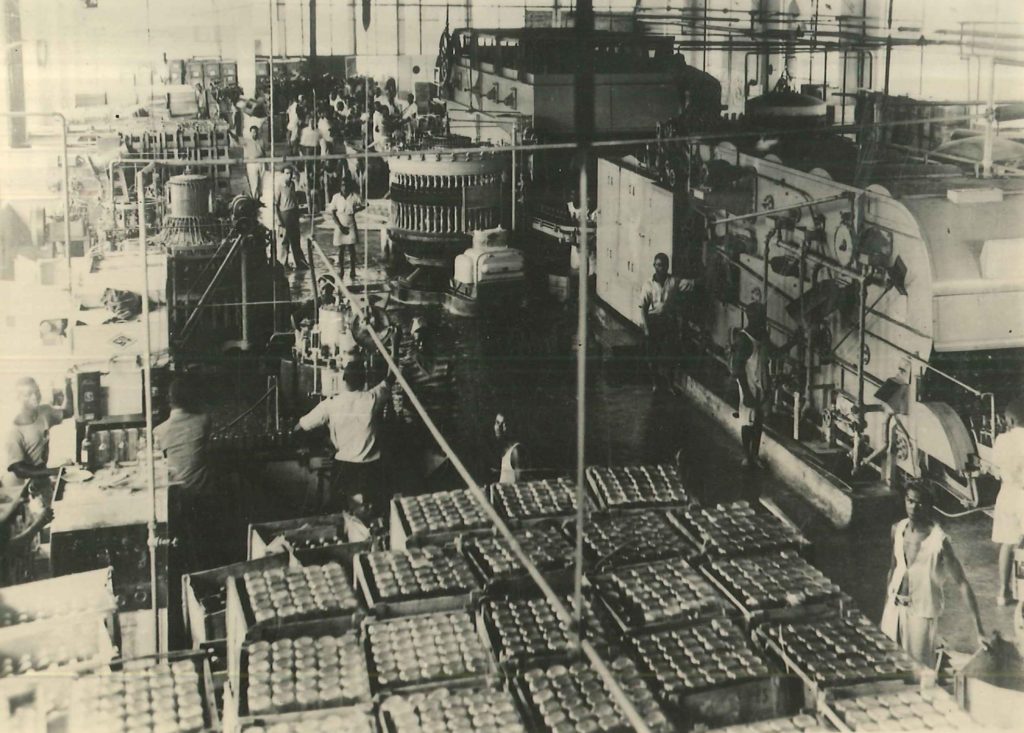
Enfin, et ceci a moins attiré l’attention des chercheurs, il y a le développement, certes lent et fragile, de négociations collectives et de la concertation sociale dans les espaces coloniaux, qui prend forme dans les années 1950 en Afrique centrale et équatoriale. L’un des progrès importants acquis au plan social juste avant l’indépendance du Congo réside dans l’ébauche d’un système de concertation sociale entre 1957 et 1960. Il connaît une sorte de climax lorsque les acteurs, patrons et syndicats (dont des représentants congolais), se réunissent à Léopoldville au printemps 1958 pour discuter de questions liées au marché du travail. C’est une page nouvelle et prometteuse qui s’annonce avec une collaboration possible, organisée, entre travailleurs indigènes et patrons européens sur des bases moins inégalitaires. Cette période doit être analysée en regard de la naissance et du développement d’un syndicalisme congolais dont les caractéristiques sont profondément marquées par le mouvement ouvrier belge et qui suscite l’intérêt de nombreux observateurs dans l’après-Seconde Guerre mondiale.[11] Et le syndicalisme représente sans conteste l’un des aspects les plus controversés au Congo car requérant un préalable essentiel : faut-il ou non permettre aux travailleurs congolais de se syndiquer ?[12]
Le rôle joué par le syndicalisme dans la colonie ne peut être réduit à la seule défense de revendications matérielles au bénéfice de leurs adhérents et des travailleurs en général et ne peut se comprendre sans le contexte général des autres colonies. Un coup d’œil comparatif sur la situation existant dans les colonies africaines offre un tableau contrasté. Dans certains cas, les organisations syndicales vont aller jusqu’à contester la domination coloniale. Dans de nombreux cas, le syndicalisme est le seul moyen d’expression politique pour les populations dominées pour autant qu’il fasse l’objet d’une reconnaissance légale, ce qui survient à des périodes différentes selon les empires coloniaux. En 1930, les syndicats sont autorisés dans les colonies britanniques. C’est ensuite le cas en 1937 dans les colonies de l’Afrique occidentale française, mais uniquement pour les titulaires de certificats d’études. Cette liberté syndicale constitue un progrès bien réel et permet de libérer des forces militantes conduisant à l’émergence des premières formes de syndicalisme qui vont se maintenir également durant la période vichyste (1940-1944). Au Congo belge, le dossier du syndicalisme est particulièrement lourd en conflits, tensions, rebondissements et évolutions. Il faut le replacer dans une chronologie pour saisir la généalogie de cette question.
Dépasser les clichés et stéréotypes et oser affronter la complexité
Dans l’esprit de beaucoup, l’histoire du travail en Afrique se limite à celle d’une force de travail subordonnée, sinon soumise à un degré extrêmement poussé au capital. Et l’économie africaine se caractérise par une production « traditionnelle » résiduelle condamnée à disparaître progressivement au 20e siècle face à une modernité apportée par la colonisation et les échanges marchands. Dans les faits, la plus grande partie de l’Afrique subsaharienne est colonisée à un moment où l’industrialisation de l’Europe crée ou élargit les marchés de diverses marchandises qui peuvent être produites de manière rentable sur le continent africain. L’industrialisation, certes modeste en regard de celle du monde occidental à la même époque, y fait baisser les coûts de la coercition et du contrôle. Elle crée des incitants pour les pays en retard de développement suivant les standards européens, comme le Portugal, qui vont chercher de nouvelles ressources outre-mer. Les empires qui dominent alors le commerce européen avec l’Afrique, comme le Royaume-Uni, ont de leur côté des motifs économiques de vouloir consolider leur position par des annexions. L’effondrement à l’échelle régionale des fragiles systèmes agro-démographiques indigènes en a parfois résulté, même si des précédents en la matière ont existé avant la colonisation. La rencontre coloniale a aussi été marquée par le passage brutal à une forme d’État moderne dans des sociétés d’une tout autre nature et la greffe n’a pas automatiquement pris. Les nouveaux modes d’autorité qui prennent place au travers de la loi et du droit occidental tranchent avec les coutumes et traditions locales même si celles-ci sont loin de disparaître dans leur totalité.
Dans les sociétés africaines précoloniales qui ne sont pas qu’autarciques, le panorama du travail est pour le moins différent, car l’activité agricole de subsistance dispense la population d’aller vendre sa force de travail loin de ses terres. L’héritage précolonial doit en fait entrer en ligne de compte pour comprendre les ressorts profonds du travail en Afrique. Avant l’arrivée des Européens, le continent africain n’est pas dominé exclusivement par des formes classiques du travail, si caractéristiques des pays industrialisés, comme le travail salarié qui est le résultat d’un mouvement historique s’inscrivant dans le cadre du capitalisme productif.[13] La frontière entre travail salarié et travail forcé, telle qu’elle s’est construite au siècle des Lumières, ainsi que l’utopie de la libération par le travail au 19e siècle sont des concepts et des visions étrangers à la réalité d’une Afrique qui est alors plongée au cœur du système esclavagiste. Le cadre agraire en Afrique durant la période précoloniale fonctionne en partie sur une logique de travail non rémunéré lié aux cultures agricoles, au bétail et à la pêche, dans le sens où ce n’est pas la valeur marchande qui importe le plus, mais bien l’usage que l’on fait d’un objet ou d’une idée. Il se nourrit aussi dans certaines régions des contacts économiques et commerciaux avec l’extérieur. L’échange marchand et la rémunération du travail qui l’accompagne, vue comme une contrepartie, ne représentent qu’une facette dans un large écheveau de réciprocités qui ne sont pas toujours économiques. L’économie informelle qui s’affirme malgré une économie coloniale prédatrice, surtout dans les milieux ruraux, va contribuer au développement d’une économie de subsistance et de résistance face à l’ordre colonial.
L’essentiel est la subsistance et l’existence du groupe et son ordre social lignager dans un contexte d’habitat dispersé.[14] Ces groupes entretiennent entre eux d’intenses réseaux d’alliances conditionnés par la loi d’exogamie qui interdit les relations incestueuses entre consanguins et la nécessité d’échanges économiques pour survivre. Alors que la région des Grands Lacs est caractérisée par l’existence d’une aristocratie foncière historiquement ancienne, le travail de la collectivité rurale s’orchestre dans d’autres lieux sans une véritable appropriation privée du sol, ce qui tranche clairement avec la société occidentale. Les valeurs d’usage des objets échangés déterminent en grande partie la vie sociale. Conditionnés par les puissances de la nature et reliés au monde protecteur de l’invisible, les rapports de production ont une portée bien plus large que la seule dimension économique et renvoient au social et au politique. Les traditions ancestrales façonnent et encadrent les relations professionnelles et elles sont souvent placées sous la direction du « chef de terre » qui joue un rôle religieux plutôt que foncier.[15]
Un monde du travail d’une grande diversité
Le choc technologique apporté par les Occidentaux et l’univers industriel avec sa rationalité occidentale largement étranger au monde du travail en Afrique vont se révéler parfois brutaux pour l’Africain. Mais le changement n’est sans doute pas si radical qu’il n’y paraît. Des méthodes utilisées de production anciennes accompagnent l’instauration du capitalisme en Afrique coloniale comme dans le cas de la production paysanne avec cultures d’exportation agricoles et dans le commerce de détail. On assiste en fait à un croisement entre les sphères domestique et capitaliste et les interactions qu’il produit. Il constitue une caractéristique majeure de la période de transition précapitaliste qui se déploie sur le long 19e siècle. Durant la période coloniale, le travail en Occident s’impose d’abord comme valeur morale. Il étend son emprise à toute une myriade d’activités humaines, passe du règne de la qualité à celui de la quantité, ce qui permet en outre, dès lors qu’il est quantifiable, de le considérer comme une marchandise échangeable.
Cette main-d’œuvre africaine, dont il a déjà été question, est loin d’être homogène et indivisible. Il est donc essentiel d’en déterminer les contours afin de la saisir sous toutes ses facettes. Au sein de ce monde du travail en pleine construction, plusieurs catégories socioprofessionnelles que l’on se risquera à considérer comme idéal type wéberien vont émerger.
Un premier groupe est constitué par des travailleurs actifs dans le mode de production capitaliste. On peut les assimiler à un prolétariat urbain à temps plein avec toutes les réserves d’usage liées au contexte particulier qui les abrite. Bien que cette forme soit la plus dominante en termes de visibilité politique et économique, elle représente une petite partie de la main-d’œuvre coloniale. Les centres urbains qui se développent avec la croissance des villes et les enclaves minières y contribuent en servant d’aimant pour les travailleurs d’une économie formelle en pleine croissance. Craig Phelan considère qu’en 1957, seulement 4,6 % de la population active totale de l’Afrique Occidentale Française a un travail rémunéré.[16] Certes, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, les autorités britanniques et françaises ont accepté que le travail salarié soit un emploi normal pour les Africains et pas seulement une activité secondaire saisonnière en complément de leur activité agricole. Ces emplois et ces formes de travail diverses avec rémunération en argent se retrouvent dans les secteurs administratifs, du commerce, de la construction, de la manufacture et dans les services de sécurité. Les services sociaux tels que les soins de santé et l’éducation offrent également des opportunités d’emploi salarié formel.
Une deuxième catégorie est représentée par une main-d’œuvre agricole qui est en fait très diversifiée entre celles et ceux qui sont enrôlés avec force obligatoire parfois dans le mode de production capitaliste, soit directement à travers le système de plantation, soit indirectement par le biais des petites exploitations agricoles produisant des cultures de rente destinées à l’exportation comme le café, le cacao ou le coton. Mais les paysans congolais sont actifs également dans des cultures agricoles destinées à la consommation au Congo même oscillant entre des formes plus traditionnelles de subsistance, des paysannats dans lesquels les Africains sont les maîtres d’œuvre avec un soutien technique et éducatif du pouvoir colonial et du travail en autonomie, parfois collectif. La diversification des modes de production agricole à partir des années 1920 est à prendre en compte au travers d’une vision dynamique et non pas duale de cette économie agricole congolaise. L’opposition longtemps soutenue entre un secteur marchand, moderne et productif, impulsé par le colonisateur, et un secteur non marchand africain, traditionnel et de survie ne tient plus la route.[17]
Une troisième catégorie qui se dégage possède une forme mixte. Elle illustre le couplage des modes de production capitaliste et précapitaliste ou « locale ». La main-d’œuvre migrante y représente une figure centrale comme principal moyen d’échange entre ces deux modes. Ces ouvriers agricoles migrent au cours des saisons de non-production en agriculture pour travailler dans les mines. Ils retournent dans leurs communautés respectives pour effectuer les travaux agricoles une fois que la saison des pluies survient.

Le panorama de cette main-d’œuvre ne s’arrête pas là. La vente en détail des petits produits importés des points de vente coloniaux constitue un quatrième type de main-d’œuvre. En plus des activités artisanales conçues pour satisfaire les besoins des travailleurs salariés mal payés qui vivent dans les centres urbains ou dans des enclaves de production créées par les mines, cette catégorie fait office de pépinière de développement pour les activités urbaines de l’économie informelle en pleine expansion. On y retrouve de nombreuses femmes comme dans le secteur agricole d’ailleurs. La femme africaine joue un rôle clé et original dans le monde précapitaliste en assumant notamment la responsabilité de la reproduction dans le cadre d’une division sexuelle des tâches[18] Aux hommes, les travaux de force et, pour les femmes, la subsistance et l’éducation. La valeur d’une femme dépend de sa fécondité comme de sa force de travail au sein de la société agraire. Et la polygamie peut adoucir en partie la dureté de ce travail tout en faisant progressivement de la femme, en Afrique centrale plus particulièrement, un bien que le mari peut offrir par courtoisie.[19]
Le travail forcé, un monde d’ambiguïté
La cohabitation entre les pratiques anciennes et de nouvelles formes d’exploitation de la force de travail que produit la colonisation marque la frontière entre travail libre et forcé sous le sceau de l’ambigüité. Depuis le 18e siècle au moins, des études comparatives portant sur les institutions régissant le travail et sur l’évolution des conditions de travail elles-mêmes sont réalisées et permettent de définir au fil du temps une frontière plus ou moins stricte entre le travail libre et le travail forcé. Dans les années 1970, en se fondant sur l’étude de groupes de chasseurs-cueilleurs et d’agriculteurs sur brûlis, Marshall Sahlins reprenant à l’économiste russe, Alexander Chayanov, la notion de « mode de production domestique » défend une thèse audacieuse, à savoir : les sociétés les plus « primitives » vivent dans l’abondance, puisqu’elles jouissent de beaucoup de temps libre. Le travail n’est pas le moteur de l’existence et n’est pas le point cardinal du système de production.[20]
Des recherches récentes remettent de plus en plus en question cette dichotomie entre travail libre et forcé.[21] Elles soulignent l’existence d’un système, plus ou moins stable entre le milieu du 17e siècle et la fin du 19e siècle, dans lequel le travail est similaire à un service. Si bien que les conditions salariales ressemblent à celles des travailleurs domestiques avec des contraintes importantes imposées aux travailleurs souvent mobiles. Ce monde du travail connaît de profondes modifications à la Belle Époque (au début du 20e siècle), avec l’émergence de l’État social et le premier âge d’or de la mondialisation, porté par la seconde révolution industrielle. Ce constat possède une validité générale sur l’ensemble des continents que ce soit l’Eurasie (la Russie et l’Europe), les Amériques ou l’Asie de l’océan Indien. Concernant les colonies africaines, les relations de dépendance des populations locales à l’égard du travail et les contraintes à la mobilité des travailleurs sont profondément inscrites dans la pratique de l’esclavage et ne sont pas complètement modifiées avec la fin de celle-ci. La croissance du travail basé sur le contrat d’apprentissage dans l’océan Indien et du travail forcé en Afrique marque à la fois la diversité des pratiques en termes de contrat, mais aussi leur adéquation avec le développement d’un capitalisme basé sur le recours intensif à la main-d’œuvre.
Les intentions économiques de la colonisation clairement exprimées ne laissent pourtant planer aucun doute sur les motivations qui la soutiennent, à savoir capter les ressources existantes sans se préoccuper de les produire, ni moins encore de les reproduire, et sans associer l’ensemble de la population aux bénéfices de la production. Dans ce but, le système s’appuie sur l’impôt et la contrainte avec des résultats en sens divers. En matière de gestion de la main-d’œuvre, on s’ingénie à l’attirer à tout prix vers les pôles de mise en valeur. Le travail forcé représente à bien des égards une réponse à la pénurie de main-d’œuvre indigène existante dans de nombreuses colonies africaines jusqu’à la Seconde Guerre mondiale. Mais tout n’est pas aussi simple que ce que les apparences semblent l’indiquer. Une forme de duplicité est en fait au cœur de ce système. Les relations de travail dans les plantations, par exemple, sont marquées par le passage d’une simple relation de maître à serviteur à une situation bien plus complexe de subordination et de dépendance. Plus globalement, la valeur « libératrice » du travail ou sa « vertu éducative » est portée au fronton de l’administration coloniale belge comme base du succès de l’entreprise coloniale, justifiant du même coup la pratique du travail forcé. La coexistence entre différents moyens de coercition et des tentatives de réformes sociales visant à améliorer le sort des populations placées sous le joug colonial reste une constante durant la domination des empires d’outre-mer. D’où cette ambiguïté presque immanente qui subsiste tout au long de la période coloniale dans le domaine du travail. Il faut, par exemple, prendre en compte le fait que les premiers textes significatifs relatifs au droit du travail ne sont adoptés que dans les années 1930. Le but est alors d’organiser le recrutement de la main-d’œuvre et, de manière subsidiaire, sa protection. Mais c’est après la Seconde Guerre mondiale que des avancées significatives sont engrangées notamment sous la pression des syndicats.

Pour mesurer la capacité d’adaptation des Africains à l’évolution de leur environnement, identifier les mutations de leurs conditions d’emploi par les firmes étrangères et l’évolution de leur perception du fait colonial, sans oublier les interactions qu’elles produisent entre les acteurs, la voix des colonisés est essentielle. Il s’agit de faire du colonisé un sujet actif de cette histoire. Dès l’origine, les sociétés coloniales n’ont pu fonctionner dans la longue durée qu’avec la participation active, mais forcée et contradictoire, des colonisés.
Cela ouvre une question passionnante si l’on veut précisément prendre en compte l’Africain qui est en situation de domination. Il faut en ce sens accorder une attention particulière aux réactions des populations locales face aux politiques menées qui vont de la soumission la plus totale à différents types de résistance. A priori, la réalité parait figée. Une partie des élites traditionnelles locales instrumentalise la domination étrangère et s’occidentalise pour asseoir son propre pouvoir. Ainsi par exemple au Ruanda-Urundi, la minorité tutsie favorisée par le colonisateur belge impose-t-elle ses vues à la majorité hutue. La Belgique contribue à cliver des différences socioprofessionnelles en créant une opposition entre les Tutsis « hamitiques » et les Hutus, peuple bantou, considérés comme inférieur.[22] Pour celles et ceux qui ne relèvent pas d’une élite traditionnelle locale, celles et ceux que l’on appelle le monde d’en bas, il ne resterait que la soumission et la résignation comme seule issue. Le choix de la soumission au diktat des entreprises, dans l’espoir d’acquérir des marchandises d’importation, est adopté aussi par certaines populations dans d’autres contextes.
Se limiter à ce constat de la soumission revient à sous-estimer la capacité de résistance que cette histoire du travail révèle. Confrontés à la radicalisation des méthodes de collecte (travail et réquisitions forcés, prise d’otages pour non-paiement de dettes, impôt de capitation, etc.), les Africains manifestent des réactions en sens divers s’inscrivant parfois dans des dynamiques bien plus anciennes. Cette histoire de la résistance à la colonisation est ainsi parcourue de moments mobilisateurs et d’actions concrètes de masse qui marquent les esprits. Mais on découvre aussi une résistance silencieuse et des réponses inorganisées. Dans d’autres cas qui ne sont pas uniques, les autochtones (natives en anglais) s’opposent aux méthodes d’exploitation développées par les Européens au travers de révoltes, de pillages et d’expéditions violentes.
Des questions centrales en découlent sur notre compréhension des rouages et mécanismes profonds du système et du rôle des acteurs. Sommes-nous en face de pratiques de nature commune, presque universelles, entre les territoires ou existe-t-il des singularités locales ? Le cas des systèmes fiscaux dans les divers empires est illustratif de ces points communs que partage le Congo belge avec les empires coloniaux voisins, français et britannique.[23] Le capitalisme colonial dans son utilisation de la main-d’œuvre indigène développe des pratiques de nature identique dans les territoires concernés, à savoir l’utilisation généralisée du travail forcé dans les secteurs ferroviaire et routier, dans la construction des ports et dans les exploitations minières. Aucune de ces puissances colonisatrices ne peut se départir d’y avoir recours. Mais ces similitudes ne peuvent cacher de grandes différences de contexte et d’interactions entre les acteurs. Au-delà des similarités, les traits, la trajectoire et les phases dans leur singularité constituent tout autant les déterminants de la structure et du fonctionnement concret de l’État colonial en Afrique qui est loin d’être homogène.
L’intérêt d’une approche comparative ou comparatiste est justement d’identifier également en quoi ces pratiques diffèrent ou sont similaires au-delà des frontières, d’en retracer le cheminement, d’en analyser les mécanismes profonds et les réactions en sens divers qu’elles génèrent.[24] Ce type d’approche ouvre la voie à une compréhension accrue de la logique, des contradictions et de la complexité des systèmes coloniaux sans nier la forte interpénétration qui les relie. La mise en connexion des politiques coloniales sur les relations de travail et de production, sur le rôle de l’État dans la gestion et la régulation du marché du travail et sur les questions sociales à l’échelle des différentes espaces où elles ont existé gagne à être systématisée pour mettre en évidence les facteurs, causalités et interactions globaux qui entourent ces réalités vécues par les travailleurs de divers continents. Mais il faut tout autant prendre en compte les singularités des espaces étudiés et des populations considérées dans l’idée de relier ces deux facettes, globale et locale, plutôt que de les opposer. Ceci représente un travail de recherche autrement plus ambitieux et considérable que la présente contribution, mais son importance mérite d’être soulignée pour apporter de nouveaux éclairages au plan historique mais aussi sur nos sociétés du temps présent qui sont en tout ou en partie des héritages du passé.
Notes
[1] COQUERY-VIDROVITCH C., Petite Histoire de l’Afrique. L’Afrique au sud du Sahara, de la préhistoire à nos jours, Paris, La Découverte, 2016 (La Découverte poche, Essai 451).
[2] NOIRIEL G., Sur la “crise” de l’histoire, Paris, Belin, 1996 (collection Socio-Histoires).
[3] COOPER F., « Back to work : Categories, Boundaries and Connections in the Study of Labour », dans ALEXANDER P and HALPERN R. (eds), Racializing Class, Classifying Race. Labour and difference in Britain, the USA and Africa, London, Palgrave Mac Millan, 2000, p. 213-235.
[4] Pour en savoir plus sur la question des résistances, voir l’article d’Asclépiade Mufungizi publié dans ce numéro de Dynamiques : MUFUNGIZI MUTAGOYORA A., « Résistances des Bashi au travail forcé dans le Kivu sous le régime colonial. Stratégies d’acteurs », Dynamiques. Histoire sociale en revue, n°15-16 : Travail et conditions de travail en RD Congo hier et aujourd’hui, octobre 2021, mis en ligne le 18 octobre 2021. URL : www.carhop.be.
[5] SIBEUD E., « Post-Colonial et Colonial Studies : enjeux et débats », Revue d’histoire moderne et contemporaine, n°51, (5), 2004, p. 87-95.
[6] REDIKER, M., Les Hors-la-loi de l’Atlantique – Pirates, mutins et flibustiers, Paris, Seuil, 2017.
[7] La plupart des travaux historiques se basaient jusqu’à une époque récente sur des sources administratives qui traduisent les points de vue de l’administration (coloniale ou indépendante) productrice de ces archives. Leurs apports sont par nature partiels et les approches qu’on y découvre sont souvent partiales. Il est donc important de les compléter avec des archives privées et des sources orales.
[8]COQUERY-VIDROVITCH C., Petite Histoire de l’Afrique…, p. 16.
[9] MBEMBE A., « Faut-il provincialiser la France ? », Politique africaine, n° 119, octobre 2010, p. 159-188.
[10] OGUNBAMERU O.A., « Le prolétariat africain et le travail industriel : un nouveau point de vue », Revue des sciences sociales : La Démocratisation du travail, 100, vol. XXXVI, n° 2, 1984, p. 358.
[11] Une étude approfondie sort juste après la guerre à ce sujet. CORNEILLE A., Le syndicalisme au Katanga, Elisabethville, 1945. Mais le premier à avoir jeté un regard scientifique sur ce phénomène est le sociologue de l’Université libre de Bruxelles (ULB), Arthur Doucy : DOUCY A. et FELDHEIM P., « Le syndicalisme indigène et l’organisation professionnelle au Congo belge », Le Flambeau, n° 5-6, 1951, p. 519-540. À la fin des années 1950 et au début des années 1960, les analyses se multiplient. Le syndicaliste chrétien Jean Brück secrétaire général de la Confédération des syndicats chrétiens du Congo jusqu’à l’indépendance, y consacre un dossier : « Problème congolais et action syndicale chrétienne », Les dossiers de l’Action sociale catholique, n° 8, octobre 1959, p. 677-690.
[12] DRESCH J., « Méthodes coloniales au Congo belge et en Afrique équatoriale française », Politique étrangère, 12e année, n° 1, 1947, p. 77-89.
[13] Voir, dans ce cadre, notamment les travaux de Catherine Cocquery-Vidrovitch déjà cités.
[14] L’existence et la conscience des liens de parenté entre personnes se réclamant d’un même ancêtre structurent la société traditionnelle congolaise en grands groupes sociaux. L’institution lignagère s’appuie dans la tradition sur deux grands principes : le monopole du pouvoir politique par les lignages fondateurs du village et le monopole du pouvoir social par les ainés de chaque lignage.
[15] COQUERY-VIDROVITCH C., Petite Histoire de l’Afrique…, p. 64.
[16] PHELAN C (ed.)., Trade Unions in West Africa : Historical and Contemporary Perspectives, Bern, Peter Lang, 2012, (Trade Unions, Past, Present and Future, 7), p. 7.
[17] VAN MELKEBEKE S., « Dualisme ou dynamisme ? Une analyse de l’économie rurale congolaise durant l’Entre-deux-guerres », Journal of Belgian History, XLIII, 2-3, 2013, p. 154.
[18] MICHEL A., FATOUMATA-DIARRA A. et AGBESSI-DOS SANTO H., Femmes et multinationales, Paris, Khartala, 1981.
[19] COQUERY-VIDROVITCH C., Petite Histoire de l’Afrique…, p. 83.
[20] SAHLINS M., Âge de pierre, âge d’abondance. L’économie des sociétés primitives, 2e éd., Paris, Gallimard, 2017 (Folio Histoire, n° 264).
[21] COOPER F., « Back to work…, p. 35.
[22] CALVÉ C., « Interview de Pierre Singaravélou. Colons, colonisés, une histoire partagée », Libération.fr, mis en ligne le 30 août 2013, https://www.liberation.fr/planete/2013/08/30/colons-colonises-une-histoire-partagee_928383/, page consultée le 15 février 2016.
[23] Voir à ce sujet GARDNER L.-A., Taxing colonial Africa: the political economy of British imperialism, Oxford, Oxford University Press, 2012.
[24] BONNER P, HYSLOP J et VAN DER WALT L., « Rethinking Worlds of Labour : Southern African Labor History in International Context », African Studies, 6/2-3, august-december 2007, p. 137-168.
POUR CITER CET ARTICLE
Référence électronique
TILLY P., « Travail et conditions de travail au Congo hier et aujourd’hui », Dynamiques. Histoire sociale en revue, n°15-16 : Travail et conditions de travail en RD Congo hier et aujourd’hui, octobre 2021, mis en ligne le 18 octobre 2021. URL : https://www.carhop.be/revuescarhop/
