Pierre Georis (anciennement secrétaire général du MOC)
La Fondation André Oleffe (FAO)[1] a été créée en 1978 dans le périmètre de la CSC en vue d’apporter une aide aux initiatives d’autoproduction/autogestion, une des formes de lutte sociale dans les années 1970[2]. C’est volontairement qu’on qualifie lesdites luttes de deux mots qui ne sont pas synonymes, même si, à l’époque, c’est « autogestion » qui a le plus souvent été utilisée pour désigner les deux réalités. La première était celle d’entreprises qui fermaient : au-delà de l’occupation de l’usine, la résistance a consisté à continuer de produire, faire fonctionner l’entreprise, vendre, protéger l’outil et les stocks. L’objectif était surtout de convaincre un repreneur et/ou de faire pression pour que l’État soit aidant (quitte à ce qu’il soit lui-même repreneur). On est dans le registre de « l’autoproduction ». Au rang des exemples, on peut citer Les grés de Bouffioulx, les Cristalleries du Val Saint Lambert (Seraing), les Capsuleries de Chaudfontaine, les poêleries Somy (Couvin). La seconde a plus à voir avec la perspective d’autogestion proprement dite : des entreprises reprises par leurs travailleurs eux-mêmes. Trois cas emblématiques ont fonctionné : Le Balai libéré à Louvain-la-Neuve, les Sablières de Wauthier-Braine et les Textiles d’Ère (après la faillite de Daphica) à Tournai. Malgré leurs formes hétérodoxes de gestion, ces entreprises ont tenu le coup jusque respectivement 1989, 1990 et 2002. Un peu en situation intermédiaire, une autoproduction qui a tenté l’autogestion mais a rapidement échoué : Salik (Quaregnon). Force est cependant de reconnaître que ces formes de lutte, et la thématique autogestionnaire en particulier, n’ont pas connu le succès espéré. Autrement écrit, ça n’a représenté qu’un moment en définitive assez court[3].
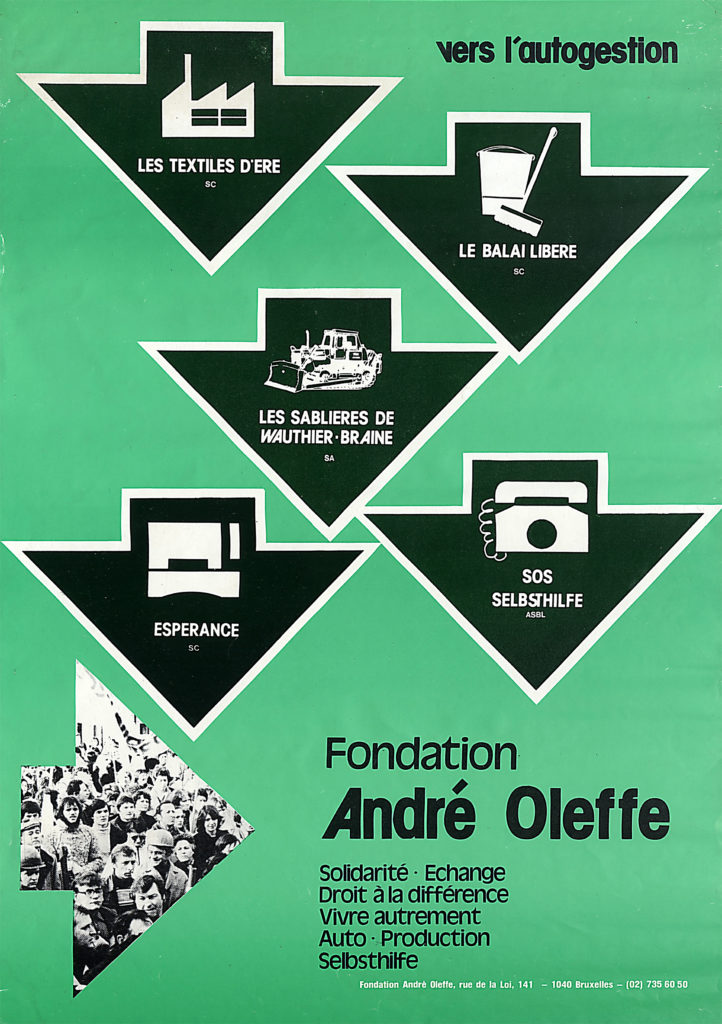
Le soutien syndical a surtout été le fait de la CSC. Côté FGTB, on est resté sensiblement plus prudent. Rétrospectivement, on peut considérer que le soutien de la CSC s’apparentait à la mise en application du principe de « l’autonomie associative » : on accepte l’initiative et l’expérimentation, en particulier au nom de la « subsidiarité » (qu’on peut lire : « les gens sur place sont les mieux à même de juger ce qu’il est bon de faire ») ; les « personnalités meneuses » peuvent être critiquées dans l’organisation syndicale mais elles n’y sont pas bridées. Ainsi l’affaire a-t-elle été menée par quelques fortes personnalités, par exemple Raymond Coumont, secrétaire de la fédération CSC du Brabant wallon, ou Jean Devillé, permanent de la centrale CSC du textile, rejoints par différentes autres individualités (Gilberte Tordoir, Raymonde Harchies, Marc Vandermosten, liste non exhaustive). Pour autant, on ne peut pas soutenir que cela mobilisait l’organisation dans son entièreté : doute au démarrage des expériences, réelle sympathie envers les personnes qui se battent de façon originale, vertes critiques lorsque les choses tournent mal[4].
La FAO est fondée pour apporter des soutiens juridiques, logistiques et financiers à la dynamique, ainsi que pour organiser des synergies entre les initiatives et des homologues à l’étranger. Paradoxalement, elle a été mise en piste pour soutenir l’autogestion au moment précis où la dynamique déclinait. Cela ne l’a pas empêchée de multiplier les initiatives et d’accompagner différentes situations, principalement pour aider à trouver des solutions pour des PME en difficulté et pour prendre des initiatives de lutte contre le chômage, alors en croissance spectaculaire. Un job pas simple, avec des bas, mais aussi des hauts : la FAO a joué un rôle significatif dans l’accompagnement des « Textiles d’Ere »[5] : c’est de l’emploi qui a été préservé pendant 20 ans ; on ne peut pas dire que ce n’est rien, ou qu’il n’y aurait pas de bilan !
Déclin
Le tournant majeur a été l’opération de reprise d’un grand magasin « Les galeries Anspach », renommées « Galeries namuroises » en 1983, en mobilisant du capital de la COB[6] et de la CSC[7]. L’expérience s’est terminée par une faillite en 1988, non sans créer de fortes tensions entre la CSC et la FAO. Au titre de « pouvoir organisateur »[8], la CSC a souhaité reprendre un contrôle plus significatif sur la FAO, ce qui n’a pas été accepté en Assemblée générale de l’ASBL au nom de… la pratique autogestionnaire[9]. En peu de temps, la rupture a été consommée : la FAO est officiellement sortie du périmètre des organisations du MOC, même si, à titre personnel, plusieurs individualités notoirement CSC ont continué à s’y impliquer. Pour retrouver un outil, à présent que la FAO était sortie de son périmètre, la CSC a créé l’ASBL SYNECO, aujourd’hui reconnue comme agence-conseil en économie sociale en Wallonie[10] – c’est un autre récit.

La FAO s’est alors enfoncée dans la crise, sans plus guère de projet clair. Des déficits systématiques ont fait fondre les fonds propres à vive allure. Un permanent CNE-GNC[11], Guy Roba, a tenté une relance, qu’il a partiellement réussie en parvenant à créer une petite cellule spécialisée dans ce qu’aujourd’hui on nommerait de « l’outplacement » (de cadres licenciés). Mais il ne s’est agi que d’un petit sous-ensemble de deux personnes (« cellule accompagnement de cadres ») qui a rapidement fonctionné en autonomie du reste de l’équipe. Une partie significative des travailleurs restait utilement occupée, car impliquée dans des partenariats de longue durée avec quelques ASBL : à la longue, dans les faits, ces personnes s’identifiaient plus aux projets des ASBL concernées, où elles étaient la plupart du temps, qu’à la FAO proprement dite. Le paradoxe était là : la FAO se vidait de sa substance et de son personnel, mais celui-ci continuait à travailler sur les enjeux pertinents de partenaires.

Un épisode EVO
En 1997, les EVO (éditions Vie Ouvrière[12]) ont manifesté leur intention de sauvetage par reprise de l’outil et ont déposé un plan d’affaires, dont le résultat principal a surtout été d’aviver toutes les tensions et résistances internes : c’était perçu comme une OPA hostile – offre publique d’achat – à laquelle il fallait résister de toutes ses forces[13] ! Bien qu’officiellement la FAO était hors périmètre MOC (car hors périmètre CSC), elle y restait néanmoins peu ou prou associée dans les imaginaires, eu égard à la qualité des fondateurs, aussi à la mémoire de la qualité mobilisatrice du militantisme autogestionnaire. EVO de son côté était plus nettement ancré dans le « réseau d’affinité » du MOC même si on avait là aussi à faire à une gestion en autonomie. Les éclats du conflit témoignaient d’une situation de blocage total en plus d’une inefficacité de plus en plus patente dans l’action de la Fondation. D’autorité, François Martou, alors président du MOC, a pris personnellement la main en convoquant une réunion le 6 octobre 1997, qui a associé EVO, FAO, SYNECO et MOC. À l’issue de celle-ci, un protocole d’accord a été signé, qui a consacré le retrait d’EVO et l’entrée en scène du MOC par l’intermédiaire d’un de ses secrétaires nationaux dont le cahier des charges était de « faire atterrir » la FAO en bonne intelligence avec les activités qu’entretemps SYNECO avait développées au titre de nouvelle agence-conseil du Mouvement. On peut sans doute « lire » l’initiative de François Martou comme étant aussi de « police » pour compte de la CSC : faire rentrer la FAO dans le rang ou la dissoudre en en récupérant les actifs (s’il y en a), en tous les cas en faisant le moins de dégâts possible.
Témoignage
À ce moment précis du récit, celui-ci est influencé par la subjectivité du témoignage : c’est celui de l’acteur de « l’atterrissage » – mot plus sympathique que « enterrement » – qui n’est autre que l’auteur de la présente. Son implication : de 1997 à 2006. L’expression d’un unique acteur, se veuille-t-elle réflexive, ne dit jamais « le tout » d’une expérience qui est d’abord collective.
Gestion de crise
Le secrétaire national MOC a été admis à l’Assemblée générale qui a rapidement suivi, dans une ambiance houleuse : au sein de la FAO, l’accord n’était pas moins contesté que le plan précédent (celui de EVO), ainsi d’ailleurs que par le représentant de la famille Oleffe[14] qui, n’ayant pas été associé, estimait que les représentants de la FAO avaient outrepassé leur pouvoir en signant le protocole (en quelques sortes, un conflit dans le conflit). Dans la foulée, et malgré les désaccords vivement exprimés, le représentant MOC est devenu « administrateur délégué à la gestion d’une solution pour le personnel », fonction qui s’est rapidement transformée (début 1998) en « délégué à la préparation de la liquidation dans les meilleures conditions possibles »[15], et en tout cas en évitant les litiges, en particulier ceux susceptibles de mettre en cause la responsabilité juridique des administrateurs. Le secrétaire national MOC a en effet formellement refusé d’être nommé liquidateur dès cette date, car le titre implique qu’on endosse seul la responsabilité juridique de tous les actes. Il s’agissait de faire en sorte que les administrateurs continuassent à agir en collégialité jusqu’à ce que les risques n’existent plus. Il convient de souligner que le collectif, parmi lequel le représentant de la famille, a correctement « joué le jeu » jusqu’au terme du processus : tous ceux qui sont restés ont été d’une totale bonne foi, ce qui a été très facilitateur.
En assemblées générales, les conflits et tensions internes ont été gérés notamment en actionnant un article des statuts qui tenait pour démissionnaires les membres qui ne payaient pas leur cotisation : en réalité, plus des deux-tiers des participants aux assemblées autogérées, parmi lesquels les plus bruyants d’entre eux, « oubliaient » aussi de payer leur (pourtant très modeste) cotisation. Après ultime rappel, les assemblées sont passées de 38 à 12 membres, devenant par le fait même plus sereines et coopérantes aux solutions.
Le cadre du personnel s’est éteint le 3 février 2002[16]. La dissolution volontaire a été prononcée en assemblée générale extraordinaire du 4 mars 2003[17]. Deux liquidateurs ont été nommés à cette occasion[18]. Il leur a encore fallu plus de trois ans pour procéder à la clôture de la liquidation, le 4 décembre 2006[19].

Perspective élargie
Complétons l’exposé factuel de quelques éléments d’éclairage du dossier en lui donnant une perspective élargie.
L’autogestion n’a pas disparu du paysage
Si la séquence autoproduction/autogestion a été un temps bref dans les luttes sociales, le propos ne veut pas pour autant dire que l’autogestion a disparu de notre paysage d’entreprises. Plusieurs actuellement actives s’y réfèrent explicitement : le groupe Terre, Damnet, Cherbai, les maisons médicales.
On est loin des espoirs originaux
On est loin des espoirs nourris jadis dans quelques milieux syndicaux et intellectuels. Car l’enthousiasme a pour partie été celui d’un environnement pas directement impliqué lui-même dans le concret de l’autogestion. Les acteurs et actrices dont les mains étaient dans le cambouis (ou sur les torchons) ont quant à eux rapidement été pour les un.e.s dans la démobilisation, pour les autres dans le désabusement : les propos collectés par Nicolas Verschueren sur l’expérience du « Balai libéré »[20] ne comportent guère d’ambiguïté ; à défaut, il relève une autogestion « dirigée d’une main de fer » (pour les « Textiles d’Ere »), ce qui est un propos pour le moins paradoxal, limite oxymore.
L’autogestion : une visée plus large que l’entreprise
Avec la FAO, notre sujet est l’entreprise. Mais il existe un courant autogestionnaire aux ambitions plus larges, qui vise l’ensemble des espaces où des décisions collectives doivent être prises. Des collectifs en lutte sur des domaines tout autres, par exemple l’environnement, peuvent avoir la volonté de s’organiser en autogestion ; certaines initiatives de démocratie participative peuvent s’en référer. Lorsqu’il s’agit d’organiser l’État, le schéma des autogestionnaires est celui d’un fédéralisme extrêmement poussé. Mais tout cela se heurte à (au moins) trois difficultés.
Difficulté 1 : la confusion avec une « demande sociale négative »
Peut-être la demande sociale pour l’autogestion n’existe-t-elle pas, ou alors circonscrite à de très petits segments de la société. Il convient de ne pas prendre pour une demande d’autogestion la revendication de ce que nous qualifierons de « participation négative » à la délibération : nous visons ces innombrables situations protestataires où il s’agit de dire « non » à tout projet, quel qu’il soit, au nom de la menace qu’il représente pour les « droits » individuels, sans égard aux enjeux collectifs qu’il s’agit de rencontrer. Il y a évidemment des projets qui ne sont pas de bien public : il est normal en ce cas de protester. Dans les cas de bien public, la recherche du compromis par confrontation des points de vue divergents est nécessaire, et nombre de collectifs ont la capacité d’y parvenir, dussent-ils se défendre avec vigueur et bouger pas à pas. Mais, il est d’autres positionnements… Si on veut développer les énergies renouvelables, il faut bien installer les éoliennes quelque part ; il manque cruellement de logements accessibles aux faibles revenus, ceux-là aussi il faut les construire quelque part. Sur de tels dossiers, même des personnes favorables aux énergies renouvelables et/ou aux logements sociaux peuvent longuement expliquer toutes les raisons qui justifient que l’investissement se fasse ailleurs que dans leur voisinage. En ce cas, la revendication participative se limite à pouvoir s’opposer en « renvoyant la patate » chez d’autres : cela a plus à voir avec le déploiement des égoïsmes individuels qu’avec le sens du collectif qu’implique la philosophie autogestionnaire.
Difficulté 2 : pas de consensus dans la gauche
L’autogestion est mal perçue par de larges pans de la gauche militante, vue comme une forme de légitimation des principes anarchistes, à l’égard desquels elle est en continuation (en tout cas si on réfère aux principes qui en ont été théorisés, plutôt qu’à l’imagerie du chaos à laquelle elle est fréquemment associée). En filiation théorique longue, on est dans le conflit Marx contre Proudhon : les principes communistes de la « centralisation démocratique » (une vraie hiérarchie) et le conflit de classes assumé (y compris dans la violence) ne se marient pas avec ceux de l’organisation autogestionnaire égalitaire et de l’anarchie apaisée par le retrait de l’espace de la lutte (plus précisément une autre forme de lutte que « frontale » par aménagement de lieux alternatifs réputés, par les effets de la mise en réseaux, par la conquête de plus en plus d’espaces au détriment du capitalisme).
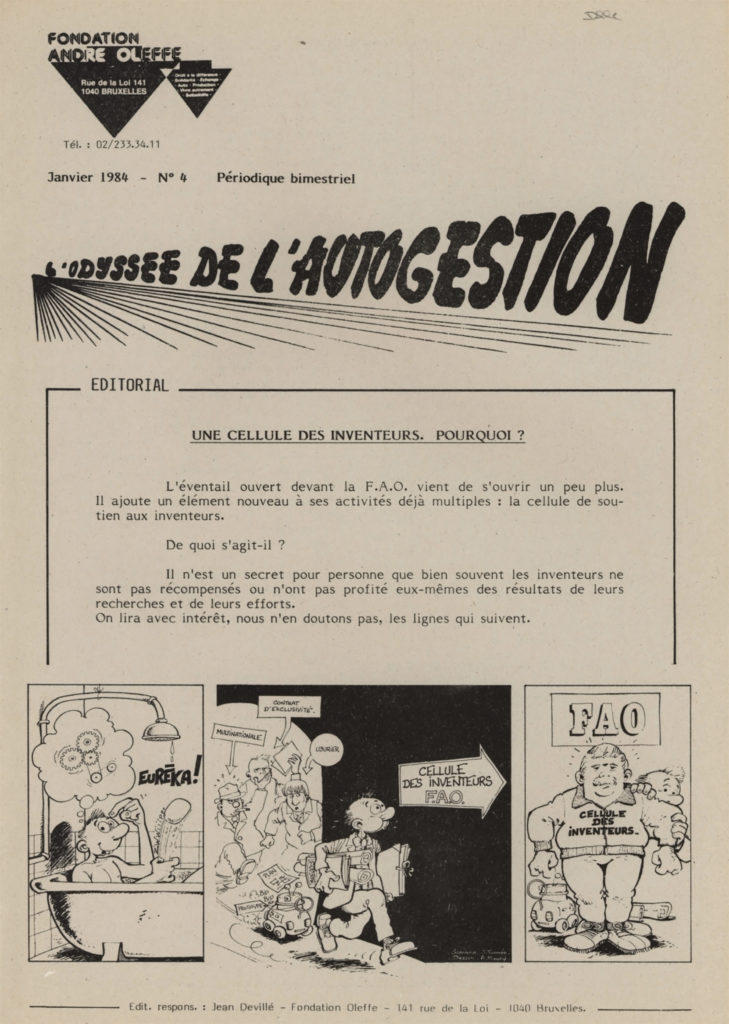
Difficulté 3 : un problème pour les partenaires sociaux
Le fait est que l’autogestion n’est pas très bien vue non plus par les partenaires sociaux : la démocratie économique a représenté une réelle avancée dans le sens d’un « plus de démocratie » ; mais, celle-ci s’appuie sur la gestion d’une conflictualité entre des employeurs et des travailleurs, par le biais d’informations, de concertations, de négociations entre interlocuteurs ou partenaires sociaux[21]. Que faire avec une structure « sans patron » ou dans laquelle « tout le monde est un peu le patron » ? Qui représente les travailleurs d’une entreprise autogérée ? La Fédération des entreprises de Belgique parce qu’il n’y a que des patrons ? Le syndicat parce qu’il n’y a que des travailleurs ? La réponse est : personne, car personne ne sait que faire avec ces entreprises qui sortent des codes. Il en résulte que leurs spécificités ne sont jamais prises en compte dans les négociations de commissions paritaires sectorielles, par exemple.
L’expérience FAO : un point de passage obligé pour grandir en réalisme ?
Les expériences autogestionnaires ont été très disparates, circonscrites, elles n’ont pas fait tache d’huile au point de devenir un mouvement économique dominant : elles sont en tout cas peu présentes dans les régions de forte industrialisation aux traditions de luttes sociales les plus radicales.
Peut-être, en « analyse posthume » peut-on formuler l’hypothèse de la FAO comme point de passage obligé pour faire le deuil d’une vision trop « éthérée » de l’économie telle qu’elle fonctionne réellement lorsqu’elle s’incarne dans des entreprises concrètes. À l’époque, la crise des industries était massive : les mauvaises nouvelles succédaient aux mauvaises nouvelles. Pourtant certains diagnostics étaient sans appel : tout cela n’était qu’affaire de « mauvaise gestion », ce qui laissait sous-entendre qu’il n’y avait qu’à modifier la gestion pour sortir des difficultés[22]. Alors, c’est vrai, il y a eu de la mauvaise gestion, des réorientations qui ne se sont pas faites à temps (elles auraient sans doute provoqué des conflits sociaux, elles-aussi), des fabrications de produits progressivement invendables, des clients perdus, des investissements trop tardifs (notons que, pour investir, il faut avoir l’argent nécessaire). Les patrons étaient dépeints sans nuance comme relevant tous indistinctement d’une caste aussi incompétente qu’avide. Les repreneurs se trouvant difficilement (il y en a eu, certains corrects, d’autres coquins), il s’agissait d’essayer de convaincre l’État de s’occuper lui-même de la reprise : il n’était pas chaud du tout, faute de managers disponibles et très conscient du puit financier sans fond que tout engagement pouvait représenter ; a fortiori dans l’ambiance culturelle des années 1980, marquées par le tournant très substantiel des politiques économiques occidentales dans le sens du désengagement public et de la libéralisation[23]. À défaut, puisqu’il ne s’agissait que d’une question de gestion, pourquoi pas l’autoproduction/autogestion ? La FAO est représentative de ce mental militant « n’y a qu’à ». Sans doute, fallait-il en passer par tous les désagréments identifiés pour intégrer que les slogans ne suffisent pas à faire une politique efficace : « ce n’est pas si simple » ; il faut changer la perspective d’action.
Notes
[1] Qui n’était pas une vraie « fondation » au sens juridique du terme : son statut était l’ASBL.
[2] Fortement médiatisée en France, avec l’expérience des montres Lip, un soutien explicite de la confédération syndicale CFDT et le soutien de personnalités intellectuelles et politiques, tel Michel Rocard, on ne peut pour autant soutenir qu’il se soit agi d’un courant majoritaire. Autrement écrit, l’autogestion a été l’affaire d’une minorité agissante ; elle n’a pas été un « déferlement ». De manière générale, un site fournit des ressources utiles sur l’autogestion : https://autogestion.asso.fr/lautogestion-quest-cest/.
[3] Observons néanmoins que l’autogestion a fait un retour significatif avec la montée en force des luttes autour des enjeux de la transition (écologique). Elle est au cœur d’un des quatre courants en piste, celui de l’écologie sociale (les autres courants étant ceux de la transition juste, l’écosocialisme et la décroissance). Plus d’informations : « Le mouvement social face à l’urgence écologique, actes de la Semaine Sociale 2019 du Mouvement ouvrier chrétien », Politique, octobre 2019.
[4] La présente contextualisation a été aidée par Verschueren N., « Une utopie ouvrière à l’aube de la société post-industrielle. Le « Balai libéré » et les expériences d’autogestion en Belgique », Histoire Politique, 42/2020, https://doi.org/10.4000/histoirepolitique.607, page consultée le 15 décembre 2023.
[5] BAILLIEUX P., « Textiles d’Ere : 15 années de fil à retordre ! », Bruxelles, Fondation André Oleffe-Éditions Vie ouvrière, 1990.
[6] COB = Caisse ouvrière belge, banque du Mouvement ouvrier chrétien. Rebaptisée ultérieurement BACOB, puis embarquée dans la fâcheuse aventure Dexia.
[7] Également de la SOFICATRA, filiale de la SNI (Société nationale d’investissements). À l’époque, la compétence était nationale (aujourd’hui, on dirait « fédérale »).
[8] C’est nous qui qualifions la position de la CSC comme celle d’un « pouvoir organisateur » pour expliquer ce qui se passait ; mais, à notre connaissance, ce n’était pas formulé de cette façon par les acteurs.
[9] Ce qui autorise à noter : « De tous les peuples autogérés, ceux de la FAO sont les plus braves ».
[10] Après diverses péripéties, elle est désormais un des services du MOC.
[11] Le Groupement national des cadres (GNC) est un département spécifique à l’intérieur de la Centrale nationale des employés (CNE), syndicat membre de la CSC.
[12] Aujourd’hui Couleur Livres.
[13] Dans la situation où était l’ASBL, ce n’était pourtant pas insensé. La surprise a sans doute été de qui venait l’initiative : c’était inattendu et vraisemblablement mal préparé institutionnellement ; ça ne veut pas dire qu’il n’y avait pas un matériel (un plan d’affaires) à partir duquel on aurait pu commencer à discuter/négocier, quitte à l’aménager. Mais le début d’une discussion sérieuse n’a jamais pu commencer : l’ambiance était à l’hostilité généralisée.
[14] Il y avait en effet un représentant de la famille membre et administrateur de droit de l’ASBL, dont un des tracas était la protection de l’image de son papa. Il était très malheureux et inquiet de l’évolution de la Fondation. Après une séquence d’irritation, dont on admettra la pleine légitimité, il a « accompagné l’accompagnement MOC » en bonne coopération.
[15] Difficile d’imaginer échapper à la dissolution : à l’époque, l’ASBL générait 1,5 million FB de pertes annuelles !
[16] Il y avait 16 emplois à la FAO. En cours de route, 3 postes subventionnés ont été perdus (l’un de toute façon inoccupé, les deux autres car il s’agissait de TCT wallons travaillant à Bruxelles : avec la régionalisation des programmes de résorption du chômage, ce type de situation est devenu rédhibitoire), il a été procédé à un licenciement, les 12 autres situations ont trouvé une solution par transferts des postes et des personnes qui les occupaient vers les ASBL partenaires de la FAO.
[17] Moniteur belge, 6 juin 2003.
[18] L’auteur des présentes lignes et Jean-Paul Vandervelde, auparavant administrateur ayant tenu bénévolement la comptabilité de l’ASBL dans sa dernière ligne droite (après transfert de la comptable salariée).
[19] Moniteur belge, 13 décembre 2006. Le petit actif net restant (9 000 €) est allé à l’ASBL Fondation Travail-Université.
[20] Verschueren N., « Une utopie ouvrière… »
[21] L’usage « interlocuteurs » ou « partenaires » est indicateur de l’option de celui qui parle. En l’occurrence, on se situe dans un espace de coopération conflictuelle. Dire « partenaires », c’est se positionner préférentiellement du côté du pôle « coopération ». À l’inverse, « interlocuteurs » assume plus la conflictualité. Du point de vue des clivages institutionnels, « partenaires sociaux » appartient plutôt au langage de la CSC et « interlocuteurs sociaux » plutôt au langage de la FGTB… tout cela avec des exceptions.
[22] L’auteur des présentes lignes s’est lui-même égaré dans ce type de diagnostic simpliste à une époque où il exerçait comme pigiste pour le quotidien La Cité, en chroniquant l’actualité locale de Mouscron-Comines et en suivant plus particulièrement les péripéties de l’industrie textile en Wallonie. Il ne manquait pas de répercuter les diagnostics syndicaux mais convient aujourd’hui que, du point de vue de l’investigation journalistique, c’était quand même (fréquemment) assez « léger » (même si tout n’est pas non plus « à jeter »).
[23] Le tournant dit néo-libéral qu’ont incarné Margaret Thatcher (Royaume-Uni) et Ronald Reagan (USA) lors de leur arrivée au pouvoir.
Pour citer cet article
GEORIS P., « La fondation André Oleffe : Pour accompagner les combats autogestionnaires », Dynamiques. Histoire sociale en revue, n°22 : L’économie sociale en Mouvement(s), décembre 2023, mis en ligne le 20 décembre 2023, https://www.carhop.be/revuescarhop/
