Pierre Georis (anciennement secrétaire général du MOC)
L’émergence au sein de l’insertion socioprofessionnelle
« Actions intégrées de développement » (AID) est le nom de famille d’un réseau de Centres d’insertion socioprofessionnelle (CISP) implantés en Wallonie et à Bruxelles, et appartenant au périmètre des ASBL, entreprises et activités du Mouvement ouvrier chrétien (MOC). Les CISP fonctionnent selon deux méthodes pédagogiques. La première comprend de larges séquences de participation à des activités économiques et commerciales, sur chantier et en atelier, la formation pratique s’organisant principalement sous le mode du compagnonnage. En Wallonie, on la nomme « Entreprise de formation par le travail » (EFT), et à Bruxelles « Atelier de formation par le travail » (AFT). Elle ne s’est pas toujours appelée comme cela : la formule a d’abord existé sous la dénomination « Entreprise d’apprentissage professionnel » (EAP). La seconde méthode est sous un mode de formation plus classique. Elle a longtemps été labellisée « Organisme d’insertion socioprofessionnelle » (OISP) en Wallonie (dénomination encore actuelle à Bruxelles), avant d’être rebaptisée « DéFI », acronyme de « Démarche formation insertion » (à ne pas confondre avec le parti politique). La principale caractéristique des CISP est d’accueillir des personnes à ce point éloignées du marché de l’emploi, le plus souvent parce que faiblement scolarisées, que les autres offres de formation leur sont inaccessibles. Pour obtenir l’agrément par une des Régions, il faut être ASBL ou CPAS.
|
Le réseau AID actuel et ses publics en quelques chiffres En 2022, le réseau AID comptait 24 associations, dont 19 en Wallonie et 5 à Bruxelles. Les activités cumulaient 10 EFT, 1 AFT, 12 DéFI et 4 OISP (certains CISP cumulent 2 situations, par exemple EFT et DéFI). Ensemble, les activités ont mobilisé 1 749 stagiaires pour 799 115 heures de formation. Le public féminin a été majoritaire à 59 %. Mais cela camoufle cependant une grande variation : elles sont surtout très majoritaires dans les DéFI/OISP (68 %), alors qu’elles sont minoritaires dans les EFT/AFT (33 %). C’est vraisemblablement lié au fait que nombre de filières EFT sont toujours réputées « masculines » (métiers de la construction, horticulture…) : ça ne bouge que lentement. Pour ce qui est des niveaux de formation à l’entrée : 25 % n’ont tout simplement aucun diplôme, pour 19 % au maximum le CEB, 19 % le CES2D, 12 % le CESS, 2 % un diplôme de l’enseignement supérieur tandis que 23 % sont titulaires d’un diplôme ou certificat non reconnu en Belgique. Autre angle d’approche encore : 42 % des stagiaires étaient sous statut de chômeurs complets indemnisés, pour 30 % relevant d’un CPAS et 28 % de personnes sans revenu car à charge d’une autre personne. Lorsque ceux qui terminent la formation sortent, c’est pour un débouché immédiat pour 50 % d’entre eux, soit sous la forme d’un emploi (17 %) soit sous celle de l’entrée dans une formation plus qualifiante (33 %). Ceci a valeur de photographie pour une année précise, mais si on vérifie les données pluriannuelles, on observe une relative stabilité depuis dix ans[1]. |
Une naissance sous tensions
Aujourd’hui, les AID représentent une des activités importantes du MOC. En interne, on n’enregistre aucune contestation quant à la légitimité de l’action. Mais, il n’en a pas toujours été le cas ! Au début, il a fallu beaucoup de volontarisme au milieu d’hostilités déclarées. Ce que les AID ont lancé n’était pourtant pas isolé : plein d’autres initiatives plus ou moins similaires se développaient ailleurs dans les espaces belges, et avaient aussi à subir méfiances et critiques. Un processus de regroupements s’est mis en place, en sorte de s’épauler les uns les autres, se défendre face à l’adversité, se construire en interlocuteur collectif suffisamment efficace que pour devenir apte à négocier sa situation et parvenir à l’institutionnalisation du secteur par la voie de décrets régionaux. Seulement voilà : ayant à se défendre des nombreuses critiques internes au MOC, les AID ont joué la carte de la dissociation : « Non, non, ne nous confondez pas avec les autres à l’égard desquels les critiques sont justifiées ; nous sommes autre chose, nous fonctionnons différemment ». Par le fait même, en même temps qu’elles étaient en difficulté en interne MOC, les AID s’isolaient de leurs homologues associatives : une double fragilité ! De longues années de travail ont été nécessaires pour conforter les initiatives locales du réseau, en les professionnalisant, en conquérant une pleine légitimité au sein du MOC et en sortant de l’isolement par l’intégration dans les collectifs sectoriels, que sont aujourd’hui l’Interfédération des CISP lorsqu’il s’agit de la Wallonie, la FEBISP (Fédération bruxelloise de l’insertion socioprofessionnelle) lorsqu’il s’agit de Bruxelles-Capitale et la FESEFA (Fédération des employeurs des secteurs de la formation des adultes) lorsqu’il s’agit d’être interlocuteur dans les relations collectives (participer au « banc des employeurs » dans la commission paritaire 329, celle des secteurs socio-culturels et sportifs)[2].
Le propos qui suit est une mise en récit, qui ne racontera pas « tout » ce qu’il serait possible d’écrire sur l’histoire des AID, mais se centrera sur l’éclaircissement du « mystère des origines », les relations compliquées avec le MOC, et jusqu’au moment où « ça (c’est-à-dire la légitimité) a été gagné », une période de presque 20 ans – soit le temps d’une génération. Cette trajectoire n’est compréhensible qu’à la condition de donner des indications sur le contexte général dans lequel cela s’est inscrit. Il s’agira aussi de décrire le collatéral de la bagarre interne au MOC : le piège de l’isolement à l’égard des pairs dans lequel se sont retrouvées les AID, et la façon dont elles sont parvenues à en sortir.
Une histoire étroitement liée aux réformes de l’État
L’histoire ici racontée est concomitante aux profondes réorganisations du fonctionnement de l’État belge, par transferts successifs de compétences de ce qu’on a d’abord appelé « État central » (depuis lors requalifié « État fédéral »), vers les Communautés et les Régions. S’y sont ajoutés des transferts d’exercice de compétences de la Communauté française vers la Région wallonne d’une part, la Commission communautaire française (COCOF) en Région de Bruxelles-Capitale d’autre part[3]. Entretemps encore, la Région wallonne s’est rebaptisée « La Wallonie » et la Communauté française « Fédération Wallonie – Bruxelles »[4]. Cela introduit de la complexité dans l’exposé : les interlocuteurs politiques du secteur ont bougé au fil du temps : au début de la décennie 1980, il s’agissait principalement la Communauté française ; en fin de période on traite prioritairement avec les Régions et la COCOF, parce que, en 1994, l’exercice de la compétence de formation a glissé de l’une aux autres. De même, en début de période, un unique service public centralisé, l’Office national de l’emploi (ONEM), organisait tout aussi bien le contrôle des chômeurs et chômeuses que leur placement, un service de formation professionnelle et un autre d’orientation. Tout cela est désormais la mission du FOREM pour la région de langue française en Wallonie, mais ventilé entre ACTIRIS et Bruxelles-Formation en Région Capitale, étant entendu que l’ONEM reste en piste comme gestionnaire de l’assurance-chômage, compétence fédérale ! Expliquer cela a fonction d’avertissement : on va essayer de ne pas trop s’embrouiller au profit d’un déroulé qu’on espère fluide, mais on ne peut pas garantir qu’on y arrivera à tous les coups de la façon la plus optimale.
|
Nature du récit, atouts et limites Le récit relève du registre du témoignage réflexif. L’auteur a eu une trajectoire personnelle de 25 ans dans le secteur ISP, sous diverses fonctions. Il ne faut dès lors pas confondre le propos avec un travail d’historien au sens strict du terme : les souvenirs personnels sont largement mobilisés ; ils font l’objet d’une reconstruction a posteriori qui, d’une certaine façon, tend à donner un sens à l’histoire. Ce qui est un atout pour l’interprétation et la compréhension comporte cependant son lot de risques en retour. Par exemple laisser croire qu’à tout moment ledit sens a été clair pour tous les acteurs impliqués : il ne l’a pas été, il y a aussi eu incertitudes et tâtonnements, sauf sans doute sur les grands principes directeurs qui ont servi de boussole. Par ailleurs, qu’il y ait un côté auto-justificateur au récit peut difficilement être nié. Pour atténuer ces faiblesses évidentes, et sans doute difficilement évitables quand on est dans le registre du témoignage, le récit cherche à appliquer quelques-uns des principes de la démarche réflexive, celle où, en quelque sorte, l’acteur prend son action comme objet de recherche, en contextualisant, en décrivant le plus factuellement possible, et en posant que la formulation d’une hypothèse ne vaut jamais démonstration. On est dans la description d’actions, menées par des acteurs, qui disposent de marges de manœuvre plus ou moins grandes, qui les utilisent ou pas, bien ou non, qui peuvent produire des réussites tout autant que des effets différents ou contraires aux intentions de départ : d’évidence, la réflexivité est influencée par les cadres de la sociologie, en particulier l’analyse institutionnelle, la sociologie des organisations et celle des mouvements sociaux. Ainsi, à défaut de faire travail d’historien.ne, espère-t-on pouvoir fournir du matériel utilisable par les historien.ne.s. |
Le chaudron des années 1980
Crise socioéconomique et perspectives
L’époque était chaude en initiatives et évolutions institutionnelles de toutes sortes. Pour faire face à la crise économique, en particulier à l’explosion du chômage, une forme de consensus existait pour considérer qu’une grande partie de la solution passait par une meilleure formation des personnes, que ce soit dans une perspective de reconversion pour celles qui étaient dans un emploi menacé ou de meilleur niveau pour les jeunes. En tout état de cause, l’observation majeure était que plus et mieux la personne était diplômée, moins elle courait de risque de s’enliser longuement dans le chômage. Deux lignes ont alors été explorées pour améliorer la formation, l’une dans le domaine de l’enseignement, l’autre dans l’accompagnement des chômeurs et chômeuses. En réalité, à situation égale du marché de l’emploi (ce qu’il n’est jamais, mais posons l’hypothèse), agir sur la formation des personnes revient plus à améliorer leur compétitivité qu’à résoudre le problème fondamental du manque d’emplois suffisants : ce sera la grande critique générique adressée par certains observateurs et observatrices. Notre point de vue est que la critique est justifiée, mais qu’elle mérite qu’on y introduise au moins de la nuance. Car, en effet, la formation peut trouver du sens en elle-même : remobilisation de personnes ; réintégration dans un groupe de sociabilité ; par l’effet du groupe, entrée dans de nouveaux projets qui, à défaut d’emploi, permettent de mieux vivre ou participent de la cohésion sociale ; si on se place dans une logique d’éducation permanente, on muscle les capacités à l’investissement citoyen. D’autre part, la formation, dans une certaine mesure, peut aussi impacter le marché de l’emploi et l’économie, en facilitant des ajustements de personnes à des fonctions disponibles inoccupées ; de façon plus indirecte, elle peut susciter des vocations à l’entrepreneuriat.
Côté enseignement et formation initiale
La réforme phare date de 1983 : on a fait monter l’obligation scolaire de 14 à 18 ans[5]. En même temps, les responsables se rendaient bien compte que les gamins qui quittaient l’école à 14 ans n’étaient pas ceux qui feraient les plus hauts bons de joie à une prolongation de 4 ans ! La formation en alternance des Allemands jouissait d’une excellente réputation : elle a inspiré l’idée d’offrir une possibilité de formation en alternance comme alternative à l’enseignement à temps plein à partir de 15 ans, au sein de « Centres d’enseignement à horaire réduit » (CEHR), créés dès 1984[6]. On peut concevoir qu’une alternance entre l’école et une formation concrète à temps partiel en entreprise puisse déboucher sur une qualification équivalente à celle acquise dans un enseignement à temps plein, mais il y a des conditions : par exemple que l’apprentissage de la mécanique garage en entreprise fasse l’objet d’un vrai programme qui ne soit pas limité au balayage de l’atelier et au service à la pompe (à l’époque, c’étaient encore des pompistes qui prestaient en lieu et place de l’automobiliste). Encore fallait-il trouver de tels bons stages en entreprise ! Or, les temps étaient à la débandade ! L’alternance s’est donc massivement résumée à une alternance entre l’école et le chômage. Nommé « enseignement à horaire réduit », le dispositif a aussitôt constitué un échelon supplémentaire dans le processus de relégation scolaire !
Quelques années auparavant, c’est-à-dire fin de la décennie 1970, Émile Creutz, directeur du CIEP (le Centre d’information et d’éducation populaire, le service d’éducation permanente du MOC) et plusieurs acteurs de l’enseignement libre catholique avaient consacré une énergie considérable à construire et défendre un projet de réforme de l’enseignement professionnel, rebaptisé « humanités professionnelles », précisément pour qu’il cesse d’être une filière de relégation. Dans la foulée, ils avaient poussé quelques expériences pilotes dans des écoles professionnelles bruxelloises libres catholiques en milieux populaires et marquées par la diversité[7]. On ne peut pas dire que les Centres d’enseignement à horaire réduit (CEHR) correspondaient parfaitement à l’espérance des promoteurs des « humanités professionnelles », ni à celle des acteurs des expériences pilotes ! Le dépit était grand, mais peu importe : tous ces mêmes acteurs ont recyclé leur énergie en tentant d’accompagner au mieux le nouveau dispositif, de l’intérieur pour ceux qui étaient salariés de l’enseignement catholique, en partenaires extérieurs pour les autres (MOC, Conseil de la jeunesse catholique – CJC, CSC, Centres PMS).
Assez paradoxalement, comme on était de toute façon dans du neuf et une assez totale absence de programme, toute personne appréciant se retrouver dans l’instituant trouvait matière à une certaine excitation mobilisante ! Mais cela n’allait pas sans tensions, parce qu’avec des centaines de personnes impliquées sans trop de cadre, ça partait dans tous les sens, avec, au bout d’un temps, un clivage assez net entre ceux qui visaient la mise en place d’une excellence dans la qualification professionnelle, en gardant l’ambition d’une vraie formation en alternance (avec un bon statut pour les jeunes en stage) et d’autres qui, prenant acte de la grave pénurie d’offres de stages en entreprises, trouvaient qu’on ne pouvait pas pour autant abandonner toutes celles et tous ceux qui étaient sans stage. Autrement formulé, le clivage se jouait entre « insertion professionnelle » et « insertion sociale ». En réalité, il ne s’agissait pas de choisir entre l’un ou l’autre mais de faire l’un et l’autre : c’est la position qu’a fini par défendre le secrétariat général de l’enseignement secondaire catholique[8], et ce n’était que de bon sens, à tel point qu’il s’est grosso modo agi de la solution finalement généralisée dans le réseau. Dans l’intervalle, le clivage s’était immiscé entre la CSC et le MOC. Les Jeunes CSC avaient en effet construit un ambitieux modèle d’alternance, le « 2 x 20 heures », à comprendre comme : une semaine de 20 heures de formation scolaire et 20 heures de formation en entreprise durant lesquelles les jeunes impliqués disposaient d’un vrai statut. Ils le défendaient avec conviction tandis que leurs collègues du MOC assumaient la situation de large pénurie de stages d’alternance disponibles pour les élèves : ils contribuaient dès lors à monter des initiatives de CEHR qui pouvaient être très éloignées des perspectives 2 x 20 heures.
|
Les CEHR : une suite à l’histoire Il y a une suite à l’histoire des CEHR que nous n’avons évoquée ici que pour contextualiser l’origine des AID. Dès 1987, les CEHR ont été autorisés à élargir leur public aux 18-25 ans à condition que ces derniers aient conclu préalablement un contrat d’apprentissage industriel[9]. En 1991, le dispositif est plus formellement institutionnalisé[10]. À cette occasion, il change de nom au profit du plus positif « Centre éducatif et de formation en alternance » (CEFA) : il s’agit toujours de la dénomination actuelle. En 1998, un Contrat d’insertion socioprofessionnelle, plus souple, se substitue au contrat d’apprentissage industriel[11]. Enfin, en 2001, le système sort d’une ambiguïté : on parle désormais « d’enseignement » en alternance en bannissant la notion de « formation ». Ce faisant le dispositif devient explicitement partie prenante de l’enseignement, donc légitime à présenter une voie alternative pleinement valide à l’enseignement de plein exercice[12]. Pour les CEHR de son réseau, l’enseignement libre catholique a énormément investi en énergie et créativité, en veillant à associer largement des partenaires de sa sphère d’affinité. C’est dans ce cadre que l’auteur a participé au groupe d’encadrement local (en le présidant pendant quatre ans) du CEHR/CEFA attaché à l’Institut technique de Namur (ITN), de 1988 à 1995, au titre de représentant de la fédération du MOC de Namur. Identiquement, il a représenté le MOC national dans le Groupe national d’encadrement de la formation en alternance (ASBL GNEFAL), de 1988 jusqu’à sa mise en liquidation en septembre 2009. Le GNEFAL a été une structure précieuse pour accompagner et cadrer la période instituante. Lorsque les choses sont devenues plus instituées, elles sont aussi devenues plus verrouillées : le GNEFAL a perdu une bonne part de ses capacités à mobiliser des partenaires externes à l’enseignement. Les changements de générations et de responsables chez les uns et les autres ont vraisemblablement aussi joué un rôle dans le processus d’extinction. |
Côté accompagnement des chômeurs et chômeuses
Les temps étaient aussi à certains énervements syndicaux sur l’accompagnement des chômeurs et chômeuses. En particulier, des critiques étaient formulées à l’égard de la formation professionnelle ONEM. Il était notoire qu’y passer améliorait la position du demandeur d’emploi. Les files d’attente s’y sont allongées. Pour certains métiers, démesurément : on pouvait attendre trois ans entre l’inscription et l’entrée effective en formation. Pour gérer le problème, l’ONEM a mis en place des tests qu’il fallait préalablement réussir. La mécanique emportait comme effet que la statistique de mise à l’emploi à la sortie de formation en était d’autant plus favorable que c’étaient de toute façon les meilleurs qui étaient sélectionnés. Il semblerait – ici l’auteur répercute ce dont il se souvient d’une mémoire orale captée à l’époque – que des interpellations aient été faites au comité de gestion de l’ONEM à partir du banc syndical[13]. Sans grand succès opérationnel. Ce serait cela (conditionnel) qui aurait amené certains acteurs locaux à monter, fin des années 1970-début des années 1980, quelques initiatives de formation dites de « mise à niveau des connaissances », ou de « remise à niveau » : les deux notions n’ont pas tout à fait le même sens – à notre connaissance, ça n’a jamais été tranché –, mais il était clair cependant que le niveau visé était la réussite du test d’entrée en formation professionnelle ONEM. En particulier, quatre associations se sont coalisées à partir de Charleroi (Formation pour l’université ouverte de Charleroi – FUNOC), Liège (Canal Emploi), Namur (Radio télévision animation – RTA[14]) et Bruxelles (Association pour le développement, l’emploi, la formation et l’insertion sociale – DEFIS). Elles avaient en commun d’être le produit des deux branches coalisées du mouvement ouvrier, la socialiste et la chrétienne.
|
La bande des quatre En front commun, la FGTB et le MOC créent la FUNOC en 1977, à Charleroi. Elle est toujours bien vivante aujourd’hui, et est d’ailleurs le CISP le plus important de Wallonie en nombre de stagiaires accueillis. La même année, les services de formation des deux principaux syndicats du pays, auxquels s’associait l’Université de Liège, lançaient Canal Emploi à Liège. D’abord conçu comme projet de télévision locale communautaire, avec des perspectives de formation à distance par l’intermédiaire de l’outil audiovisuel, les choses ont rapidement évolué en sorte d’y adjoindre des groupes de stagiaires dits « en préformation ». Ne cherchez plus cette ASBL : elle a disparu en 1989 – de ce qu’on en a capté à l’époque, de toute évidence les relations entre partenaires y ont été beaucoup plus rugueuses qu’à Charleroi. Une « petite sœur » aux deux grands s’est ensuite ajoutée : RTA, à Namur. Créée un peu plus tôt (1975) autour d’un projet d’animation audiovisuelle par télévision locale, l’ASBL, à nouveau une coopération FGTB-MOC, s’est ensuite donné les moyens d’à son tour développer des formations de mise à niveau pour demandeurs et demandeuses d’emploi faiblement scolarisés ; nous étions en septembre 1981. L’auteur des présentes lignes a été recruté pour coordonner ce dispositif spécifique, en compagnie de Claude Hardenne, l’un (l’auteur) labellisé MOC, l’autre FGTB. Beaucoup plus modeste que la FUNOC, auprès de laquelle a été cherchée une partie de l’inspiration[15], l’ASBL existe toujours comme CISP désormais spécialisé dans la formation à des métiers de l’audiovisuel[16]. Puis est venu Bruxelles. Une série d’initiatives locales de formation, dont certaines ayant déjà dix ans d’existence au compteur, se sont donné une plateforme commune avec les syndicats, le MOC, l’ULB et l’UCL : DEFIS (à ne pas confondre avec les Défi wallons, ni le parti politique !). Dès 1982, cette plateforme est rapidement montée en puissance dans la capitale et dans une coordination qui se faisait désormais à quatre : FUNOC, Canal Emploi, RTA et DEFIS. Il ne faut pas croire que tout le monde était sur la même ligne : dans les faits, les groupes locaux bruxellois, vu leur diversité et les publics avec lesquels ils travaillaient étaient sur une ligne affirmée « priorité à l’insertion sociale », les Liégeois quant à eux se voulaient acteurs du développement de la formation à distance, tandis que la FUNOC offrait des stages de formation aux contenus plus cadrés et tenait à s’inscrire dans une perspective de développement local. De son côté, RTA faisait un peu peur à tout le monde en testant la pédagogie du projet avec ses publics : c’était déstabilisant, y compris d’ailleurs pour ses formateurs, avec un côté « ligue d’impro », au nom de la réponse aux besoins et demandes exprimés par les groupes. Certes, la pédagogie du projet coexistait avec des contenus construits, mais il ne faut pas s’en cacher : avec les projets, de brillantes réussites ont coexisté avec l’un ou l’autre ratage complet. C’est un autre récit à faire…[17] |
La « bande des quatre » a rapidement pris acte de deux réalités.
- La première : la redécouverte de l’analphabétisme et la prise de conscience de son caractère massif. Le front commun FGTB-MOC s’est emparé de la question de façon très volontariste : dès 1983, il a lancé le réseau Lire & Écrire. Même si DEFIS a opté pour la dissolution quelques années plus tard, il faut mettre à son crédit un investissement très dynamique au profit du projet Lire & Écrire.
|
DEFIS, l’alpha, la FEBISP L’investissement sur l’action d’alphabétisation a été facilité par l’évidente complicité entre le socialiste Alain Leduc et le « mociste » Daniel Fastenakel. Elle n’était pas que dynamique : aussi d’une redoutable intelligence politique. Ainsi la FGTB namuroise n’était-elle pas très enthousiaste du projet Lire & Écrire : Alain Leduc a été déterminant en coulisses pour la faire basculer, en l’aidant à créer son propre dispositif d’alpha ! En effet, le non-dit de la réticence FGTB locale était sa crainte d’être absente d’un terrain occupé par d’autres, en particulier d’initiatives souvent labellisées « chrétiennes ». Il pourrait ne pas être incongru de considérer que DEFIS a été le précurseur de la Fédération bruxelloise de l’insertion socioprofessionnelle (FEBISP), créée quant à elle dès 1995, immédiatement après la régionalisation de l’exercice de la compétence de formation. On peut en effet poser l’hypothèse que si ça a été aussi vite, c’est que le terrain était déjà prêt. |
- La seconde réalité découverte : l’explosion de nouvelles initiatives, partout sur le territoire, sans concertation aucune entre elles autour d’un problème qu’on pouvait formuler comme suit : une partie substantielle du public pour lequel étaient organisées les mises à niveau exprimait « n’en avoir rien à foutre de la formation mais vouloir travailler et gagner de l’argent »… ce qui ne voulait pas dire pour autant que les personnes avaient les qualifications utiles. Aspect troublant du dossier : moins les apprenant.e.s étaient formés moins ils étaient demandeurs de formation. Ainsi, en deux-trois ans, on pouvait déjà dénombrer quelques dizaines d’initiatives, autour de grosso modo une même idée : puisque c’est du concret que demandent les gens, mettons-les d’abord en situations concrètes, en atelier et sur chantier, le cas échéant en contact avec une clientèle, et organisons la formation par compagnonnage au fur et à mesure des nécessités avérées.
Mais l’unité de toutes ces nouvelles initiatives n’étaient que de façade. Le paysage était fragmenté entre trois tendances. On pouvait le décrire à partir d’un triangle : une des pointes tirait vers l’économie, l’autre vers la formation, la troisième vers le social. D’une façon ou d’une autre, chaque initiative intégrait chacun des trois volets. Mais, toutes ne se situaient pas au même endroit de l’espace représenté par le triangle, et certainement pas au point équidistant ! Les unes pouvaient se lancer dans des activités économiques ambitieuses, parfois jusqu’à la perspective de créer de l’emploi en bonne et due forme[18], parfois aussi sans complètement respecter les prescrits légaux : publicisant leurs manières de faire et en exposant les raisons, elles étaient moins dans l’illégalité que dans l’a-légalité – en d’autres mots, le registre était de désobéissance civile[19]. D’autres montaient des structures principalement d’accompagnement social. C’était parfois présenté sous l’horrible dénomination « ateliers occupationnels » : on constituait des groupes autour d’une activité qui pouvait parfois être de nature très modestement économique en sorte de mener un travail social collectif plutôt qu’individuel – c’était assez fréquent en CPAS ou en maisons d’accueil par exemple. Les troisièmes, enfin, créaient des dispositifs plus explicitement de formation. Ainsi, entre autres, des initiatives nombreuses sont-elles nées en « filiales » d’institutions d’hébergement dans le secteur de l’aide à la jeunesse. Débattu depuis 15 ans[20], l’abaissement de l’âge de la majorité de 21 à 18 ans sera rendu effectif en 1990[21] ; dès ce moment, les jeunes se voyaient brusquement devoir quitter leur institution trois ans plus tôt ; le milieu estimait qu’il avait devoir de faire une offre nouvelle d’accompagnement, et a assez largement anticipé, ce qui, par effet collatéral, permettait un débouché de reconversion pour du personnel devenu soudainement surnuméraire dans les institutions. Vertu du débat démocratique : il y a des choses qu’on voit arriver !
Le paysage était compliqué et de nombreux acteurs étaient inquiets. Si les associations étaient certaines d’être dans le bon en répondant aux besoins nouveaux, mais réclamaient reconnaissance et soutien, les syndicats quant à eux étaient très inquiets des statuts des personnes en y voyant une forme de légitimation des pratiques négrières : la question défraie périodiquement l’actualité, en particulier dans des secteurs investigués par les initiatives associatives (construction, HORECA). De leur côté, les classes moyennes dénonçaient la concurrence déloyale. Au milieu de tout cela, les pouvoirs publics ne savaient pas toujours ce qu’ils devaient en penser, a fortiori, que les matières concernées par une éventuelle action régulatrice étaient déjà éparpillées entre l’État central, la Communauté française et les deux Régions.
La Fondation Roi Baudouin (FRB) va jouer un rôle déterminant d’intermédiaire pour débrouiller toute cette affaire, à l’occasion d’un programme social « Partenaires pour innover », qu’elle développera de 1984 à 1987[22]. Le travail d’éclaircissement et de tri de ce qui se passait sur le terrain (le triangle et ses trois pointes) a permis ensuite la négociation d’un cadre pour des solutions aux problèmes posés par la pointe « formation » du triangle. C’est la notion EAP comme « entreprises de formation par le travail » qui est sortie du chapeau de la Fondation. Il s’agissait d’une des dénominations qui circulaient déjà pour nommer les nouveautés ; elle apparaissait comme particulièrement pertinente à faire comprendre ce dont il s’agissait. La Fondation l’a largement publicisée au printemps 1986[23].
|
Les hasards de trajectoires personnelles On a pu le préciser plus haut : l’auteur de la présente est particulièrement concerné par le récit, qui raconte aussi un peu de sa trajectoire personnelle. La présente incise assumera une forte subjectivité en donnant quelques éclairages additionnels sur ce point. Dans sa fonction de coordinateur des formations à RTA, l’auteur a rapidement pris acte du fait que la (re)mise à niveau était loin de pouvoir être une réponse exclusive à toutes les situations. Il est rapidement entré en contact avec une série d’autres initiatives de la région namuroise, dont certaines expérimentant des formes de formation par le travail, y compris en CPAS[24]. Ensemble a été constituée une plateforme locale « Coordination namuroise pour des formations à l’autonomie » (CNFA), qui existe toujours aujourd’hui comme plateforme namuroise des CISP[25]. L’affaire avait attiré l’attention de la Fondation Roi Baudouin durant la séquence préparatoire au lancement de son programme social, au cours duquel elle comptait soutenir quelques expériences pilotes. À RTA, on n’avait pas pris la mesure de la grande misère que représente l’obligation du passage par un financement du fonds social européen (FSE) : l’argent est promis ; si on ne commet pas d’erreur (et il n’y en a pas eu de commise), l’argent finit par arriver, mais avec des retards considérables. Or, pour en bénéficier, il faut montrer que toutes les dépenses éligibles ont été exécutées avant le 31 décembre de l’année civile. Dans le montage de l’époque, ce sont grosso modo 50 % des dépenses qui étaient financées par le FSE[26]. Pour arriver à fonctionner, il fallait que les ASBL soient adossées à des fonds propres importants, ce qu’elles n’étaient pas, ou empruntent : les annonces de subsides pouvaient servir de garantie pour la banque… à condition qu’elles arrivent dans les temps. À défaut, les robinets étaient fermés ! Notons aussi que les intérêts versés à la banque n’étaient pas considérés comme dépenses éligibles (ils ne le sont d’ailleurs toujours pas), autrement écrit : il faut aussi trouver les moyens de payer les intérêts. En 1983, un moment est arrivé où RTA s’est retrouvé en incapacité d’encore fonctionner, pour des raisons de pure trésorerie, alors qu’aucun pouvoir public, ni le FSE, n’avait un quelconque reproche à formuler quant aux actions menées. Pour couvrir l’emprunt permettant la continuité des activités, les administrateurs de l’ASBL qui possédaient un bien immobilier (leur maison ou appartement) les ont mis en garantie tandis que les membres du personnel payé sur « fonds propres » (c’est-à-dire avec les subsides FSE[27]) acceptaient pendant quelques mois de ne recevoir que des avances sur salaire à hauteur du montant du minimex (aujourd’hui on dit « revenu d’intégration sociale » (RIS))[28]. Dans la situation de stress, de désarroi et même de détresse où nous étions, une évidence s’imposait : on ne pouvait pas continuer de la même façon, il fallait restructurer. L’auteur a proposé un plan que cependant le conseil d’administration n’a pas accepté, au profit d’un autre qui recentrait sur l’audiovisuel. Cela avait son sens puisque ça permettait des économies d’échelle avec l’autre département de l’ASBL, la télévision communautaire. L’emploi de l’auteur n’était pas menacé mais avoir à coordonner un autre projet que celui qu’il avait défendu créait une dissonance.  Le hasard a fait que c’était aussi l’époque où la Fondation recrutait quelques collaborateurs régionaux pour les quatre ans de son programme social. Épreuves réussies, j’ai été recruté. Dans la foulée, CNFA était reconnu comme un des projets pilotes soutenus et, dans la négociation de mon cahier des charges professionnelles, j’ai obtenu que je pouvais y consacrer environ 50 % de mon emploi du temps. Avouons : c’était une chance exceptionnelle. L’autre moitié de mon temps était consacré à Charleroi, qui grouillait d’initiatives de toutes les sortes que j’ai alors appris à connaître, tant dans son volet public (un CPAS dirigé par un secrétaire particulièrement dynamique et ouvert à l’innovation[29]) que dans celui de l’associatif. Il s’est vite su que la Fondation soutenait des expériences hétérodoxes : des dizaines de demandes de soutien lui sont arrivées. La Fondation a chargé l’auteur de leur offrir une réponse tout en lui expliquant : « on n’a pas l’argent pour les soutenir ». Le meilleur service qu’on pouvait alors rendre à la collectivité était d’aller plus avant dans l’investigation. Au début, candidement, on pense qu’il peut y avoir une solution unique. Au fil du temps, des rencontres, des synthèses accumulées, on s’aperçoit que c’est inapplicable : avec l’image du triangle et des trois pointes (cf. supra), une avancée substantielle a été faite dans l’interprétation de ce qui se passait et l’importance de dissocier les solutions. Il est alors devenu possible d’organiser les négociations entre toutes les parties concernées par le sous-ensemble « formation ». Lorsque la Fondation a tenu conférence de presse pour présenter les résultats, pas moins de sept ministres étaient présents ou représentés. La publication pour l’occasion, tirée à 1 000 exemplaires, a été épuisée en trois mois. Attention : l’auteur n’était pas tout seul ; son job a été principalement constitué d’investigation et de synthèses successives, avant de formuler des propositions de solutions qui ont, elles aussi, connu des ajustements au fur et à mesure, avant que le collectif puisse dire « on est d’accord sur ce qu’on présente parce qu’il existe un consensus suffisant entre nous ». Si la synthèse a pu être considérée comme originale, il n’en reste pas moins qu’elle a été construite à partir d’un riche matériau principalement composé d’idées parfois brillantes formulées par plein d’autres acteurs. Par ailleurs, il ne faut pas ramener le programme social de la Fondation à ce qui est exposé ici, qui n’en constitue qu’une fraction[30]. Immédiatement après la fin de son contrat, le 31 décembre 1987, l’auteur a été recruté au Centre d’information et d’éducation populaire (CIEP) du Mouvement ouvrier chrétien en vue de « renforcer l’encadrement pédagogique et managérial des AID » (c’est comme cela que l’annonce était rédigée). La Fondation, quant à elle, a continué à s’intéresser et à soutenir le secteur, et plus globalement l’économie sociale, principalement par le financement de recherches et de rapports permettant de comprendre ce qui se passait au moment où ça se passait[31]. |
Les premières réponses politiques à l’insertion socioprofessionnelle
Dans les mois qui ont suivi, de premières réponses politiques ont commencé à être offertes. Côté État central, en toute fin 1986, le ministre de l’Emploi et du Travail Michel Hansenne (PSC) a cherché à répondre à la question spécifique de la situation d’une rémunération de stagiaires impliqués dans une situation productive, telle qu’elle puisse justifier qu’ils soient mieux rémunérés que le niveau de l’indemnité de formation, tout en admettant qu’ils n’en étaient pas encore à un niveau de productivité justifiant le salaire minimum. La perspective était positive et organisait un continuum formatif, reconnaissant les progrès objectifs des stagiaires via l’amélioration de leur rémunération. Les associations étaient par ailleurs contraintes d’y affecter une partie des marges dégagées par leur activité économique. Cela passait par une forte réduction des cotisations sociales à payer, mais il y avait une contrepartie : une couverture de soins de sécurité sociale réduite aux allocations familiales et à l’assurance maladie-invalidité[32] ! Cette limitation a aussitôt suscité de vives protestations. En définitive, assez rares sont les associations qui ont usé de l’opportunité.
C’est cependant la Communauté française qui avait compétence sur la matière. Un peu en urgence, pour dire quelles associations étaient autorisées à faire usage de la nouvelle disposition de paiement de cotisations sociales réduites, est sorti le premier arrêté de l’Exécutif (c’est comme cela qu’à l’époque on nommait un gouvernement d’entité fédérée). Il définissait ce qu’il fallait entendre par « EAP » et les premières conditions de reconnaissance : l’institutionnalisation se mettait en route[33]. Mais, l’affaire était très circonscrite : une EAP ne pouvait être qu’un dispositif s’adressant à des jeunes de 18 à 25 ans ne bénéficiant pas de l’allocation de chômage. Il était philosophiquement important de pouvoir avancer, mais force était de constater que le champ à couvrir était sensiblement plus large. On formulera l’hypothèse de contexte : une probable interaction avec les échanges et transactions autour des CEHR et de la formation en alternance. À l’été 1987, un décret a donné un cadre à la plupart des initiatives associatives d’insertion. Cela permettait d’inclure rétroactivement l’arrêté EAP dans un cadre décrétal[34], mais couvrant un champ considérablement élargi[35].
Déjà à l’époque, la Communauté française n’avait pas d’argent ; ses agréments n’ouvraient l’accès qu’à des subventions symboliques. Mais les ASBL étaient aussi allées chercher des aides à l’emploi pour leur personnel, en usant des possibilités ouvertes par les différents programmes de résorption du chômage du ministère de l’Emploi[36]. L’agrément facilitait grandement le processus pour les nouvelles entrées en piste. Là réside l’astuce : avec l’agrément en poche, les associations pouvaient se tourner vers le FSE et, présentant l’ensemble des subventions obtenues de pouvoirs publics belges, aller jusqu’à doubler la mise par financement européen (évidemment selon les normes de l’époque, et pour un public cible… de jeunes de 18 à 25 ans – ceci représente une explication additionnelle aux choix politiques de la Communauté française). À moindres frais pour elle, la Communauté française ouvrait la porte à une subvention substantielle. Le tout premier dispositif d’institutionnalisation sera encore complété peu après d’un arrêté précisant le processus d’agrément des initiatives non EAP[37].
Chacun des arrêtés prévoyait que la demande d’agrément passe par le filtre d’une commission consultative. Cela a eu pour vertu de rassurer quant au fait que ce qui était agréé était « dans les clous ». Dans les deux cas, ce sont des interlocuteurs d’autres dispositifs institués de la formation (formation ONEM, formation des Classes moyennes) qui étaient associés à l’administration et aux représentants des cabinets. Mais, la commission pour les EAP avait cette particularité d’en outre d’associer les représentants des partenaires sociaux : c’était précieux pour la confiance à créer à l’égard de cette nouveauté encore regardée avec (au moins) perplexité. Plus encore, il y avait une représentation prévue pour les associations[38] !
Il fallait donc organiser une représentation des associations dans la commission : des réseaux préexistaient, relevant du monde sociologique chrétien, l’un autour de la FISAJ (les initiatives d’aide à la jeunesse, nées des restructurations de l’hébergement après l’abaissement de l’âge de la majorité), un second coordonné en la FIAS (quelques initiatives d’actions sociales)[39]. D’autres se sont organisés : l’un pour regrouper les initiatives d’obédience socialiste[40], un autre « libre » (qu’il fallait lire comme « libre des deux piliers ») et se voulant pluraliste, ALEAP[41]. Les quatre fédérations se sont rapidement accordées pour se coaliser en une structure commune de concertation entre elles et de soutien aux initiatives locales : cela a fondé la création de l’ASBL « EAP Consultance », qui muera deux fois ultérieurement jusqu’à devenir l’actuelle Interfédération des CISP, interlocutrice sectorielle reconnue en Wallonie.
Les AID : le mystère des origines
La situation est paradoxale : dès 1985, des initiatives du MOC ont participé à ce mouvement général, sous le label AID, et encadrées par le CIEP. Celui-ci a d’ailleurs été dûment associé aux consultations de la Fondation Roi Baudouin qui ont débouché sur le programme des EAP. Et pourtant… le descriptif du contexte montre que les AID n’en sont pas ! Être et ne pas être : un mystère est à éclaircir. Reprenons les faits.
Pendant de longues années, le CIEP, s’est questionné sur son dispositif ISCO (Institut supérieur de culture ouvrière), une formation de quatre ans, à horaire décalé, destinée à des publics de salarié.e.s et/ou de militant.e.s des organisations pouvant déboucher, moyennant présentation réussie d’un travail de fin d’études, sur un diplôme de « gradué en sciences sociales du travail », décerné par la Fondation Travail–Université avec la contresignature du recteur des Facultés universitaires Notre-Dame de la Paix de Namur (aujourd’hui, Université de Namur). Les jurys étaient présidés par des professeurs des Facultés et plusieurs de ceux-ci donnaient eux-mêmes des cours. Fin des années 1970-début des années 1980, les questionnements portaient tout à la fois sur le renouvellement des publics et l’adaptation des programmes. Au départ, en effet, le public cible de l’ISCO était largement le personnel recruté dans les organisations. Les nouvelles recrues étaient cependant de plus en plus diplômées, cette cible sortait petit à petit du champ. Certes, des militant.e.s restaient investis dans une formation qui les aidait dans leurs actions, mais il pouvait y avoir d’autres publics en attente d’une offre. Les temps étaient au chômage massif, en particulier des jeunes. Ça nécessitait l’adaptation des contenus et objectifs aux réalités économiques nouvelles.
Plusieurs expériences ont alors été lancées dans un laps de temps très court : en particulier un ISCOOP (pour sensibiliser aux opportunités de la coopérative et former à les utiliser) et surtout un ISCO Jeunes, dont on peut raisonnablement considérer qu’il a constitué le marchepied des premières expériences qui prendront le label « actions intégrées de développement »[42]. L’ISCO Jeunes a été un projet principalement bruxellois[43]. Deux autres initiatives locales, qui ne s’appelaient pas encore AID, se lançaient à Charleroi[44] et à La Louvière[45]. Avec cela, le MOC faisait des choses qui avaient beaucoup de similarités avec ce qui s’observait dans l’environnement, avec néanmoins cette spécificité revendiquée : garder un ancrage dans les logiques de l’éducation permanente c’est-à-dire faire s’exprimer des besoins par les personnes relevant de groupes cibles, faire réponses collectives plutôt qu’individuelles, ne pas simplement former à l’exercice de tâches répétitives mais aussi à l’esprit critique et à la citoyenneté responsable – ce processus passant notamment par l’organisation d’un « conseil coopératif » dans chaque groupe, comme structure participative associant les stagiaires. Derrière ce développement, il convient d’aussi admettre un enjeu très terre-à-terre : la situation financière du CIEP et de l’ISCO était assez précaire ; l’opportunité existait de se trouver de nouveaux financements moyennant une reconversion partielle.
Absence de consensus interne
Mais pour les acteurs de l’innovation, ce n’était pas simple du tout : il n’y avait aucun consensus interne ! En particulier, la CSC tirait tout azimut. Les Jeunes parce qu’ils avaient leur projet « 2 x 20 heures » et qu’on n’en faisait rien. Les centrales de l’enseignement trouvaient que l’argent public serait mieux dépensé s’il venait renforcer le financement des écoles : avec plus de moyens, les écoles fonctionneraient mieux, tous les jeunes en sortiraient diplômés avec accès rapide à l’emploi, il n’y aurait plus besoin de ces « bricolages non professionnels ». Toutes les branches confondues (encore rejointes par des dirigeants de la Jeunesse ouvrière chrétienne – JOC, bien que certains responsables locaux soient très impliqués dans les expérimentations) dénonçaient le statut indigne et l’absence de contrôle par les partenaires sociaux. D’évidence, ces points de vue amalgamaient ce qui se faisait en MOC à l’ensemble des initiatives EAP à l’égard desquelles la méfiance était très grande. De leur côté, les secrétaires de fédérations MOC étaient loin d’être tous acquis à la cause : certains parce que cela représentait du travail supplémentaire alors qu’ils en avaient déjà beaucoup (et c’était vrai !), d’autres parce qu’ils trouvaient plus stratégique de développer le tourisme social (en l’occurrence à l’époque il s’agissait surtout d’en éviter la déconfiture), d’autres enfin parce que ce n’était tout simplement pas un public dont le MOC avait à s’occuper – « notre métier est la formation des cadres, pas de ces personnes qui, pour un peu, sont aussi celles qui jettent des pavés dans les vitrines de nos permanences syndicales »[46]. Les résistances se rencontraient jusqu’à l’interne de l’équipe CIEP tant l’accompagnement AID s’est rapidement révélé comme ayant des exigences très différentes de l’accompagnement des groupes ISCO. En l’occurrence, même pour des acteurs pourtant menacés par la fragilité financière de leur entreprise, il semblait difficilement concevable d’imaginer se reconvertir, ne fût-ce qu’en raison de la défense fière de ce qu’ils avaient fait jusque-là[47]. Signe de cette hostilité, Emile Creutz, le directeur du CIEP se prenait de lourdes critiques quelle que soit l’instance où il se présentait : il a fait paratonnerre et parfaitement couvert ses troupes[48].
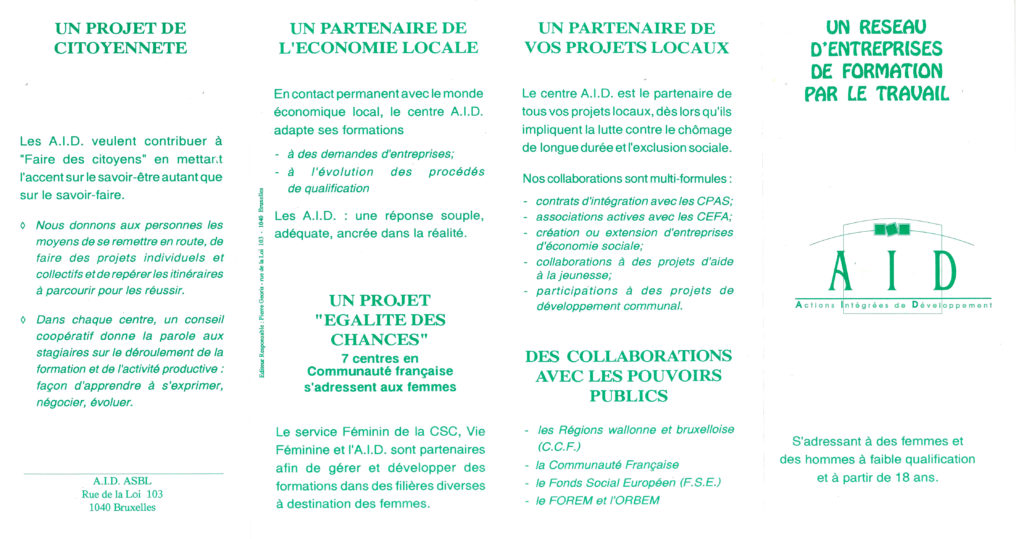
Réponses offertes
En réponse aux critiques, Henri Scorier, le vrai fondateur des AID[49], a fonctionné sur deux lignes, l’une pratique, l’autre idéologique.
La réponse pratique
Pratiquement, il s’est agi d’aller chercher des financements européens pour l’ISCO Jeunes et les initiatives locales expérimentales. Une différence très substantielle était à enregistrer entre AID et les autres initiatives qui se déployaient sur nos territoires : AID était un système très « jacobin », toute l’administration « dossiers de financement et justificatifs » était centralisée en un unique dossier présenté et défendu par le CIEP. Au fur et à mesure du développement, ça représentait une masse de travail administratif de plus en plus importante à traiter ; les tensions se jouaient entre le national et les centres AID locaux, puisque c’est le national qui, le cas échéant, refusait certaines pièces non éligibles au financement du FSE (alors que dans toutes les situations hors MOC, les organismes étaient en contact direct avec le FSE). En même temps, le système de contrôle interne était fort développé, ce qui permettait aussi de déposer des dossiers justificatifs à propos desquels l’agence FSE n’avait pas spécialement à redire, si ce n’est sur des questions anecdotiques. Surtout, ça créait une mécanique solidaire assez originale : puisque toutes les contreparties belges figuraient en un unique dossier, rien n’empêchait, en certains endroits, de développer une activité qu’on finançait exclusivement avec l’argent européen ; rien non plus n’empêchait le déplacement d’un emploi subventionné d’un endroit à l’autre en fonction des nécessités, et avec l’autorisation de l’inspection. Par exemple, une activité a pu être développée à Enghien, ce qui n’aurait pas pu l’être dans le classique cadre non solidaire, malgré les soutiens locaux (culture de plantes médicinales ; entretien de parcs et jardins)[50]. Cette réponse pratique revenait à expliquer à ceux qui craignaient un surcroît de travail qu’en réalité le gros de l’administration était pris en charge par le CIEP national. S’ajoutait à cela qu’il était admis que du travail institutionnel et politique effectué par le secrétaire MOC pouvait être reconnu et rémunéré forfaitairement comme tel.
La réponse idéologique
Calmer les rudes critiques internes est passé par l’assurance que AID n’avait « rien à voir » avec les autres ; AID ne s’occupait pas des mêmes publics, ou plutôt elle sélectionnait dans ce public celles et ceux qui étaient les plus proches de l’emploi pour les y amener. Sous deux aspects au moins, arguer d’une différence était incontestablement dire le vrai : l’ancrage dans l’éducation permanente et l’organisation jacobine autorisant des solidarités internes. Néanmoins, objectivement, la construction idéologique était faible, l’attelage pouvait basculer au premier tournant : comment se défendre du reproche, à l’époque commun : « vous renforcez la dualisation de la société », dès lors qu’on revendique procéder à une sélection, ce qui revient à abandonner dans leur situation celles et ceux qui ne sont pas repris ? De surcroît, à observer les réalisations et les fonctionnements, les actions réelles des débuts tenaient assez largement du bricolage. Écrire ceci ne remet pas en cause les acteurs et actrices des origines qui faisaient de leur mieux avec ce qu’ils avaient, composé de bric et de broc, et parfois de compétences peu affutées : on ne se professionnalise pas du jour au lendemain, a fortiori dans des métiers « couteaux suisses » qui demandent d’être entrepreneur, pédagogue, travailleur social, et en capacité de gérer administration et contraintes bureaucratiques.
Plus délicat encore : à s’affirmer radicalement différente des autres, AID s’était autoexclue du réseau associatif participant des débats politiques, ainsi que de « EAP Consultance ». À se focaliser sur le traitement du débat politique interne, on en ignorait complètement les enjeux du débat dans l’environnement. Il n’y avait pas les EAP et les autres initiatives (qui deviendront ultérieurement « ramassées » dans la dénomination « OISP » comme « organisme d’insertion socioprofessionnelle ») ; il y avait un paysage plus fragmenté encore, présenté comme EAP, AID et autres initiatives, alors qu’en définitive les AID faisaient des sections « clones » des EAP, autant que des sections « clones » des OISP.
Difficile encore : les acteurs de terrain AID, lorsqu’ils sentaient qu’ils agissaient dans un climat hostile, en particulier s’ils n’avaient pas le soutien de leur secrétaire de fédération MOC, étaient inévitablement tentés de plaider l’indépendance ou le passage à un autre réseau, plus accueillant. Le mécanisme de la rémunération financière de l’investissement institutionnel du secrétaire MOC (voir supra) n’était pas pour peu dans l’exacerbation des tensions dans les fédérations où le MOC se sentait peu concerné : dans la mesure où elle était perçue sous forme forfaitaire indépendamment de la hauteur réelle de l’investissement, elle y était perçue comme une rente en faveur de l’institution MOC. Du point de vue du coordinateur/directeur local AID, cela ponctionnait injustement des ressources limitées. En contrepoint, il y a aussi eu, dans certaines fédérations, des investissements institutionnels tels qu’on pouvait légitimement les considérer comme sous-rémunérés par le mécanisme[51]. C’était moins le principe de la rémunération d’une tâche qui était le problème que le fait qu’il s’agissait d’un forfait (la même chose pour tout le monde).
Autrement écrit, aussitôt lancé, le système AID pouvait tout aussi bien rapidement imploser. Si aujourd’hui (2023) le secteur ISP est largement admis, reconnu et légitime dans le MOC, ses débuts ont été d’une très grande dureté, quelques acteurs ont dû avancer dans un épais brouillard d’hostilité et dans l’isolement par rapport à leur environnement sectoriel naturel.
Changement de la perspective
Vers un renforcement institutionnel de l’ISP au sein du MOC
Ce qui a permis d’avancer a d’abord été le renforcement progressif des capacités du CIEP national à accompagner les centres locaux dans la professionnalisation de leurs activités. En même temps, de nouveaux centres se créaient, élargissant le réseau et donc renforçant sa crédibilité. Plus tard, des centres créés en-dehors du MOC choisiront de rejoindre le réseau, ce qui est une forme de reconnaissance de la qualité du travail politique et des prestations de services[52]. Et puis, il y a eu un changement de perspective dans l’idéologie : plutôt que de ruser avec le fait, on a hissé haut l’étendard « oui, nous nous occupons des paumés et des largués, et nous le revendiquons ». Cette affirmation a donné lieu à de nouveaux échanges fort chauds, mais au moins la bagarre idéologique interne était devenue explicite autour de la question : « est-ce oui ou non la fonction du MOC de travailler (aussi) avec les largué.e.s de la société ? ». Les acteurs locaux les plus motivés et « politiques » ont été heureux de cette réorientation qui leur envoyait aussi un signal implicite : « dans les équipes nationales, ça se bagarre pour défendre ce que vous faites ». Par ailleurs, pour ne pas perdre les meilleurs, alors que les autres réseaux offraient des perspectives autrement attrayantes du point de vue de la liberté d’action, on a expliqué l’intérêt qu’il pouvait y avoir à être en MOC pour obtenir des relais vers l’action politique plus « macro ». Cela avait comme contrepartie que les agents de la « grande politique » en MOC devaient eux aussi se mobiliser : pas simplement exposer tout le mal qu’ils pensaient des actions ISP, mais mesurer l’écart entre leurs convictions et ce qu’il était possible de faire concrètement sur le terrain en sorte de construire des propositions politiques d’amélioration, et les défendre. Sur la durée, le fait que, par les AID, le MOC a mis les mains et les pieds profondément dans le cambouis a donné une légitimité particulière à ce que ses représentant.e.s pouvaient alors relayer dans des structures sous-régionales, par exemple les Comités subrégionaux de l’emploi et de la formation : ils n’y faisaient pas que de la critique à l’égard des acteurs de terrain à partir de « grands principes politiques » abstraits ; c’était un mix entre des réponses à ce qui se vivait concrètement sur des terrains précis et les intentions sociétales du Mouvement[53].
Initiatives institutionnelles et de partenariat
Parallèlement au travail idéologique, plusieurs initiatives institutionnelles ont été prises. En 1985, une convention locale avec l’enseignement de promotion sociale a pu être passée pour l’activité carolorégienne[54]. Le signal était important, qui signifiait que les actions menées par les AID pouvaient s’articuler aux structures institutionnelles déjà reconnues. Impactant cette fois l’ensemble du réseau, une convention générale avec les « centres d’orientation » de l’ONEM a également été négociée dès 1987[55] et appliquée à partir de 1988. Elle a organisé de façon très systématique des rencontres décentralisées entre l’ONEM et les responsables des centres locaux. À cette occasion, les AID se sont trouvées plein de personnes au sein de l’ONEM puis, après régionalisation, du FOREM/Bruxelles Formation, qui étaient tout à fait heureuses de pouvoir travailler avec des associations ; elles trouvaient que le dynamisme associatif était aussi susceptible d’heureusement percoler sur l’organisation du service public. Bref, les AID ont trouvé des allié.e.s et des sympathisant.e.s assez nombreux au cœur même de l’Office ! En l’occurrence, ce sont deux pôles qui sont entrés en coopération, chacun marginal dans son organisation (les AID au sein du Mouvement, les Centres d’orientation qui ne pouvaient pas être considérés comme « actionnaires de référence » dans l’Office).
La convention a considérablement renforcé la position des AID dans le MOC. Aussi, dans la mesure où l’ONEM, puis le FOREM et Bruxelles-Formation font l’objet d’une gestion paritaire, elle permettait à la CSC de « rentrer dans le jeu », et ça lui plaisait beaucoup. La convention illustrait par ailleurs les déclarations sur « l’intérêt d’être en MOC » pour avancer dans la construction et la légitimation de ce que les gens faisaient avec tant de difficultés sur le terrain : ce n’étaient pas que des paroles, c’était possible ! Donnée essentielle : la convention résolvait la question cruciale du statut des stagiaires, qui devenaient « stagiaires de la formation professionnelle ONEM/FOREM/Bruxelles-Formation ». Cela apportait un solide argument supplémentaire pour justifier la différence des AID par rapport aux autres réseaux, qui, quant à eux devaient continuer à débattre sur la question. Au fil des ajustements successifs de la législation ISP, c’est d’ailleurs la formule qui sera finalement choisie pour sortir de la controverse : un stagiaire en ASBL agréée a statut de stagiaire en formation professionnelle. Avec leur convention, les AID ont anticipé de dix ans ce qui sera la solution collective, ouvrant le chemin à celle-ci[56]. C’est certainement un facteur de satisfaction.
Un autre partenariat significatif s’est construit à partir d’une interpellation conjointe de Vie Féminine et du Service syndical des femmes CSC, en 1989. Leur constat : bien que ça n’avait pas du tout été l’intention initiale, le public des AID était massivement masculin. L’enjeu : il fallait trouver les chemins pour s’adresser tout autant aux femmes. Des activités nouvelles ont alors été montées dans une perspective dite « d’égalité des chances », avec la collaboration des deux organisations. En quelques années, les statistiques internes ont bougé : l’équilibre a été atteint. Mais, c’est lié à la coexistence dans le réseau des deux dispositifs institutionnels : les EAP et les OISP (pour « organismes d’insertion socioprofessionnelle » qui s’adressaient à un public identique mais selon une pratique de formation professionnelle plus classique). Le rééquilibrage statistique a surtout été le fait des OISP, dont on a augmenté les sections et les effectifs. En quelques sortes, et toujours sans spécialement le vouloir, on avait réinventé « l’école des filles » (OISP) et « l’école des garçons » (EAP). Le propos est caricatural, car il y a des femmes en EAP et des hommes en OISP, mais voilà, les filières EAP sont nombreuses dans les métiers de la construction ou de l’horticulture par exemple. Les stéréotypes de genres du point de vue des apprentissages de métiers restent extraordinairement prégnants et en aucun cas ne disparaissent simplement parce qu’on dit qu’ils doivent disparaître ![57].
Cet ensemble d’initiatives a permis des progressions qualitatives très significatives dans ce qui était déployé. Il a aussi fait très sensiblement baisser la conflictualité au sein du MOC, en particulier tout ce qui était alimenté par les critiques des organisations : au tournant du 21e siècle, elles étaient anecdotiques.
Se replacer dans le réseau associatif
Il s’agissait également de sortir les AID de l’isolement dans lequel elles s’étaient placées au sein du réseau associatif. Un accident a été utilisé. Pour une raison que nous ignorons, il y a eu conflit à EAP Consultance ; la fédération socialiste CAIPS en a claqué la porte. En 1990[58], AID a remplacé la partante, forte de sa croissance propre et des liens dont elle pouvait se prévaloir avec la CSC et le FOREM. Elle n’était pas seulement demandeuse, elle apportait dans la corbeille de la mariée un capital de relations déjà structurées avec des partenaires institutionnels utiles à tout le collectif[59] !
Dès ce moment, les AID sont rentrées dans le jeu de la négociation politique sectorielle, aux côtés des collègues des autres fédérations. Il faut avoir en tête que, même s’il y avait des sections de type EAP organisées dans les AID, le souci initial de distinction a fait qu’aucun agrément à ce titre n’a été demandé[60]. C’est pour faciliter le déroulé de l’exposé que nous avons usé de l’appellation « EAP » pour nommer certaines actions ci-dessus : ça avait tout de l’EAP mais, formellement, ça ne se revendiquait pas comme tel. De toute façon, il y avait un refus net d’utiliser une formule de rémunération des stagiaires qui limitait leur accès aux droits de sécurité sociale. Il n’empêche : il fallait continuer à faire évoluer la situation, car moins le paysage est lisible, plus complexe est la défense de la légitimité de l’action. Dans les années qui ont précédé la régionalisation de la formation professionnelle, les acteurs ont avancé ensemble en une sorte de front commun qui a créé une habitude : parler d’un même mouvement de « EAP, AID, autres initiatives d’insertion ». Ce simple fait mettait AID en lumière, à côté des autres. La régionalisation, en 1994, a été un moment clé : les nouvelles entités devaient se positionner sur ce qu’elles faisaient de la législation héritée de la Communauté française. La Région wallonne a opté, dans un premier temps et dans l’urgence, pour ne modifier que l’arrêté EAP. Cette modification a permis de sortir de l’ambiguïté : la nouvelle dénomination « Entreprise de formation par le travail » (EFT) a permis d’intégrer en un même ensemble les anciennes EAP agréées et les activités de même nature menées en AID[61]. En définitive, chaque ASBL pouvait choisir de se faire reconnaître comme EFT ou OISP.
Avant de commencer les négociations sur le nouveau texte, AID a fait fonction de médiateur pour ramener CAIPS autour de la table : il pouvait y avoir eu dispute avec les autres fédérations, il semblait très peu pertinent de mener une négociation aussi importante en tenant à l’écart tout un pan organisé de l’ISP associatif. Les partenaires sociaux étaient eux aussi représentés : l’objectif a été celui du large consensus. Le nouvel arrêté a été adopté en 1995[62]. En Région de Bruxelles-Capitale, c’est d’emblée l’entièreté de la législation qui a été révisée. Elle a intégré la possibilité de la formation par le travail, sous la dénomination cette fois de « Atelier de formation par le travail » (AFT)[63].
Les AID, un service autonome au sein du MOC
Du strict point de vue du rapport des AID au MOC et à l’économie sociale, la suite des événements a été nettement plus linéaire. En 1992, les instances du MOC ont pris la décision de scinder le CIEP : le 1er janvier 1993, en même temps qu’Émile Creutz partait à la retraite, AID est devenu un service autonome, doté d’un directeur, l’auteur, distinct de celui du CIEP[64]. Il s’agit évidemment d’un moment fort dans la symbolique, d’autant qu’un peu plus tard, le directeur AID recevait les fonction et titre « additionnels » de « secrétaire national MOC »[65]. La caractéristique de cette dénomination est que celui ou celle qui en bénéficie reçoit explicitement mandat politique, dans le sens « la confiance est suffisante ; tu es autorisé à t’exprimer pour le compte du Mouvement – donc au-delà de tes responsabilités de service – et ce, sans avoir à solliciter de consignes particulières »[66]. Cela élargissait sensiblement le cahier des charges des matières à traiter par l’intéressé, mais, bien entendu, l’ISP était clairement dans le portefeuille[67]. Cela était néanmoins compensé par le fait que l’équipe a été progressivement étoffée[68]. Via cette fonction additionnelle, couplée à l’intervention active dans l’Interfédération des EFT-OISP Wallonie-Bruxelles, puis dans la FESEFA[69] et la CESSoC[70], les AID ont été étroitement associées à toutes les négociations politiques en matière d’ISP. Elles ont souvent été amenées à « monter en première ligne », y compris sur des dossiers collatéraux, par exemple de programmes de résorption du chômage (TCT, PRIME, APE, ACS) et de conventions collectives sectorielles. La promesse faite jadis (« le MOC est précieux pour servir de relais politique ») s’est paradoxalement résolue en donnant aux responsables AID successifs la légitimité et le soin de traiter de la politique MOC en la matière !
|
Interfédération des EFT-OISP Wallonie-Bruxelles Cette structure a succédé à EAP-Consultance comme espace de concertation et de services. Aujourd’hui, elle porte le nom « Interfédération des CISP » et est l’organe sectoriel représentatif en Wallonie. Depuis 1996, la FEBISP joue le même rôle en Région de Bruxelles-Capitale. Il a été envisagé un court moment de construire une unique structure représentative pour les deux Régions, mais ça ne s’est pas finalisé. Encore un récit possible ! |
Les effets politiques ont cependant été paradoxaux : en même temps qu’on obtenait de bons résultats pour le collectif des EFT et OISP, la spécificité solidaire des AID n’a pas pu être maintenue. Au fil de péripéties qu’on ne détaillera pas ici, les AID se sont retrouvées avec une obligation de démantèlement de leur système « jacobin ». Il était devenu insupportable aux pouvoirs publics de garder un espace d’autonomie associative de telle sorte que c’était l’association elle-même qui décide de l’affectation locale de ses moyens. Notre système créait par ailleurs un déséquilibre par rapport aux situations des autres fédérations ISP, dans lesquelles chaque ASBL gérait sa relation à la subvention en totale autonomie. On s’est retrouvé face à l’injonction « désormais la même chose pour tout le monde » et force a été de constater avec grand déplaisir que nous n’avions pas de soutiens significatifs pour la contrer[71], même du côté de collègues d’autres fédérations, alors qu’il s’agissait aussi d’une brutale atteinte au principe de l’autonomie associative ! De toute façon, la régionalisation avait déjà obligé à scinder les activités bruxelloises et wallonnes. Puis il y eut une séquence où, aux yeux du FSE, le Hainaut avait obtenu un statut particulier qui a obligé à scinder les activités hainuyères de celles dites « du reste de la Wallonie ». Il fallait renverser le système à 180° : plutôt qu’une centralisation des opérations, on a préféré faire reposer les agréments et les subventionnements sur les réalités locales. En même temps, le réseau s’est accordé sur le cahier des charges spécifique de la structure nationale de soutien, et sur les moyens à dégager pour la financer.
|
Les principales missions de l’équipe nationale des AID L’équipe nationale est chargée de cinq fonctions : la représentation extérieure du réseau (ça comprend évidemment la représentation politique) ; le soutien à la gestion (pour compenser le fait que les dossiers sont désormais entre les mains des centres régionaux) ; le soutien au développement de nouvelles initiatives (qui passent fréquemment par des activités européennes transnationales) ; l’animation et la réflexion pédagogique ; la communication et l’information. |
Ce moment de fragilité a pu être transformé en occasion de définitivement conforter la position des AID dans le MOC. Certains secrétaires fédéraux ne restaient en effet pas avares en critiques sur les AID. C’était principalement le travail que ça leur demandait en rapport avec un doute quant à la pertinence d’en avoir fait une telle priorité. À l’occasion d’un séminaire réunissant les responsables nationaux et régionaux durant une semaine en Italie (2000), le directeur AID a pris acte des critiques et proposé un schéma d’évolution radicale du dispositif : puisque les EFT et OISP sont désormais institutionnalisées et peuvent bénéficier de financements suffisants, les centres AID n’ont plus besoin de la « protection » MOC. À l’instar de ce qui s’est fait jadis avec des écoles ou des centres PMS, on peut faire sortir les AID du MOC ; cela n’empêche pas les responsables MOC qui le souhaiteraient de continuer à siéger dans des conseils d’administration ou des « pouvoirs organisateurs », mais la responsabilité du MOC ne serait plus réellement engagée.
La vérité est que ce qui était plaidé était l’exact contraire de ce à quoi voulait arriver le directeur, à savoir conforter définitivement les AID dans le MOC. Une après-midi de « poker menteur » si on veut. Il faut croire que le plaidoyer en faveur de l’autonomie était convaincant : les plus critiques des secrétaires ont soudainement trouvé toutes sortes de grandes qualités aux AID, en particulier le fait que leur propre crédibilité politique locale était largement fonction de centres dans leur périmètre. In fine, le directeur a pris acte de la volonté collective exprimée et a donné la garantie d’être le fidèle exécutif d’une (énorme) réforme du fonctionnement interne pour faire en sorte d’ancrer les AID dans le MOC. Ce travail de réorganisation s’est terminé en 2002 par la signature d’un accord interne entre toutes les parties : les centres locaux et l’équipe nationale, les secrétaires de fédérations et les instances nationales. Par ironie avec les pratiques de réformes de l’État en Belgique, l’affaire a été nommée « accords de la Saint Léonce » du nom d’un des Saints au calendrier (le moins connu d’entre eux), le jour où tout le monde a successivement dit « oui ». Depuis lors, on n’a plus observé un quelconque nuage institutionnel ou problème de légitimité entre MOC et AID. Cela ne veut pas dire « plus de tensions, ni de problèmes », mais on peut les qualifier « d’anecdotiques » par rapport à la situation des origines. Les AID peuvent consacrer leur énergie à l’amélioration des pratiques et à la gestion des perpétuels problèmes importés de l’environnement politique et de financement.
Dans l’intervalle, le réseau s’est élargi à des « centres associés », c’est-à-dire des EFT et/ou OISP qui n’ont pas été fondés dans le MOC, mais qui ont rejoint le réseau eu égard à la qualité des services offerts, en particulier de suivis politiques. Occasionnellement, à partir d’un centre AID, une activité « entreprise » (d’insertion) proprement dite a pu se déployer. Par exemple, à partir de l’AID Val de Senne : « Rappel », société coopérative dans le secteur de la récupération et reconditionnement du matériel électronique à Tubize ; « Restor » magasins de vente du matériel à Tubize et Genappe. Dans l’environnement de « La Calestienne », un centre associé à Beauraing : « Couleur Terre » une société coopérative en écoconstruction, « Brasserie du Pôle ». Dans l’environnement du CF2M à Bruxelles, l’entreprise CF2D (recyclage et revalorisation du matériel IT).
|
Mais finalement, quelle est la date de naissance des AID ? Dans la mesure où le 10e anniversaire a été célébré en 1995, il est admis que la création remonte à 1985, année du premier dossier de demande de financement au Fonds social européen par le CIEP pour compte de quelques initiatives locales d’insertion. Mais à vrai dire d’autres dates auraient pu servir : le premier agrément par la Communauté française (1987) ; le détachement des AID comme service indépendant du CIEP (1993). |
Notes
[1] AID, Rapport d’activités 2022, https://usercontent.one/wp/www.aid-com.be/wp-content/uploads/2023/06/20230602_AID_Rapport-dactivites-AID-2022_vd2.pdf, page consultée le 16 octobre 2023.
[2] Pour être précis : c’est la Confédération des employeurs des secteurs socioculturels et sportifs (CESSoC) qui assume le job de représentation des employeurs. La FESEFA est une des fédérations membres (la plus importante) de la Confédération.
[3] En droit, ce ne sont pas les compétences qui ont été transférées, mais leur exercice. En théorie, cet exercice pourrait revenir dans l’institution de départ.
[4] Alors qu’en réalité elle ne concerne que la région de langue française en Wallonie et que les institutions francophones de la Région de Bruxelles-Capitale. Donc ni toute la Wallonie ni tout Bruxelles ! La constitution ne connait que l’appellation « Communauté française ».
[5] Loi du 29 juin 1983.
[6] Arrêté royal du 16 juillet 1984.
[7] Atelier Marollien avec Jacques Liesenborgh ; Institut de la Providence (Anderlecht) avec Alain Letier.
[8] En particulier Etienne Florkin, secrétaire général de l’enseignement secondaire, défendait cette position avec vigueur, « disputant » les acteurs « en guerre » chacun à partir de sa tranchée. Précisons qu’il n’était pas seul sur cette difficile ligne de crète.
[9] Arrêté royal du 20 novembre 1987.
[10] Décret du 3 juillet 1991.
[11] Arrêté royal du 19 août 1998.
[12] Décret du 19 juillet 2001, en confirmation du décret du 24 juillet 1997.
[13] La gestion de l’Office était paritaire.
[14] Ultérieurement rebaptisée Réalisation téléformation animation.
[15] D’autant que la FUNOC était productrice de recherches particulièrement pointues et innovantes sur le champ d’action qu’elle investiguait, avec Anne Cattiez, Bernadette Lacroix et Paul Demunter.
[16] La télévision locale, longtemps « Canal C », aujourd’hui « Boukè », fait depuis lors l’objet d’une gestion dans une ASBL distincte de RTA.
[17] Cette séquence de folie instituante a été courte : de septembre 1981 à décembre 1983. Nous étions dans un cadre hiérarchique, mais l’équipe impliquée tentait vaille que vaille de fonctionner en autogestion. Raison pour laquelle il se justifie, en bonne justice, de citer tous les participants à l’aventure : outre l’auteur, Françoise Antoine, Abel Carlier, Christiane Debodt, Agnès Delvaux, France Derasse, Claude Hardenne, Marie-Pierre Mathy, Cécile Olivier, Bernadette Saint-Remy, Patrice Sellier, Christian Vandiepenbeeck (ce dernier reprendra la coordination de la formation RTA à partir de 1984).
[18] Cas de la coopérative lancée par « Luttes solidarités travail » à Namur.
[19] Cas de l’ASBL « Quelque chose à faire », lancée en 1981 à Charleroi, à l’initiative d’une figure emblématique : l’abbé Roger Vanthournout, un prêtre ouvrier maçon, qui mourra assassiné par un de ses stagiaires, le 28 juin 1989. Un prix annuel en économie sociale porte son nom. Référence : COULON J., Roger Vanthournout. Demain, qui nous donnera du travail ?, Bruxelles, Editions Vie ouvrière, 1999.
[20] En France, la majorité a été abaissée à 18 ans dès 1974, peu de temps après l’élection de Valéry Giscard d’Estaing à la présidence de la République. Un premier projet de loi à l’initiative du ministre de la Justice, le libéral Herman Vanderpoorten, a été débattu en Belgique en 1975, sans cependant aboutir.
[21] Loi du 19 janvier 1990.
[22] Du point de vue de l’histoire interne de la Fondation, il s’agissait de son second programme social : c’était l’appellation officielle.
[23] GEORIS P., Les entreprises d’apprentissage professionnel, Bruxelles, FRB, 1986.
[24] À l’époque présidé par Jacques Étienne (PSC), le CPAS de Namur était ouvert à l’expérimentation (il en menait lui-même, en particulier un atelier maraîchage) et a été très coopérant avec les associations, fût-ce dans une relation de « coopération conflictuelle ».
[25] On trouvera une mise en récit de CNFA (jusque 1988) dans : GEORIS P., « Le partenariat : une évolution réaliste du travail social. Partenariat et projets d’insertion sociale et professionnelle », Revue d’action sociale, septembre-octobre 1988, p. 79-90.
[26] De manière générale, la situation avec le FSE ne s’est pas améliorée. Au contraire, elle s’est aggravée ! On en est à clôturer l’exercice 2017 en 2023, soit avec cinq ans de retard. Dans un contexte où la lettre des réglementations prime toujours plus que leur esprit, où au prétexte de lutte contre la fraude on en arrive à contrôler le contrôle puis le contrôle du contrôle dans une sorte de circuit paranoïaque sans fin, où – pire encore – des règles sont modifiées en cours de programmation pluriannuelles et sont annoncées aux acteurs comme s’appliquant rétroactivement, on peut l’écrire : le projet FSE est heureux mais son fonctionnement honteux.
[27] Grosso modo, la moitié du personnel était dans le régime du Cadre spécial temporaire (CST), un des lointains ancêtres des actuels APE wallons et ACS bruxellois. Il s’agissait de contrats d’un an, renouvelables une unique fois, qui n’ouvraient pas l’entièreté des droits en matière de sécurité sociale (côté pension), ce qui explique que c’était le plus souvent qualifié de « sous-statuts ». L’ONEM payait directement les salaires des intéressé.e.s, même si, formellement, ils avaient un employeur associatif.
[28] Le militantisme associatif n’est pas sans risque et comporte des séquences méconnues.
[29] C’est Jean-Marie Berger qu’on évoque ici.
[30] Autres traces écrites de ce programme : DE PIERPONT C., Carrefour 85. Action sociale et réalités du milieu rural, Bruxelles, Fondation Roi Baudouin, 1986 ; CORNET A., Enfance et exclusion… c’est Mozart qu’on ressuscite, Bruxelles, Fondation Roi Baudouin, 1988 ; GEORIS P. et POELMAN M., Jeunes et exclusion, Bruxelles, Fondation Roi Baudouin, 1988. Aussi quelques exemplaires d’un magazine PARI pour répercuter l’action du deuxième programme social.
[31] Après Georges Rémion, Paul Maréchal a joué un rôle déterminant dans ce soutien, les deux secondés par Dominique Depuydt.
[32] Arrêté royal n° 499 du 31 décembre 1986, pris dans le périmètre des pouvoirs spéciaux que le Parlement avait octroyés au gouvernement social-chrétien-libéral Martens-Gol.
[33] À l’initiative du ministre des Affaires sociales, de la Formation et du Tourisme, dans le gouvernement de la Communauté française, Édouard Poullet (PSC), arrêté du 23 janvier 1987. Il sera réécrit ultérieurement, à l’initiative du ministre de l’Enseignement, de la Formation, du Sport, du Tourisme et des Relations internationales Jean-Pierre Grafé (PSC), arrêté du 16 septembre 1991.
[34] Logiquement, un arrêté suit un décret, dont il précise certaines modalités d’exécution. Ici, l’arrêté a précédé le décret, ce qui représente une curiosité juridique.
[35] À l’initiative du ministre Édouard Poullet (PSC), décret du 17 juillet 1987.
[36] Compétence à l’époque toujours de l’État central. Les TCT (Troisièmes Circuits du Travail) avaient pris la relève des CST déjà évoqués.
[37] À l’initiative du ministre Édouard Poullet (PSC), arrêté du 5 octobre 1987.
[38] Un mandat était aussi prévu pour une représentation de la Fondation Roi Baudouin. En l’occurrence, c’était un siège pour l’auteur ! Rétrospectivement, on peut en sourire. Dès la fin du contrat de l’auteur à la Fondation, le 31 décembre 1987, elle n’a plus trop su quoi faire de son mandat.
[39] FISAJ (Fédération des institutions spécialisées dans l’aide à la jeunesse) et FIAS (Fédération des institutions d’aide sociale) se sont ensuite donné ACFI (Action commune de formation et d’insertion) comme outil commun pour leur action en ISP. Aujourd’hui, c’est intégré dans UNESSA.
[40] Aujourd’hui CAIPS (Concertation des ateliers d’insertion professionnelle et sociale).
[41] ALEAP = Association libre des EAP.
[42] La tradition orale rapporte que la dénomination AID a été inspirée d’une conversation entre Henri Scorier, du CIEP et Paul Demunter (FUNOC). De toute évidence, l’échange a dû porter sur une modélisation macroscopique (et ambitieuse) d’une politique de sortie de crise.
[43] Animé par Nathanaëlle Adam.
[44] Qui deviendra l’actuel « Centre de Soleilmont ». À l’époque, « Centre des bateliers » parce qu’installé dans les anciens locaux d’une école pour enfants de bateliers ! C’était le produit d’un partenariat entre le CIEP de Charleroi et l’ENAIP, une « filiale » de formation professionnelle de l’association de travailleurs migrants italiens chrétiens, les ACLI. La permanente JOC de Charleroi, Véronique Quinet, s’y est impliquée, ainsi que Michel d’Outremont, un prêtre ouvrier de Jumet.
[45] Avec Francis Bizet, permanent JOC et Thierry Monfils. Joël Gillaux, lui-aussi issu de la JOC, est entré dans le circuit par l’AID de La Louvière, qu’il a coordonnée durant quelques années, dont la première sous le statut de chômeur dispensé de pointage (de fin 1988 à fin 1989), faute d’emploi disponible dans le dispositif : autrement écrit, toute la charge endossée à titre gratuit.
[46] On ne dénoncera pas ici l’auteur de ces propos qui ont été réellement tenus devant nous (à l’oral seulement). On enregistrera par ailleurs qu’il n’y a aucune interrogation quant aux raisons qui pourraient pousser des jeunes à poser de tels actes.
[47] On admettra que l’ISCO méritait cette fierté, ainsi que ses acteurs et actrices du quotidien.
[48] Il faut mettre à son immense crédit d’avoir déployé un parapluie sous lequel quelques acteurs et actrices ont pu expérimenter dans une certaine sérénité.
[49] Il est cité ici nommément parce qu’il faut que son nom apparaisse quelque part pour l’Histoire alors que c’est de façon inexacte que l’auteur des présentes lignes est parfois décrit comme étant lui-même le fondateur. C’est très injuste à l’égard du « vrai », qui a « sué sang et eau » pour mettre le dispositif en route, dans des conditions ingrates, sans guère de reconnaissance fût-elle symbolique et dans une relative hostilité et solitude (à l’exception du soutien d’Émile Creutz et de quelques responsables locaux).
[50] L’activité a ensuite été intégrée à « L’escale », l’ASBL AID pour la Wallonie picarde.
[51] Dans le jargon AID, on nommait cela « part structurelle ».
[52] Dans le vocabulaire interne, on parle de « centres associés » pour nommer les AID dont le MOC n’est pas le pouvoir organisateur exclusif.
[53] On évoque ceci car c’est ce qui a été au cœur du débat interne au MOC en 2001, lorsque, après l’institutionnalisation « définitive » des EFT et des OISP, la question a été posée du maintien des AID dans le MOC ou de leur prise d’autonomie, à présent que toutes les conditions étaient réunies pour le faire. C’est parce que les AID permettaient une plus grande crédibilité dans l’expression de positions politiques par les secrétaires MOC que la décision a été unanime pour les « garder à l’intérieur ». 13 ou 15 ans plus tôt, la configuration était tout autre ; les AID sont « passées par le trou de souris », un peu aidées, il est vrai, par l’extraordinaire embrouillamini institutionnel que représente le fonctionnement du MOC (ça mériterait un récit en soi).
[54] À l’AID « Centre des bateliers » (qui deviendra ultérieurement « Centre de Soleilmont ») à Charleroi, avec l’enseignement de promotion sociale de la ville. Le récit de cette séquence se trouve dans GEORIS P., « Le partenariat : une évolution réaliste du travail social. Partenariat et projets d’insertion sociale et professionnelle », Revue d’action sociale, septembre-octobre 1988, p. 79-90.
[55] Par Henri Scorier (CIEP-AID) et André Piette (ONEM).
[56] Pour un descriptif et une évaluation générale de la convention : GEORIS P., « Un partenariat qui va avoir 10 ans : la convention FOREM-AID », L’Essor. Trimestriel de l’Interfédération, n° 8, octobre 1997, p. 17-18.
[57] Pour un descriptif et une évaluation générale de la convention (avec des surprises dedans !) : GEORIS P., « Partenaires pour plus d’égalité », Le nouvel Essor de l’Interfédération, n° 23, mars 2003, p. 22-24. Depuis cette époque, la situation a lentement évolué dans le bon sens : en menuiserie par exemple, les groupes ont progressé en mixité. Il y a par ailleurs, aujourd’hui, des centres offrant des formations à des métiers dits « d’hommes » selon les codes stéréotypés qui sont dirigés par des directrices.
[58] Nous datons de mémoire. Ce qui peut vouloir dire que le claquement de porte se soit produit un peu plus tôt ou un peu plus tard. Il est en tout cas certain qu’en septembre1989 les socialistes y étaient encore et qu’en 1992 AID était pleinement partie prenante. C’est entre ces deux dates que le switch s’est opéré, à un moment vraisemblablement plus proche de la première date que de la deuxième, d’où le choix ici un peu arbitraire de 1990.
[59] Dans la mesure où l’agent AID de ce rapprochement était aussi celui déjà bien connu du milieu pour ses intermédiations antérieures sous « casquette » FRB, l’interpersonnel a sans doute joué un rôle pour fluidifier la « réconciliation » générale.
[60] À l’exception cependant de l’ASBL « Espaces » à Ciney qui avait pour particularité d’être affiliée à deux fédérations, AID et ALEAP. Elle a fini par opter pour ALEAP.
[61] La FRB a joué un rôle très actif en acceptant de publier et publiciser plusieurs travaux sur le sujet ou à proximité (travaux parfois commandés par elle-même). On enregistrera notamment : DREZE B., DUPONT V., GEORIS P., LAFFINEUR J-Y., Formations par le travail. Une pédagogie contre l’exclusion. EAP, AID, ASBL d’insertion, Bruxelles, Fondation Roi Baudouin, 1992 ; FUSULIER B., MERTENS S., L’intervalle formateur, Bruxelles, Fondation Roi Baudouin, 1996.
[62] À l’initiative du ministre de l’Emploi Albert Liénard (PSC), arrêté du gouvernement wallon du 6 avril 1995. Henri Scorier avait rejoint le cabinet Liénard en 1994 et était en charge de la matière : être face à un interlocuteur qui connait le sujet est très aidant !
[63] À l’initiative du Ministre-président de la Région bruxelloise Charles Picqué (PS), décret COCOF du 27 avril 1995.
[64] Christian Piret devenait le nouveau directeur du CIEP.
[65] Au 1er octobre 1994.
[66] Formulation « à la grosse louche » : la fonction ne dispense évidemment pas de l’alignement sur les positions politiques du Mouvement, ni le contrôle par les instances ! Mais elle donne une vraie marge de manœuvre dans les (nombreuses) zones d’incertitude du système.
[67] En l’occurrence, le cahier des charges était le suivi des politiques régionales wallonnes, des politiques de l’emploi ainsi que de lutte contre la pauvreté (cette dernière principalement via une plateforme « Solidarités en plus – Pauvreté en moins » qui associait le MOC, le PS, la Ligue des familles, ATD-Quart-Monde et la section CPAS de l’Union des villes et communes). Dans une période antérieure de l’Histoire du Mouvement, cette fonction aurait valu le titre de « propagandiste national ».
[68] Une très bonne complémentarité a été trouvée entre le directeur et Joël Gillaux, qui lui succédera dans la fonction à partir d’août 2005. Les dossiers les plus rudes (et il y en eu, dont on ne fera pas le récit ici) ont été traités en duo et les solutions à proposer instruites ensemble.
[69] La FESEFA est la fédération patronale des secteurs de l’éducation permanente, l’insertion socio-professionnelle et l’intégration.
[70] La CESSoC est la confédération des secteurs socioculturels et sportifs. Elle représente les employeurs francophones et germanophones dans la commission paritaire 329. La FESEFA est un des membres de la CESSoC.
[71] Il est des moments où la solitude est expérimentée très profondément ! Avec le « coup de mou » (et la colère) qui vont avec ! Propos subjectif assumé.
Pour citer cet article
GEORIS P., « Les actions intégrées de développement (AID) », Dynamiques. Histoire sociale en revue, n°22 : L’économie sociale en Mouvement(s), décembre 2023, mis en ligne le 20 décembre 2023, https://www.carhop.be/revuescarhop/
