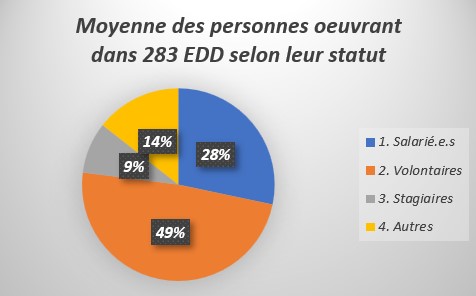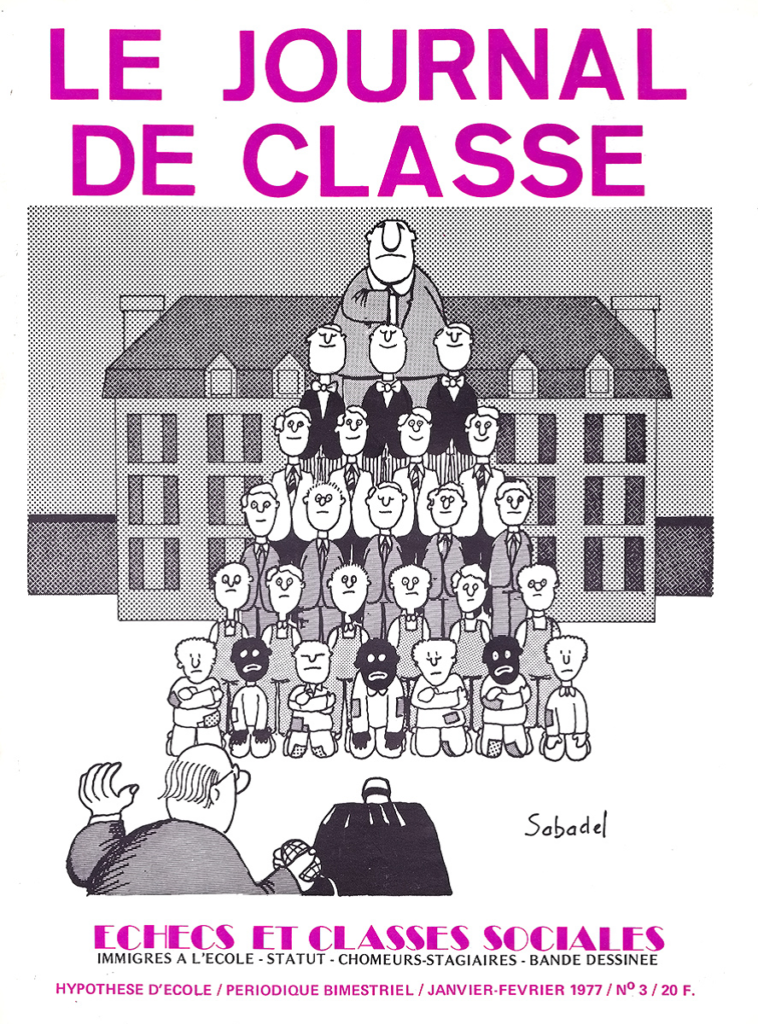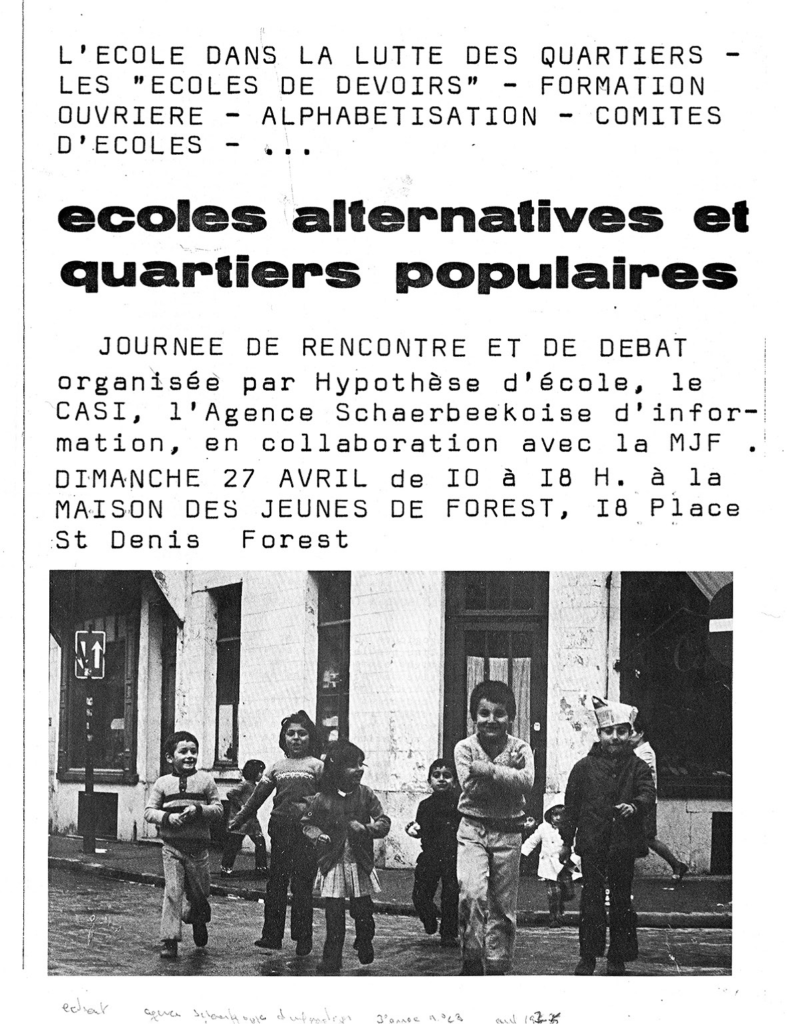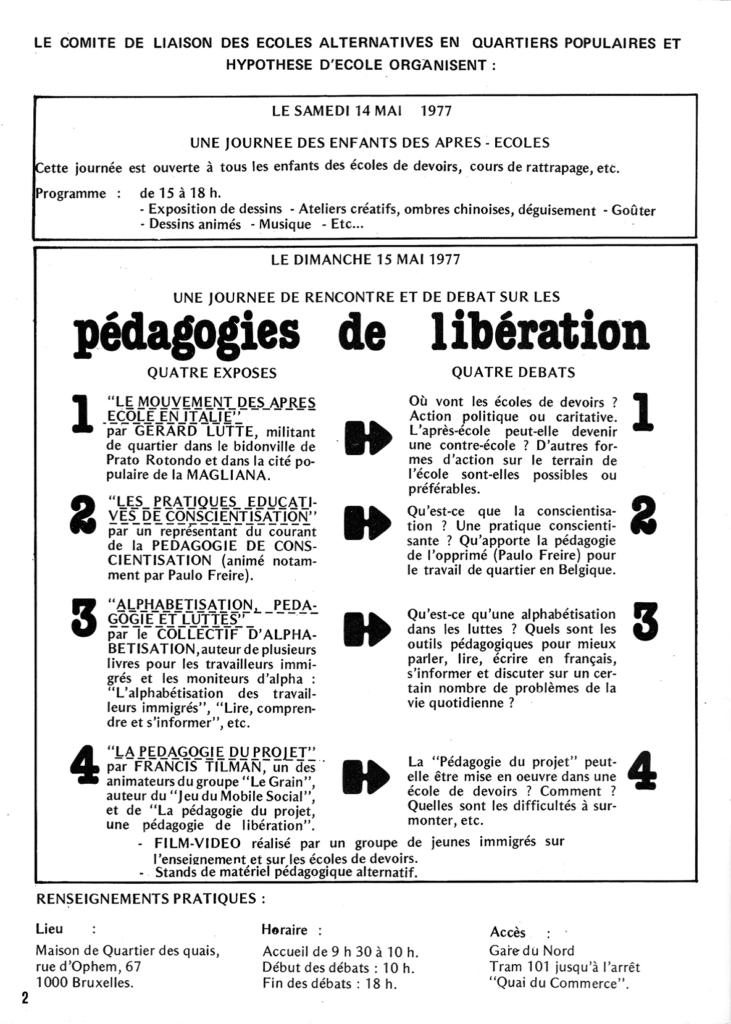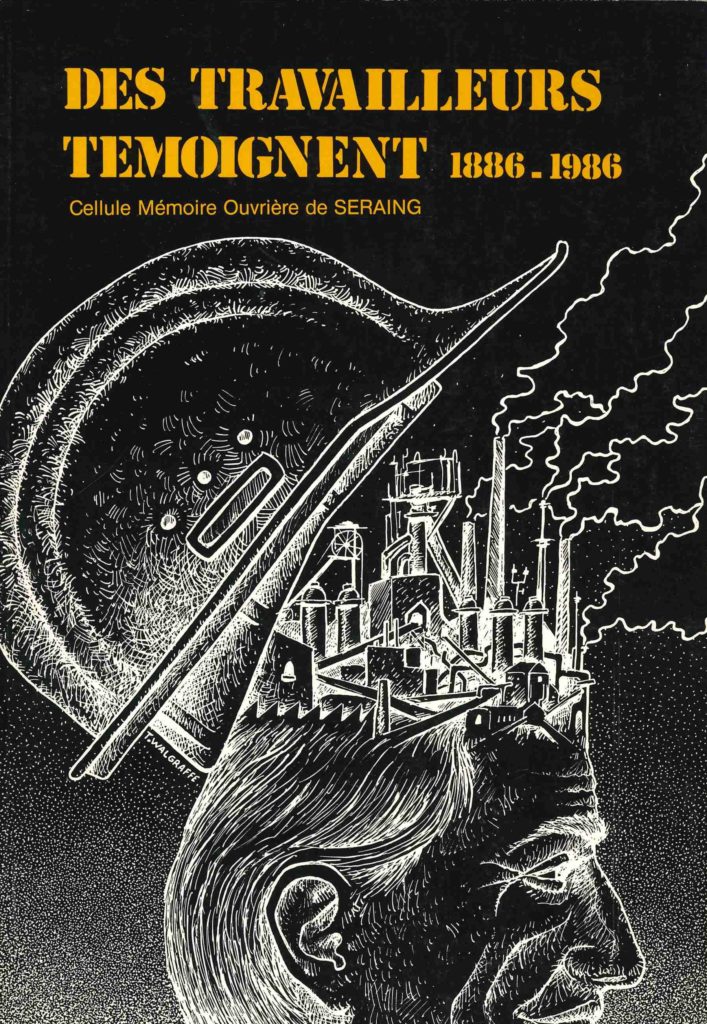Pierre Tilly (historien, HELHa et UCL Mons)
Julien Tondeur (historien, CARHOP asbl)
Qu’est-ce que l’histoire du Congo colonial nous apprend sur les réalités du travail d’hier et d’aujourd’hui ? Voici l’un des fils rouges que les intervenant.e.s ont tissé au travers de leurs contributions respectives à l’occasion du colloque international « Travail et conditions de travail hier et aujourd’hui en RD Congo », organisé par la Commission Justice et Paix, la HELHa et le CARHOP le 05 mai 2021. Le chantier relatif au travail colonial et post-colonial reste largement ouvert et en partie en friche pour les historien.ne.s et pour toutes celles et ceux qui se penchent sur l’histoire et la mémoire coloniale. C’est un sujet loin d’être épuisé et d’une extraordinaire actualité. Les avis et analyses partagés lors de ce colloque et reproduis dans ce numéro de Dynamiques. Histoire sociale en revue convergent vers un diagnostic du présent en matière de travail en République Démocratique du Congo et celui-ci donne le frisson. Le travail aujourd’hui en RD Congo, tue plus qu’il ne fait vivre les salariés.e.s. Le constat est dur et lourd à porter pour les acteurs et les actrices, mais il faut le remettre en perspective et l’affronter dans toutes ses dimensions, notamment en jetant un regard vers le passé qui intègre une donnée essentielle : le déterminisme historique n’existe pas.
Les sociétés colonisées comme celles qui ont endossé le rôle de colonisatrices partagent une histoire commune qui nous amène à nous interroger collectivement et individuellement sur cet héritage du passé et sa place dans le présent, en mobilisant la mémoire des rapports pays colonisateur-pays colonisé et colonisé.e.s-colons. Ces rapports doivent par ailleurs être analysés dans les deux sens. Loin de tourner le dos à ce passé, il s’agit de le revisiter et de le redessiner à l’aune d’enjeux contemporains, en misant sur les contacts et le métissage plutôt que sur la conflictualité et sur un dialogue de sourds. La relation au passé colonial nous renvoie inévitablement à des questions d’identité collective que la colonisation, par sa nature dominatrice et prédatrice, a évidemment malmenée et déstructurée.
Dans une perspective culturelle et de nature citoyenne à laquelle une démarche d’éducation permanente peut contribuer, l’objectif à atteindre vise à dialoguer et échanger entre jeunes et moins jeunes, Belges et Congolais.e.s sur les réalités du travail hier et aujourd’hui. Dans un processus d’éducation permanente, l’historien.ne recueille la parole des acteurs et actrices de l’histoire, afin de libérer leur témoignage, de se raconter, pour favoriser et développer une prise de conscience individuelle et collective et une connaissance critique des réalités de la société. Inscrits dans une perspective plus large, enrichis d’un contexte social, économique, politique et culturel, ces récits peuvent ensuite être réappropriés par les acteurs et actrices des mouvements sociaux, par les travailleurs et travailleuses.
Cet exercice peut être atteint en jetant des ponts entre les générations, comme Donatien Dibwe le réalise dans sa contribution à ce numéro, lui qui analyse ce qu’est devenu le travail dans la mémoire des travailleurs et travailleuses de la ville de Lubumbashi. Pour cet exercice, il prend comme point de départ le dialogue entre deux représentants de générations et de mondes de travail différents. Mais c’est une démarche que nous invite à suivre plusieurs autres analyses proposées. L’évocation des combats anciens, replacés dans leur contexte spécifique et historique, est parfois porteuse de changements de perspectives. La démarche permet également une prise de distance par rapport à un quotidien qui semble sans horizon mais pas sans espoir, comme si l’histoire ouvrait le champ des possibles. Au plan historique, la liberté syndicale acquise seulement en 1957, soit trois ans avant l’indépendance de la RD Congo et après des années de lutte, représente un bel exemple à ce titre. Ce qui ne doit pas empêcher la critique et un nécessaire recul Fanalytique, car il existe toujours un écart entre la reconnaissance légale et la réalité du terrain. Tout dépend évidemment du rapport de force qui peut être établi ou non en faveur des travailleuses et travailleurs, quels que soient les lieux et les époques.
Le passé colonial ne se résume pas à des archives textuelles, sonores et visuelles bien sûr, mais il a été transmis et continue de l’être tout en étant transformé au fil des sociétés qui en ont hérité. Il est impératif de mobiliser ce patrimoine, de le revisiter, de l’enrichir car il peut contribuer à assouvir le besoin de comprendre le présent que ressent la société actuelle. En se plongeant dans le temps long des flux et des héritages, on enrichit sa connaissance et la perception que l’on peut avoir quant au poids du passé sur nos vies contemporaines.
La coexistence de deux mondes, le rural et l’industriel, dit moderne, a longtemps été polluée par une narration savamment entretenue par le pouvoir colonial. Celle-ci évoque une Afrique ancienne « immobile », figée dans la Tradition, elle aussi avec un grand T, dont les « coutumes » seraient restées inchangées jusqu’à l’intrusion de la « modernité » coloniale. Or, il ne faut ni perdre de vue les évolutions historiques du monde rural, ni les résistances de ce dernier à l’instauration de la domination coloniale, comme le confirme l’analyse d’Ascépiade Mufungizi, avec l’exemple des Bashi dans le Kivu. D’autres éclairages sur les résistances à l’occupation européenne et au travail forcé, abordés à la lumière de l’expérience de l’Entre-deux-guerres mériteraient d’être élargis à d’autres espaces et territoires.
Le travail forcé colonial est institutionnalisé en RD Congo dans les années 1920 après avoir été expérimenté durant la décennie précédente. Si l’époque du travail forcé semble, dans l’imaginaire occidental collectif, a priori en partie révolue, une piqûre de rappel historique s’impose. L’abolition de l’esclavage devait permettre de libérer les forces productives nécessaires à la mise en place d’un marché du travail libre. On sera très loin du compte au cours de la période coloniale sauf peut-être, et de manière très relative, à la fin de celle-ci, dans les années 1950. Le pouvoir colonial s’est révélé incapable d’assurer la transition entre l’esclavagisme et l’avènement d’un travail libre et émancipateur. Comme le démontre Pierre Tilly dans son analyse, il a utilisé la force et la contrainte dans le recrutement des travailleurs et des travailleuses, car il s’agissait avant tout de mettre en valeur les territoires grâce à l’utilisation intensive de la main-d’œuvre, tout en instaurant un ordre politique et social favorable à ses intérêts économiques. Et, jusqu’au dernier jour de la colonisation, un apartheid de fait hiérarchise l’ensemble de la société. « Le plus petit des Blancs restera toujours au-dessus du plus haut des Noirs », ainsi que le démontre François Ryckmans dans sa contribution. Dans le système colonial, système d’inégalités de droit et de fait entre colonisateurs et colonisés basé sur la différenciation raciale, être Blanc ou être Noir définit et assigne les individus à leur place dans la société avant tout autre critère.
Suivant la vague paternaliste au cœur des rapports sociaux entre colonisé.e.s et colonisateurs, la valeur « libératrice » du travail ou sa « vertu éducative » est portée au fronton de l’administration du Congo belge comme base du succès de l’entreprise coloniale, justifiant du même coup la pratique du travail forcé. La glorification du travail ne s’est pas évanouie avec les indépendances. Les élites postcoloniales, pour mobiliser les populations dans la gestion du chantier national, ont appelé à la mise au travail des forces vives de la nation, stigmatisant dans le même temps l’inactivité et l’oisiveté, considérées comme un frein à la construction nationale.
Pour compléter l’analyse, on ne peut faire l’économie de se pencher sur le temps présent et la question de la formalisation de l’informel. En RD Congo, plus de 80 % de la population active est obligée de trouver une occupation dans la subsistance du secteur informel. Comme le soulignent de nombreux rapports scientifiques et d’organisations nationales et internationales, les conditions de travail sont souvent déplorables et la précarité des revenus frappe non seulement les individus mais elle ruine aussi les relations dans les communautés concernées. Ce processus d’informalisation de l’économie congolaise a été mis en place et encouragé par les milieux d’affaires pour contrer la baisse des taux de profit, avec la complicité d’une partie des élites politiques et économiques de la RD Congo. Le secteur informel a connu une formidable explosion dans le cadre des nouvelles formes d’externationalisation de la production minière, analysée dans cette revue par Sara Geenen. Cette informalisation du travail et les avantages qu’en retirent les entreprises évoquent pour la communauté historienne le système de production décentralisée, fondé sur le travail à domicile, qui prédomina dans certaines régions d’Europe à l’époque de la proto-industrialisation. L’entrepreneur fournit aux ouvriers et ouvrières les matières premières ou les produits semi-finis à travailler en échange d’un salaire, généralement dans un délai déterminé. La sous-traitance décrite ici dans le secteur minier au 21ème siècle n’est pas une nouveauté en Afrique subsaharienne. Dans un état qui ne parvient ni à garantir la sécurité de ses citoyen.ne.s, ni à assurer une sécurité sociale et d’existence, elle est une nécessité autant vitale que destructrice. C’est ce paradoxe que Marie-Rose Bashwira met en exergue, à savoir le caractère d’exploitation du travail minier et son rôle de moyen de subsistance pour une bonne partie de la population locale. Dans le secteur minier artisanal en RD Congo, malgré la loi et l’action des associations, l’exploitation, en particulier des femmes et des enfants, se produit au travers de contrats oraux et de dettes contractées par écrit. Le caractère socialement « acceptable » de ces formes d’esclavage moderne mais également le déni dont nombre d’acteurs font preuve à son égard rendent la situation plus compliquée encore. Les inégalités salariales au plan matériel se prolongent au travers du statut social. S’il y a un côté qui peut être considéré comme positif, à savoir l’emploi local, les mauvaises conditions de travail et les salaires précaires viennent ternir le tableau. Le secteur minier est également à pointer du doigt pour son implication dans les conflits armés et par ricochet, les conséquences sur le travail des enfants. Indépendamment des liens évidents entre les « minerais du sang » et les zones de conflits, la majorité des enfants associés aux forces et groupes armés en RD Congo sont en effet également exploités dans les mines artisanales, comme l’expose Patrick Balemba dans sa contribution. Si la situation est parfois meilleure dans le secteur formel, Henri Muhiya démontre dans son analyse comparée des conditions de travail entre les exploitations minières industrielles et artisanales du pays, que la différence est souvent minime.
La situation n’est pas idéale non plus au niveau du travail syndical aujourd’hui en RD Congo. Le contexte qui préside à son action est particulièrement difficile. Comme le montre Fidèle Kiyangi dans son exposé, l’inexistence d’un véritable dialogue social, le non-respect des engagements pris, les retards multiples dans le paiement des salaires tant dans le secteur public que privé et les absences d’un État de droit dans nombre de situations de la vie quotidienne, rendent toute action syndicale très difficile. Face à ces enjeux du quotidien des travailleurs et travailleuses, le syndicalisme congolais se montre tout autant créatif que désuni. La lutte syndicale passe hier comme aujourd’hui par l’éducation syndicale des membres, mais aussi par la coopération syndicale internationale, évoquée par Agathe Smyth. En la matière, il y a très certainement une expérience historique sur laquelle Congolais et Belges peuvent s’appuyer et s’entraider.
POUR CITER CET ARTICLE
Référence électronique
TILLY P., TONDEUR J., « Conclusions du dossier. Revisiter le passé colonial pour en accepter l’histoire et avancer ensemble », Dynamiques. Histoire sociale en revue, n°15-16 : Travail et conditions de travail en RD Congo hier et aujourd’hui, octobre 2021, mis en ligne le 18 octobre 2021. URL : www.carhop.be/revuescarhop/