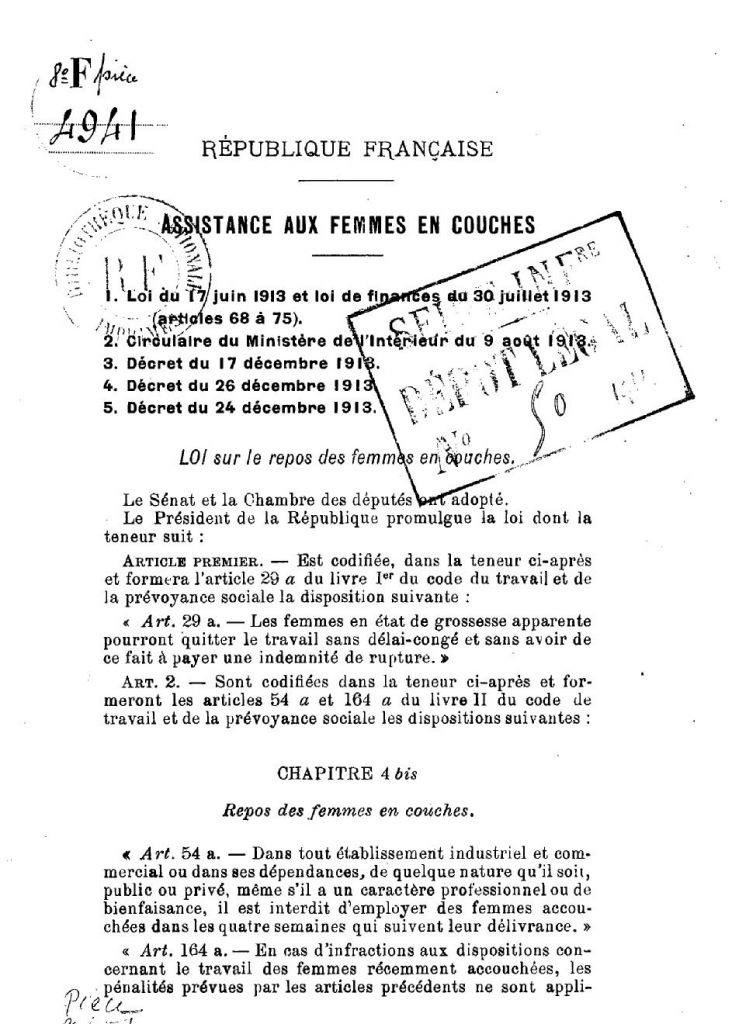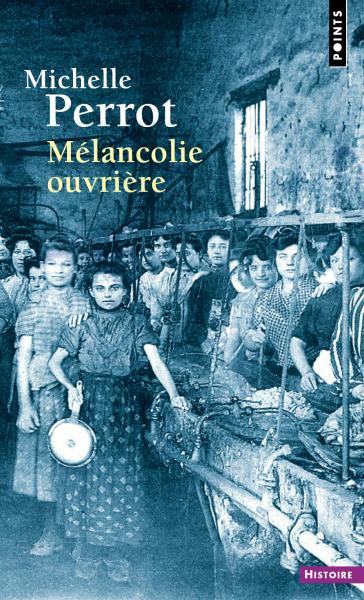PDF
Lionel Vanvelthem (historien, IHOES)
L’exposition « Femmes en colère » organisée par la FGTB et la CSC liégeoises pour les cinquante ans de la grève des ouvrières de la FN[1] a donné aux équipes historiques de l’IHOES et du CARHOP une belle occasion d’exhumer de nombreux documents d’archives ou objets en rapport avec cet événement emblématique : photographies, tracts, brochures, coupures de presse, éléments de la vie quotidienne, vêtements de travail, machines-outils, sources audiovisuelles et, enfin, documents audio. Le présent article ne s’intéressera qu’à ces derniers, en mettant délibérément de côté les autres types de sources. Il tentera notamment de répondre à la question suivante : qu’aurait été l’histoire de la grève des ouvrières de la FN sans les sources orales, sans les archives sonores ? Autrement dit : qu’aurait été l’histoire de cette grève sans la parole de celles qui l’ont vécue au plus près ?
Mettre en valeur la parole des travailleuses de la FN, c’est non seulement reconnaître leur rôle d’actrices historiques de premier plan, mais c’est aussi un moyen de nous imprégner de leur détermination et de leur énergie, à une époque où l’égalité hommes-femmes est loin d’être acquise et où sa mise en œuvre est remise en question par certains groupes au sein de notre société. Nous le verrons en détail plus loin : certains enregistrements de la grève de 1966 – qui donnent la parole, avec le moins d’entrave possible, aux « oubliées de l’histoire » – constituent des éléments importants pour la préservation de la mémoire populaire.
De manière schématique, les sources sonores de la grève peuvent être classées en deux grandes catégories :
le sonde la grève, correspondant aux sources contemporaines à l’événement (dites aussi sources primaires), c’est-à-dire enregistrées pendant la grève ou très peu de temps après : ce sont entre autres des prises de son in situ (dans une assemblée, dans une manifestation…) et des interviews de témoins ou d’actrices de la grève au moment de son déroulement ;
l’écho de la grève, correspondant aux sources enregistrées a posteriori, parfois plusieurs dizaines d’années plus tard et appartenant au registre de la mémoire et du souvenir : ce sont des interviews historiques, des témoignages, des récits de vie au cours desquels d’anciennes grévistes se remémorent les événements qu’elles ont vécus, en se les réappropriant et en les réinterprétant à l’aune de ce qu’elles ont vu, lu, entendu ou appris ultérieurement au cours de leur parcours personnel ou professionnel.
Il est important de bien distinguer ces deux catégories. Les sons enregistrés pendant la grève « ne mentent pas » : ils forment une trace brute, à vif, de l’événement et peuvent, comme toute autre archive d’époque (document « papier », photographie, article de presse, etc.), être passés au crible de la critique historique traditionnelle (critique externe et interne du document, critique de provenance…). Ce n’est pas le cas des sources orales enregistrées a posteriori, dont l’analyse et l’utilisation posent des problèmes particuliers, beaucoup plus délicats : quelle « valeur » historique donner à la parole d’une personne interrogée dix, vingt, voire cinquante ans après les événements auxquels elle a participé ? Comment déceler, dans un témoignage, ce qui est de l’ordre du mythe ou de la reconstruction mémorielle ? L’exploitation de ce type de sources demande une méthodologie spécifique et des précautions bien plus grandes que celles en vigueur pour une « simple » archive sonore[2].
La plupart des sources sonores qui seront présentées dans la suite de ce texte peuvent être écoutées en ligne sur la plate-forme « Mémoire orale » (www.memoire-orale.be), portail Web initié par la Fédération Wallonie-Bruxelles, mis en place et géré par l’IHOES. Deux thématiques y ont été créées pour l’occasion, reprenant la même distinction entre, d’une part, les sources primaires de la grève (le son) et, d’autre part, les sources collectées ultérieurement (l’écho)[3].
Le présent article est également repris, sous une forme légèrement différente et un peu plus longue, comme analyse d’éducation permanente sur le site Web de l’IHOES[4].
Le son de la grève : analyse de trois bandes sonores analogiques datant de 1966
Les archives sonores dont il sera question dans cette partie appartiennent au fonds Jacqueline Saroléa, syndicaliste, militante féministe et journaliste qui, en 1966, a couvert la grève à l’aide d’un magnétophone portable à bande magnétique. Conservé à l’IHOES, ce fonds d’archives est entre autres composé de 174 bandes sonores analogiques ou cassettes audio consacrées à divers sujets de société comme, en vrac, le travail des femmes, le combat en faveur de l’avortement, le problème des femmes battues, la féminité, l’éducation des enfants, les grèves, la formation syndicale, les réformes de structure, la Wallonie, le fédéralisme, la ruralité, le théâtre, le folklore…[5] Les bandes sonores consacrées à la grève des travailleuses de la FN, particulièrement bien conservées et numérisées en 2015, sont au nombre de trois et portent les numéros d’inventaire 260, 261 et 262.
Jacqueline Saroléa (1924-2004) : courte biographie[6]
Jacqueline Saroléa a seulement 16 ans lorsque la Seconde Guerre mondiale éclate. Elle participe à la Résistance et se lie avec les milieux de gauche. Cinéphile, elle fréquente après la guerre le Club de l’Écran, où elle rencontre son futur mari, Georges Vandersmissen (syndicaliste belge, proche d’André Renard).
Elle s’investit au niveau syndical à partir de la grève de l’hiver 1960-1961, notamment en tenant le piquet de la Grand Poste de Liège en compagnie d’une délégation de militantes. Après cette grève emblématique, elle participe à la mise en place du Mouvement populaire wallon (MPW) et, à partir de 1962, elle est une des animatrices de la Commission du travail des femmes de la FGTB Liège-Huy-Waremme.
En 1964, elle se voit confier les rubriques « Radio-Vérité » et « Consommateurs » pour le magazine « F », une émission radiophonique de la RTB Liège destinée prioritairement aux femmes. Dans « Radio-Vérité », elle parle de la condition féminine sous un angle progressiste, engagé et novateur, abordant des thèmes peu traités à l’époque sur la radio publique, comme le travail des femmes dans la métallurgie, la question de l’égalité des droits parentaux, l’absentéisme féminin, la liberté sexuelle, l’adolescence… Elle donne fréquemment la parole aux principales intéressées via des tables rondes, des débats ou des interviews. Très méticuleuse, elle utilise un questionnaire pour baliser ses interviews, mais laisse également à ses interlocutrices la possibilité de s’exprimer librement, sans interruption intempestive et en permettant le hors-sujet.
Ces deux premières rubriques radiophoniques ne constituent que le début d’une longue carrière journalistique. Par la suite, Jacqueline Saroléa tiendra deux autres rubriques pour le magazine « F » (« Séquences socio-économiques » et « Athalie »), sera journaliste au journal parlé régional « Liège-Matin », entamera pendant environ cinq ans une carrière à la télévision avant de revenir, vers le milieu des années 1970, à son terrain d’origine : la radio, avec entre autres une nouvelle émission, « Radio Porte Ouverte », durant laquelle une association a carte blanche pour expliquer son projet et ses objectifs.
En 1966, Jacqueline Saroléa couvre personnellement, en tant que syndicaliste et féministe, la grève des travailleuses de la FN à Herstal. Elle se déplace avec un magnétophone portable dans les assemblées, dans les manifestations, interroge des grévistes sur leur ressenti et les conséquences de leur action…
Continuer la lecture de « Le son et l’écho de la grève »