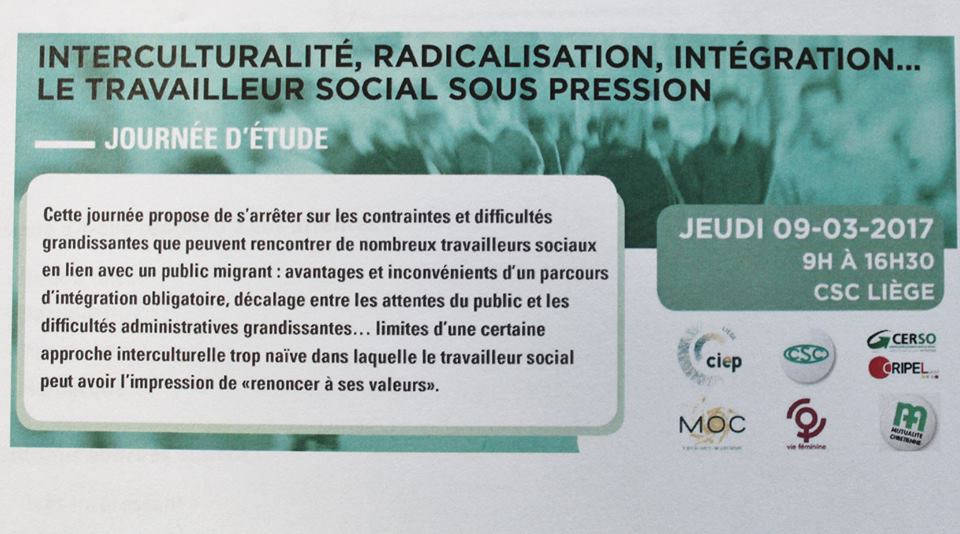Jean-Sébastien Alix (doctorant CADIS/EHESS, chercheur associé au CERIES/univ-Lille)
L’action sociale en France connaît depuis les années 2000 des transformations majeures notamment par l’augmentation des réformes visant à renforcer le contrôle étatique sur le fonctionnement des établissements sociaux et médico-sociaux et les pratiques professionnelles, mais également dans ses modes de financement. Plus précisément, ces réformes s’inscrivent pêle-mêle dans quelques décrets et lois phares : la loi 2002-2 du 2 janvier 2002 dite de rénovation de l’action sociale et médico-sociale précise spécifiquement la responsabilité des acteurs par une contractualisation systématique de la prise en charge via l’écriture de projets individuels ou encore l’obligation de faire des évaluations internes et externes ; la loi du 21 juillet 2009 portant sur la réforme de l’Hôpital et relative aux Patients, à la Santé et aux Territoires (HPST) qui redistribue les schémas d’organisation et de contrôle avec les appels à projet tout en accentuant la mise en concurrence des services et établissements ; la nomenclature du projet SERAFIN PH dans le secteur du handicap qui élabore un référentiel tarifaire sur le modèle de la T2A[1] à partir d’une adéquation des financements aux parcours des personnes réduisant la relation d’aide en une relation de service[2] ; et l’intensification des appels européens et internationaux à désinstitutionnaliser la prise en charge des enfants et adolescents en situation de handicap. Enfin, deux aspects nous semblent occuper une place plus déterminante : l’apparition de régulations incitatives, dites soft law[3], et les recommandations de bonnes pratiques qui en découlent, mais aussi la généralisation de l’entrepreneuriat social et des nouveaux dispositifs financiers que sont les contrats à impact social (CIS)[4] qui permettent à des investisseurs privés de financer des projets d’action sociale.
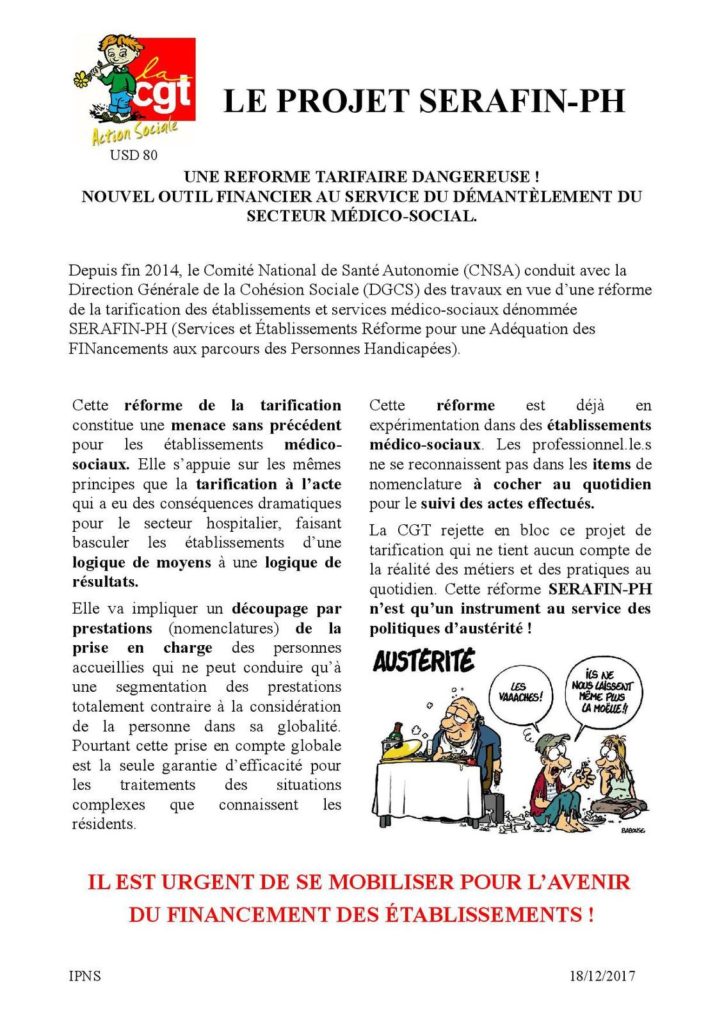
Responsabilisation accentuée des acteurs, mise en concurrence des services et établissements, exigence d’une performance des pratiques, élaboration d’un « droit souple » qui ne serait plus un « ordre de contrainte »[5] mais un outil de « soutien » aux professionnels et l’investissement affirmé d’acteurs issus du monde marchand, selon l’idée que le capitalisme serait au service de l’intérêt général[6], sont les éléments constitutifs des mutations contemporaines de l’action sociale.
Face à celles-ci, de nombreuses voix n’ont pas tardé à se faire entendre par l’intermédiaire des universitaires[7], des collectifs tels qu’Avenir-éducs, l’Inter-régional des formatrices et formateurs en travail social (L’IRE), le Collectif des 39, l’Appel des appels, pour ne citer qu’eux, et des nombreuses mobilisations nationales dans les secteurs de la protection de l’enfance, du handicap, des personnes vieillissantes et dépendantes, etc. Ces mouvements oppositionnels revendiquent globalement une reconnaissance plus forte de la spécificité des métiers du social, par la charge symbolique qu’elle porte et l’engagement de soi des professionnels. De la sorte, ces mouvements mettent en avant la capacité des agents à porter une critique sur les rationalités technico-gestionnaires dans la mesure où l’attitude critique « est le mouvement par lequel le sujet se donne le droit d’interroger la vérité sur ses effets de pouvoir et le pouvoir sur ses discours de vérité »[8]. C’est-à-dire que si la rationalité technico-gestionnaire est une pratique de pouvoir qui agit concrètement dans les pratiques, les professionnels doivent être en mesure d’en dénoncer ses effets de vérité sur les pratiques, qui consistent notamment à réduire le travail socio-éducatif à sa seule appréhension économique.
Au regard de ces éléments, nous pouvons en conclure que l’action sociale, comme tout univers professionnel, est donc traversée par des rapports de force qui engendrent des conflictualités importantes. Pourtant, la confrontation avec le réel des entretiens a considérablement complexifié ce premier constat.
Nous avons effectué 92 entretiens[9] auprès de 85 professionnels, 58°% de femmes et 42°% d’hommes, dans le cadre d’un doctorat en sociologie. Au regard de l’importance du matériel recueilli, nous avons décidé de construire notre analyse à travers trois figures « idéal-typiques » que sont les « résistants », les « non-dupes » et les « adhérents ». Cette typologie se voulait être la plus démonstrative possible en proposant quelques traits caractéristiques de ces figures. Ces typologies ne sont que des abstractions théoriques de la réalité sociale, elles doivent être saisies comme des fictions élaborées à partir de données empiriques, mais non des réalités en tant que telles. Pour preuve, nous avons montré qu’un grand nombre de thématiques telles que la question de l’autonomie, l’engagement, la crise du sens ou la performance témoignent d’un mouvement entre ces figures et d’un dialogue permanent entre elles.
Nous allons citer quelques passages d’entretiens pour comprendre la manière dont ces figures ont été construites et saisir le rapport que les professionnels ont avec ces mutations.
Pour les « résistants », au nombre de 17, le sentiment général est que les procédures, dispositifs et autres discours sur une bonne gestion et sur une comptabilité de l’acte « grignotent les passions ».
Cet ancien délégué syndical à la Protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) indiquait : « On en passe que par des critères de qualité et d’évaluation, et je pense que c’est de la merde. Dans l’éducation, il faut du temps et on ne peut pas évaluer en permanence. Il faut des grandes capacités de résistance, ça passe par s’opposer, par l’action syndicale ou une forme comme ça et collectivement sinon les audits nous feront prendre des vessies pour des lanternes »[10]. Pour lui, la résistance est une action collective, de préférence syndicale, pour être présente sur la scène politique, afin de défendre des idéaux éducatifs concernant la non-stigmatisation des personnes, la croyance en leur éducabilité en opposition à la répression de la délinquance et la défense d’un travail sur du long terme. Il expliquait d’ailleurs comment cette résistance pouvait se mettre en action : « Ça a commencé il y a une vingtaine d’années, ils ont voulu nous faire un audit sur la façon de travailler en PJJ dans la Région et ils nous avaient envoyé deux ou trois spécialistes qui ont commencé à faire une réunion en nous expliquant que l’on ne savait pas vendre l’image de la Protection judiciaire de la jeunesse. Nous étions une vingtaine d’éducateurs, et comme j’étais responsable syndical à l’époque, j’ai pris la parole : “Messieurs, nous n’avons rien à vendre si ce n’est la misère du monde, alors ça ne nous intéresse pas”. Nous avons été une dizaine à quitter cet audit imposé par notre direction. À l’époque, on pouvait se permettre des rapports de force mais aujourd’hui on serait beaucoup plus vite en danger par un avertissement ou un licenciement. C’est devenu plus dur. » Il adopte une posture revendicative en opposant les objectifs politiques aux nécessités éducatives.
La résistance n’est ni systématique, car « si les réformes sont bonnes, alors on est avec », ni forcément militante ou collective mais peut être un acte individuel en remplissant par exemple de manière très aléatoire les logiciels portant sur les actes éducatifs quotidiens. La résistance est finalement une pratique de vigilance quotidienne, elle prend en compte ce qu’il y a de « vivant » dans l’acte socio-éducatif au détriment d’une mathématisation de l’action sociale.
Les « non-dupes » et les « adhérents » témoignent, de manière assez différente, de son envers, c’est-à-dire qu’elles mettent en avant des formes de consentement aux différentes mutations ayant conduit à une rationalisation instrumentale des pratiques.