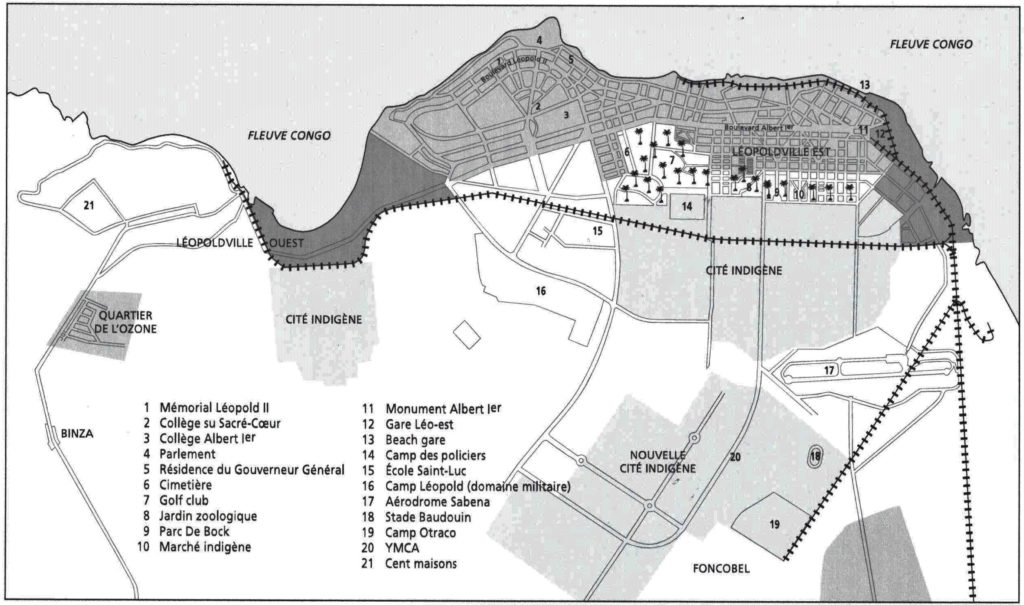Pierre Tilly
Historien, HELHa et UCL Mons
Contrairement à d’autres continents où les recherches sont plus abouties, la question du travail au sens large dans le monde colonial africain occupe encore aujourd’hui une place marginale dans l’historiographie. Elle a retenu pourtant l’attention des sociologues et des anthropologues au moment même de la colonisation et elle a suscité des débats parfois controversés sur l’exploitation de la main-d’œuvre, le travail forcé ou sur la productivité supposée inférieure de l’Africain par exemple. Ces controverses et discussions ont par ailleurs connu un prolongement durant la période postcoloniale.[1] Rappelons à ce sujet qu’à partir des années 1990, un renouveau dans la lutte contre les discriminations a conduit à s’interroger de plus en plus sur les liens possibles entre des situations de domination passées et actuelles. Le champ reste toutefois globalement en friche dans le domaine de l’histoire et notamment sur le contexte spécifique et les caractéristiques et singularités du monde du travail au Congo belge. Une interrogation majeure doit pouvoir soutenir de plus en plus cette réflexion et constituer un changement probant par rapport à la période coloniale justement. Comment faire parler et donner à entendre la parole des « sans-voix » qui constituent la majorité des personnes concernées par cette question du travail colonial ?
Pour éclairer cette question, notre contribution s’articule essentiellement autour de deux parties qui se veulent complémentaires. L’une est de nature plus méthodologique et pragmatiste, dans le sens où elle aborde cette histoire du travail dans une perspective « empirique », celle de l’histoire « telle qu’elle se fait »[2], plutôt qu’« épistémologique », ce qui reviendrait à privilégier les approches plus théoriques et philosophiques de l’histoire. L’autre partie se propose d’apporter quelques éclairages en prenant l’histoire « à rebours », en établissant des liens entre des réalités du monde du travail anciennes et toujours actuelles autour de permanences, de basculements, de ruptures qui sont essentielles pour comprendre les évolutions sur le temps long. La connaissance du contexte ne suffit pas en elle-même à apporter des réponses aux questions posées, mais elle nous rappelle l’importance d’éviter les anachronismes consistant à calquer les concepts situés historiquement sur des processus et des situations relevant d’autres temps et d’autres lieux. Il faut éviter d’établir des causalités historiques qui expliqueraient seulement des discriminations actuelles par l’analyse de l’ancien ordre colonial et mettre de côté les généralisations abusives qui minimisent les singularités et les différences entre les espaces et réalités considérés. Le thème du travail, comme d’autres d’ailleurs, bouscule le découpage en aires culturelles en invitant à des comparaisons et des analyses croisées d’une aire à l’autre. En ce sens, la multiplication et la confrontation de travaux portant sur des territoires et des espaces temporels différents ne peuvent qu’être encouragées.
Le travail a une histoire et il est le fruit de l’action de la société et des individus à travers le temps. Son contenu n’est pas identique selon les aires culturelles et les époques comme le montre le cas du Congo belge, à la fois singulier et illustratif de tendances plus générales. Il nous invite à nous pencher sur une histoire plus vaste liée au monde méditerranéo-asiatique et musulman et à celui de l’océan Indien, en l’absence des Européens, prenant résolument en compte la période précoloniale pour comprendre que l’on ne part pas de rien. Renouveler les analyses en situation coloniale des classes laborieuses et leurs capacités d’agir.
Une histoire du Congo belge au travail n’est pas aisée à appréhender dans sa totalité. Le jeu d’échelles est particulièrement difficile à articuler, que ce soit du local au global ou inversement. Les colonies ne se résument pas à de simples extensions marginales d’une histoire nationale ou à un prolongement du pouvoir et de la culture de la métropole. Les traits spécifiques de l’histoire de l’Afrique, définis par des facteurs locaux comme le poids de l’économie paysanne et informelle à forte intensité de main-d’œuvre, doivent nécessairement être pris en compte en raison de leur impact majeur sur les entreprises coloniales, les structures économiques et sociales coloniales. Et la capacité d’agir de manière autonome dans le chef des autorités locales comme des colonisés constitue une clé de compréhension supplémentaire et indispensable du système colonial comme l’ont démontré des travaux majeurs depuis deux ou trois décennies.[3] On peut l’illustrer au travers du maintien des pouvoirs coutumiers et leur participation à la mobilisation de la main-d’œuvre. Ce système que l’on retrouve notamment au Congo belge génère des rapports de force et des luttes d’influence qui sont complexes et qui montrent que l’autorité coloniale est loin d’être absolue et inébranlable.
Les formes de résistances des travailleurs et/ou les représentations du travail occupent une place de plus en plus importante dans les travaux actuels et permettent de révéler certaines stratégies d’autonomie d’une catégorie de travailleurs locaux et de les mettre en perspective avec les contraintes économiques et politiques exercées par le pouvoir colonial.[4] À l’alternative simpliste collaboration/résistance, des travaux récents ont substitué des analyses centrées sur la capacité d’initiative et d’action des dominés (agency en anglais), proposant ainsi une appréhension beaucoup plus fine des stratégies individuelles et collectives d’accommodement et de distanciation avec une domination brutale, mais matériellement et culturellement incapable de tout contrôler. Les Colonial Studies invitent donc à une recomposition de l’histoire coloniale en insistant sur la complexité de cette histoire partagée qui doit être écrite de plusieurs points de vue et à plusieurs voix.[5] À ce premier défi s’ajoute celui que constitue un objet historique presque expérimental à savoir l’étude des sociétés qui ont existé pendant quelques décennies et qui se sont ensuite défaites totalement ou partiellement.
Un élément essentiel est, en tout cas, à souligner si l’on veut s’inscrire dans une histoire du monde du travail digne de ce nom. Ce n’est pas seulement l’histoire des politiques, des décisions de l’administration coloniale, le rôle et l’influence des élites qu’il faut appréhender, mais aussi la vie de la population au travail, les réalités de terrain qui l’accompagnent et sa capacité d’affecter le cours de l’histoire.[6]
Cette démarche pose inévitablement la question des sources. Celles de l’histoire africaine d’avant la colonisation sont nombreuses et diverses, la relativité des données documentaires disponibles permettant une prise en compte systématique du point de vue des colonisés représente certes une réelle difficulté pour la période de la colonisation.[7] Remises en cause par les études postcoloniales au travers de perspectives « afrocentrées » qui déconstruisent « l’héritage biaisé de cette “bibliothèque coloniale”, où des concepts apparemment banals véhiculent inconsciemment des clichés séculaires » [8], ces sources n’interdisent pas pour autant de privilégier une histoire, ancrée dans les réalités de terrain, qui aborde, au côté de la doctrine et des normes, la philosophie de l’humain, les modes de gouvernement entre l’administration et les populations locales, et les pratiques de gestion liées au travail dans leur dimension quotidienne et presque banale.[9]
La question de la méthode est tout aussi fondamentale que celle des sources. Portée par de nouveaux courants de recherche qui prennent en compte un cadre global et la dimension normative, une approche postcoloniale accorde une place centrale aux modes de vie, de travail et de consommation loin de la société occidentale qui repose essentiellement sur l’idée du salariat comme pierre angulaire de l’organisation du travail et des relations qui y sont associées. Tout en prenant en compte un cadre général et normatif, un travail empirique sur les sociétés et les situations coloniales, sur le fonctionnement de cet écosystème dans leurs particularités apparaît essentiel. Il passe par une analyse pointue des formes de domination du colonialisme et des mesures visant à réformer ce système dans la réalité concrète. Les oppositions classiques entre travail libre et non libre, travail rémunéré et non rémunéré, formel et informel sont désormais clairement remises en cause et doivent être appréhendées de manière dynamique tant au niveau de l’exploitation des sources existantes que dans la problématisation et la phase d’analyse et d’interprétation des données historiques disponibles.
Les réalités du travail colonial à rebours
L’analyse historique par nature complexe et multiforme du travail en Afrique au sud du Sahara invite à prendre d’emblée plusieurs précautions. La première a trait au concept de travail dans cet espace qui, derrière une apparente singularité et uniformité, cache une multitude de réalités et de pratiques. Si l’on adopte un point de vue occidental, l’accent sera mis en général sur plusieurs dimensions distinctes du travail comme le fait de produire les biens nécessaires à la société. Et puis, il représente le moyen principal pour l’individu de subvenir à ses besoins vitaux grâce au salaire fourni. En Europe à tout le moins, le travail est devenu progressivement un principe dirigeant la vie de chacun.e avec l’industrialisation qui commence au 18e siècle. Les relations sociales sont progressivement réduites à la dimension laborieuse. Le travail en tant que concept ou notion juridique n’est entré dans les discours et les pratiques que depuis le milieu du 19e siècle.
En milieu colonial, la pratique précède et s’impose souvent face au droit et aux principes, ce qui s’explique notamment par l’hétérogénéité des situations, mais aussi par la volonté des acteurs de terrain. La manière de penser et de comprendre le travail en situation coloniale est d’une tout autre exigence vu la difficulté de l’appréhender dans le contexte de pays non industrialisés. Il faut donc se munir de l’outillage méthodologique adéquat en s’appuyant sur d’autres disciplines que l’histoire. Le monde du travail colonial exige en fait une approche nuancée loin de l’idée préconçue d’une prolétarisation progressive et linéaire de la main-d’œuvre de la colonie, conduisant à un mouvement et un combat social identiques à ce qui s’est passé en Europe. Plusieurs spécificités par rapport aux pays industrialisés ressortent, de manière évidente, comme l’absence d’un marché du travail du fait de la faible incitation salariale, le fait que le régime du travail est largement dominé par la question sociale ou encore la liberté du travail qui est globalement absente dans les faits même si elle est affirmée sur le plan des discours.

Continuer la lecture de « Travail et conditions de travail au Congo hier et aujourd’hui »